BLOG-NOTES
Cette sous-rubrique de mon blog regroupe mes notes personnelles portant sur la didactique des langues-cultures trop courtes et/ou portant sur des thèmes trop particuliers pour être publiées dans "Mes travaux". Il peut s'agir de réactions à l'actualité, d'annonces de publication, de mises au point ponctuelles, d'extraits d'interventions, d'idées à creuser, de projets de recherche et autres remarques de tous ordres.
Si des commentaires sont annoncés en bas d'un message, cliquez sur le titre de ce message pour les faire apparaître.
Plagiat et auctorisation. Les étudiants face à l'écriture de recherche
Plagiat et auctorisation. Les étudiants face à l'écriture de recherche
Titre de l'ouvrage de DOLIGNIER Catherine (2024), L'harmattan, décembre 2024.
Présentation sur le site de l'éditeur:
Avoir une écriture personnelle à partir de sources scientifiques : pour les nouveaux étudiants peu en connivence avec l’univers universitaire, l’écriture de recherche est un défi, le plagiat un écueil. Qu’est-ce que plagier et, plus spécifiquement, qu’est-ce que plagier à l’université ? Comment y devient-on auteur ?
À rebours du point de vue juridico-moral traditionnel, cette recherche doctorale adopte un point de vue didactique dans une approche linguistique. Ses objectifs : décrire précisément l’écriture plagiaire au cours de la rédaction du mémoire au niveau master et expliquer en quoi elle peut faire obstacle au devenir-auteur.
Cette description veut à la fois outiller les étudiants et les formateurs qui les dirigent pour négocier l’enseignement/apprentissage de l’écriture de recherche. Le plagiat est ici une question épistémologique, une question de rapport à l’écriture et, à terme, une question de formation.
Il s'agit d'une recherche doctorale. La perspective adoptée est intéressante, "didactique" effectivement, comme il est dit dans la présentation.
36 euros la version papier, quand même!... :(
Gratuit sur mon site:
Cours "L'écriture de la recherche en didactique des langues-cultures". Chapitre 1 (Ch. Puren): « Recherche et écriture de la recherche » (nouvelles versions française et anglaise en date du 30 06 2024).
À propos de Denis Cristol, "Le cimetière des mauvaises idées pédagogiques"
Et sous ce titre en chapeau: "À chaque fois on se dit «non pas ça», mais, comme dans un film d'horreur, les mauvaises idées pédagogiques sont increvables".
Il s'agit d'un article très ironique, très incisif... et pertinent, à lire sur le site pédagogique canadien Thot Cursus, qui énumère et commente brièvement une dizaine de ces mauvaises idées avec des intertitres filant la métaphore des films d'horreur: "Le dépotoir électronique", "La fosse universelle", "La damnation de l'évaluation", "Le mouroir psychologique", "le vampire doré" (l'exemple sous ce dernier titre est la privatisation des écoles en Suède, dont les résultats ont été catastrophiques). Publié en avril dernier, cet article vient d'être rappelé par Thot Cursus dans sa lettre d'information de ce jour.
La didactique des langues-cultures (DCL) mériterait tout autant que la pédagogie un article de cette veine. À propos des quatre principaux fondamentaux de toute "pédagogie moderne" des langues que Denis Girars, didacticien d'anglais et de français langues étrangères affirmait en 1968, à savoir...
— isoler dans un premier temps le système oral du système écrit ;
— adopter une attitude franchement " béhavioriste " plutôt que " mentaliste " ;
— créer un besoin constant de communication ;
— éviter, dans la pratique pédagogique, toute référence à la langue maternelle,
... j'ai noté ainsi dans la conclusion générale de mon Histoire des méthodologies: "on peut constater qu'un seul d'entre eux, le troisième, est encore aujourd'hui unanimement reconnu comme valable" (1988a2, p. 387).
Ce troisième principe, fondé sur l'approche communicative dominante à l'époque, a été lui aussi depuis enterré discrètement (il est rarissime que soient publiés des avis de décès en DLC...) au nom, entre autres, du modèle constructiviste, qui veut qu'on s'arrête au moins de temps en temps de communiquer, ne serait-ce que pour réfléchir non seulement à la langue de communication qu'on utilise (activités cognitives) mais à la communication elle-même qu'on met en oeuvre (activités métacognitives).
Parmi toutes les mauvaises idées listées par Denis Cristol, et qui me semble repérables tout autant en pédagie qu'en didactique , il en manque une à mon avis, qui pourrait intituler "Le poison applicationniste", dont l'historie de la DCL offre de nombreux exemples avec les applicationnismes théoriques (linguistique et cognitif), pratiques (les "bonnes pratiques"), technologiques (l'audiovisuel, l'informatique, le numérique ; maintenant l'I.A.?) et méthologiques (les différentes méthodologies constituées, y compris la perspective actionnelle, lorsqu'on considère qu'on en connaît la seule bonne version et qu'elle doit être la seule méthodologie à utiliser) : cf. Puren 2022d (en français) ou Puren 2022d-en (en anglais).
Sur la page de cet article sur le site de Thot Cursus, dans la rubrique "Vous pourriez aussi aimer" proposée dans une colonne de droite, on trouve recommandé en première position un document intitulé "Évolution des idées et des pratiques pédagogiques. Fondements, principes de base et apport à l'enseignement au secondaire". Il s'agit de l'annonce d'une formation offerte par l'Université de Laval (Québec, Canada), illustrée d'une photo d'un élève au tableau, craie à la main, devant un tableau couvert de formules algébriques, l'enseignant pointant avec son crayon la variable de l'une des formules.
Certes, on peut reconnaître sur cette photo une pratique pédagogique de type "méthodes actives" (l'enseignant attirant sans doute l'attention de l'élève sur sa production pour qu'il réfléchisse lui-même, ou pour introduire une nouvelle connaissance). Mais j'ai mis aussitôt le fait qu'il s'agisse d'une production d'équations algébriques - parmi lesquelles, à part mais, soulignée, la fameuse équation d'Einstein "E=MC2", symbole historique de la vérité absolue à laquelle peut parvenir la science -, avec la tendance générale du site Thot Cursus à mettre l'accent sur l'exigence de "rigueur scientifique". Dans la courte présentation de cette formation sur le site de l'Université Laval, on trouve la phrase suivante : "intégration de considérations théoriques de nature philosophique, historique, sociologique et psychologique, dans une visée de pratique pédagogique". La formulation ne permet pas la critique - telle qu'elle est énoncée on ne peut que souscrire à l'idée -, mais elle laisse une marge d'interprétation dans laquelle peut parfaitement prendre place une conception applicationniste de cette "intégration".
C'est pourquoi j'aurais vraiment aimé que Denis Cirstol rajoute, dans les causes connues de mortalité des idées pédagogiques (et didactiques), "le poison scientiste", dont je trouve parfois des traces sur Thot Cursus". Je conseille malgré tout de fréquenter régulièrement ce site, parce qu'on y trouve souvent d'excellents articles, et qu'on n'est pas obligé de goûter à toutes les coupes proposées...
Recherche, innovation et changement en pédagogie et en didactique des langues-cultures
A propos de: Picard Patrick, "Transformer les pratiques en éducation : quels sont les apports de la recherche ?", sur le site du Café pédagogique, "L'Expresso" du 17 septembre 2024.
Ce texte de Patrick Picard est un compte-rendu de l'ouvrage Transformer les pratiques en éducation : quelles recherches pour quels apports ? coordonné par Thibault Coppe, Ariane Baye et Benoit Galand, publié aux Presses Universitaires de Louvain en 2023, et annoncé sur le site des PUL.
Un certain nombre de chapitres ou de sous-chapitres de cet ouvrage abordent directement ou indirectement une question sur laquelle j'ai déjà beaucoup publié, à savoir la relation entre l'innovation et le changement: cf. sur mon site, dans la rubrique "Bibliographies", la section intitulée "Innovation technologique : environnements numériques et Internet", où l'on trouvera toutes les références de mes publications sur ce thème.
Je rappelle brièvement la différence: l’innovation concerne en général un petit groupe d’expérimentateurs voire un seul, qui, pendant un temps restreint, sur un terrain limité et dans des conditions optimales, vont consacrer une quantité importante de temps et d’énergie à une problématique particulière ; le changement, au contraire, concerne tous les enseignants, qui, dans leurs classes ordinaires et en mobilisant toute leur expérience, doivent gérer au quotidien l’ensemble des problématiques d’enseignement-apprentissage. Même si l'on n'utilise pas ainsi ces deux termes, il me semble indispensable de distinguer les deux réalités.
L'étude des relations entre recherche et changement impose donc d'inclure le troisième terme de la problématique, l'innovation, la recherche proposant souvent des innovations qui alimentent des expérimentations, lesquelles se généralisent et se pérennisent rarement dans l'expérience collective des enseignants.
On retrouve dans l'ouvrage recensé les deux propositions principales déjà bien connues pour améliorer le passage de l'innovation proposée par la recherche au changement dans les classes:
1) La collaboration entre chercheurs et praticiens au cours même de l'élaboration de l'innovation: un chapitre de l'ouvrage s'intitule ainsi "Approche co-créative de la production, de l’implémentation et de la durabilité de l’innovation pédagogique : les Partenariats Recherche-Pratique". Ces "partenariats" sont une variante de ladite "recherche-action" (cf. la présentation que j'en fait dans "Mettre en oeuvre ses méthodes de recherche", chap. 1.8).
2) La nécessité de tenir compte des différents contextes dans la mise en oeuvre des innovations, surtout si elles sont imposées de manière autoritaire et uniforme par des autorités éducatives, ou si elles sont proposées à la suite d'expérimentations réalisées par les seuls chercheurs, et même lorsqu'elles ont été élaborées sur le mode de la recherche-action, puisque celle-ci se limite forcément à un nombre limité de contextes. Au chapitre 7 de l'ouvrage recensé, les auteurs s'intéressent aux difficultés du "passage à l'échelle", en l'occurrence de la diffusion à grande échelle d'expérimentations limitées, mais le problème se pose tout autant dans l'autre sens, lorsqu'il s'agit de faire appliquer des réformes institutionnelles décidées pour tout un pays, parce que ces réformes à grande échelle se heurtent aux contraintes variées de terrains différents lors du passage à la petite échelle des établissements et des classes: c'est la problématique que je traite dans un article intitulé "La 'recherche interventionnelle' au service de la généralisation et pérennisation des réformes institutionnelles : le cas de la réforme en cours de l’enseignement des langues en Algérie" (2019c).
Dans cet ouvrage tel qu'il est présenté dans ce compte-rendu, trois points m'ont particulièrement intéressé:
1. Au chapitre 4 intitulé "Avoir un impact : pourquoi mesurer l’implantation d’une intervention est crucial", les auteurs proposent la notion de "variables d'efficacité", désignant "les différents facteurs" - forcément contextuels - "qui contribuent à la 'réussite' ou à l’échec d’une mesure", et ils en proposent la typologie suivante - je cite:
- les temps (est-ce que les professionnels ont bien passé le temps qu’on leur demandait d’y passer, dans leurs pratiques d’enseignement ?),
- l’adhésion (est-ce qu’ils sont d’accord avec ce qu’on leur demande de faire ? Est-ce qu’ils y croient ? Ont-ils des marges de discussion et d’appropriation ? La relation entre chercheurs, formateurs et acteurs est-elle plutôt collaborative ou normative ?),
- la formation (est-ce que ce qu’on a fait en formation a été efficace pour engager des dynamiques porteuses ? S’est-on assez intéressé à l’observation réelle du travail ?),
- la stabilité (est-ce que la rotation rapide des acteurs ou des pilotes impacte la poursuite de l’engagement dans le programme ? Est-ce que d’autres priorités s’opposent ?),
- les moyens (est-ce qu’ils ont les moyens matériels et humains pour faire ce qui est demandé ?),
- la variabilité des résultats (est-ce que ça marche bien dans certains endroits, pour certains publics, mais moins bien pour d’autres ?).
"Selon les auteurs - résume l'auteur du compte-rendu - observer ces 'variables d’efficacité' demande aux institutions de transformer leurs organisations, que ce soit dans la conception du métier de pilote, de chercheur, de formateur, et de développer des modalités de collaboration, construire des espaces de travail commun, s’intéresser vraiment à ce que les uns pensent de la place que peuvent occuper les autres, comprendre d’autres points que les siens, et construire des ajustements nécessaires à la réussite des changements proposés."
2. Au même chapitre 4, sous l'intertitre intitulé "De la théorie à la pratique : les défis de la recherche translationnelle" est présenté ce type de recherche né dans le domaine de la santé publique, et qui travaille la relation entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, afin d'accélérer l'application sur le terrain des découvertes scientifiques médicales. J'ai pour ma part, précisément dans le même article 2019c cité plus haut, mobilisé également de manière analogique un autre type connu de recherche concernant la diffusion des bonnes pratiques en santé publique, la "recherche interventionnelle". Comme je l'écris dans le résumé en ligne de cet article, "il s’agit d’une type de recherche non pas par l’intervention, comme c’est le cas de la recherche-action, mais sur les différents modes d’intervention possibles, à deux niveaux différents et interreliés : l’intervention des décideurs, chercheurs et formateurs auprès des enseignants, et l’intervention des enseignants auprès des élèves." La "recherche interventionnelle" ainsi conçue en didactique des langues-cultures (DLC) me semble plus adéquate que ne le serait la première, la "recherche translationnelle", laquelle, pour autant que je puisse l'imaginer, réactiverait une forme soft d'applicationisme connue en pédagogie sous l'appellation de "transposition didactique" (cf. Puren 2024i, chap. 3.3.2.5, pp. 44-46).
3. Le chapitre 9 de l'ouvrage recensé, "Améliorer les connaissances ou les pratiques ? Un point de vue ergonomique", a été rédigé par Tricot, auteur que j'ai cité à plusieurs reprises dans mes travaux parce que dans la collection 'Mythes et réalités' qu’il a créée et qu'il dirige chez Retz, il a publié en 2017 un ouvrage intitulé "L'innovation pédagogique". L'un des mythes qu'il dénonce dans cet ouvrage, comme on peut l'imaginer à son titre et au titre de ce chapitre 9, est l'idée que les chercheurs ne proposent que des connaissances nouvelles, et que le changement ne peut être réalisé que par les enseignants eux-mêmes en construisant des situations d'apprentissage tenant compte de ce qu'il appelle "les contraintes spécifiques des apprentissage scolaires" (titre d'un interview donné en 2020 sur le site "Synapses", où il reprend la même idée).
Si je cite ici ce chapitre 9, c'est aussi parce que Tricot y fait allusion à une nouvelle édition parue en mai 2014 de son ouvrage L'innovation pédagogique (Nouvelle édition enrichie, sur le site des Editiond RETZ); et que dans l'introduction de cette seconde édition il annonce que par rapport à l'édition précédente de 2017 il a modifié son opinion sur deux points, en raison des "évolutions majeures" qu'il a constatées depuis lors, je cite :
(a) La pédagogie par projet est maintenant l’objet de nombreuses études rigoureuses, montrant un effet positif de cette façon d’enseigner.
(b) Il en est de même pour la classe inversée, qui fait désormais l’objet d’études beaucoup plus rigoureuses qui montrent des résultats très favorables à cette façon d’organiser l’enseignement.
Il avait jugé, dans la première édition, que c'était pour lui "un crève-coeur" de constater que la pédagogie de projet était très motivante pour les élèves, mais pour certains d'entre eux trop exigeante. Je ne peux que me féliciter de l'évolution de son jugement sur cette pédagogie, que je promeus depuis plus de vingt ans en tant que modèle pédagogique le plus adéquat pour la mise en oeuvre de la perpective actionnelle (cf. les deux rubriques bibliographiques correspondantes sur mon site, "Pédagogie de projet" et "Perspective actionnelle").
Dans la première édition de son ouvrage, Tricot portait également un jugement nuancé sur la pédagogie inversée, qui pouvait être selon une occasion de réfléchir à la relation entre le travail en classe et hors-classe, mais qui ne lui paraissait pas réellement innovante. Pour ma part, je maintiens le jugement critique que j'ai exposé dans le fil des échanges que j'ai hébergé un moment sur mon site (2017d), cf. aussi la synthèse de mes idées dans le diaporama 2018a) : en DLC, ce dispositif est intéressant au niveau universitaire parce qu'il oblige effectivement les enseignants à remettre en cause la démarche transmissive qui y est encore trop souvent la règle; mais en didactique scolaire des langues-cultures, c'est, du point de vue de l'histoire de la discipline, une "innovation réactionnaire" qui pose plus de problèmes qu'elle n'en résoud.
Un nouveau mode d'exploitation du site christianpuren.com: une interrogation de documents regroupés en dossiers traités par IA
Sur la page d'accueil du site a été ajoutée une nouvelle information concernant les modes possibles d'exploitation du site: "5. Une interrogation des documents du site traités par IA".
Un outil tel que NotebookLM, disponible gratuitement depuis début juin 2024, permet de se constituer des dossiers différents constitués de documents de différents types, en particulier - ce qui nous intéresse le plus ici - des fichiers pdf et des liens URL. Dans ce dernier cas, c'est le document entier vers lequel point le lien qui est pris en compte. Il est possible ensuite, sur chacun de ces dossiers, de poser des questions qui sont traitées par l'intelligence artificielle.
Les étudiants peuvent par exemple se construire un dossier avec comme seul document le fichier pdf de mon Histoire des méthodologies téléchargé sur mon site, ou simplement avec son lien (https://www.christianpuren.com/mes-travaux/1988a/). Ou un autre dossier avec mon Essai sur l'éclectisme (https://www.christianpuren.com/mes-travaux/1994e/).
Ils peuvent aussi se constituer un dossier avec comme documents les liens URL copiés-collés depuis l'une des vingt rubriques bibliographiques actuellement disponibles sur mon site (https://www.christianpuren.com/bibliographies/: les copier-coller des liens se font depuis l'intérieur de telle ou telle rubrique; pour la rubrique "Epistémologe", par exemple (https://www.christianpuren.com/bibliographies/%C3%A9pist%C3%A9mologie/), les deux premiers liens suivants fourniront chacun les deux premiers documents du dossier:
- https://www.christianpuren.com/mes-travaux/1994a/
- https://www.christianpuren.com/mes-travaux/1999a/
Les six liens suivants devront être copiés à partir des "six dossiers du cours en ligne "La didactique des langues-cultures comme domaine de recherche" annoncés dans cette rubrique (https://www.christianpuren.com/cours-la-dlc-comme-domaine-de-recherche/). Les deux premiers, par exemple, sont les suivants:
- https://www.christianpuren.com/cours-la-dlc-comme-domaine-de-recherche/dossier-n-2-la-perspective-m%C3%A9thodologique/
- https://www.christianpuren.com/cours-la-dlc-comme-domaine-de-recherche/dossier-n-1-les-3-perspectives-constitutives-de-la-dlc/
On continuera avec le fichier suivant annoncé dans la rubrique épistémologie:
https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2010a/
Etc.
Une fois le dossier constitué de tous les URL (il reste en permanence, ensuite, disponible sur son compte), un résumé et quelques questions générales sont proposés par défaut, mais on peut immédiatement entrer avec l'IA dans un jeu de questions-réponses, exactement comme sur ChatGPT, Perplexity, Gemini, etc.
« Le spectre des stéréotypes »
À propos de : LAGORGETTE Dominique & RAMOND Denis. 2023. « Le spectre des stéréotypes ». Site laviedesideesf.fr, 16 mai 2023, 17 p.
Les auteurs annoncent dans le chapeau de leur texte « Peut-on lutter contre les stéréotypes ? Cette injonction répétée pose des difficultés pratiques et conceptuelles qu'il convient d'explorer. » Ils partent d'un constat général que l'on peut je pense élargir à la didactique des langues-cultures (DLC) pendant toute la période de domination exclusive de l'approche communicative-interculturelle, avec l'importance première accordée, dans la conception de l'enseignement-apprentissage de la culture, aux représentions, et parmi les représentations, aux stéréotypes négatifs.
Le constat des auteurs est le suivant : « Le stéréotype a mauvaise réputation. Il serait un jugement faux, biaisé, une vision déformée de la réalité, une étiquette réductrice attachée à des groupes, une source d’incompréhension entre les cultures [...]. » Si cette notion a autant de succès, c'est parce que, selon les auteurs citant Ruth Amossy, elle permet « au sociologue et au psychologue de saisir la façon dont l'individu appréhende l'autre [...] en fonction des modèles culturels de sa communauté »[1].
On comprend que la notion ait également séduit en didactique des langues-cultures (DLC), parce qu'elle offre aux auteurs de manuels et aux enseignants une entrée commode pour l'enseignement-apprentissage de la culture étrangère à des débutants, en permettant de combiner la découverte de la culture étrangère avec une réflexion formative des apprenants sur leur propre culture, ainsi qu'une diffusion de valeurs humanistes telles que la tolérance et le respect de l'autre.
Les auteurs développent sur cette notion un point de vue critique : « Loin d’aller de soi, l’injonction répétée à combattre les stéréotypes engendre en effet des difficultés pratiques et conceptuelles insuffisamment explorées jusqu’à présent. » Je crois que l'avertissement aurait dû valoir aussi pour la DLC. Les quatre difficultés abordées dans la seconde et dernière partie de l'article me paraissent pouvoir susciter des réflexions intéressantes en DLC.
1) Les auteurs notent que « [...] reproduire [les stéréotypes)] pour mieux les combattre permet, paradoxalement, leur dissémination ». Cette remarque me semble très pertinente dans le cas de cours de langue-culture à des débutants : utiliser pour l'enseignement des documents illustrant des stéréotypes dans le pays étranger ou visant le pays étranger revient de facto ... à leur enseigner ces stéréotypes. En bonne pédagogie, la démarche correcte serait plutôt de laisser les apprenants se construire d'abord leurs propres représentations, avant de les leur faire confronter aux représentations sociales existantes et à des données objectives fournies par des études scientifiques.
2) La second difficulté, selon les auteurs, vient du fait que « le stéréotype est partout, si bien qu’il est délicat d’attribuer des responsabilités, de retracer son origine et de désigner des coupables. » En DLC, la présentation de stéréotypes dans et sur la culture étrangère – qu'ils soient auto- ou hétéro-, positifs ou négatifs – devrait être précédée d'un minimum d'informations sur l'origine, la nature et le fonctionnement des stéréotypes à partir d'études ou de synthèses de sociologues et psychologues sociaux, suivies de réflexions personnelles des apprenants sur leur propre culture; le tout, sans doute, en L1. Le risque est réel, sinon, que les apprenants n'en retirent comme leçon qu'une vague idée telle que, par exemple en FLE, « Il y a beaucoup de racistes en France », voire que « Les Français sont racistes ». Les choses, on le sait, sont autrement plus complexes, et surtout, quel que soit le constat plus ou moins sévère que l'on tire sur ce pays, l'important, du point de vue formatif, au-delà de la dénonciation légitime du racisme en tant que tel, c'est chez les apprenants une meilleur compréhension de la mécanique des stéréotypes qui enrichisse leur propre questionnement sur leurs propres représentations.
3) La troisième difficulté concerne la question de la liberté artistique et des ambigüités inhérentes à l'interprétation des œuvres d'art. Les manuels de langue exploitent souvent des textes littéraires. Or les stéréotypes qui y apparaissent peuvent être interprétés de multiples manières : ils peuvent être les leurs ou ceux de la société qu'ils décrivent, mais ils peuvent tout aussi bien en jouer pour brosser le portrait de personnages avec lesquels ils ne s’identifient absolument pas, étayer des intrigues, susciter des réactions et des réflexions chez leurs lecteurs, voire pour critiquer ces stéréotypes.
4) La quatrième difficulté soulevée par les auteurs fait écho chez moi à une remarque critique que j'ai déjà faite par ailleurs concernant l'usage de la notion de « représentation » en DLC. Les auteurs écrivent :
Supposer que combattre les stéréotypes emporterait automatiquement des effets émancipateurs repose sur un postulat fragile : l’idée que l’on pourrait déduire facilement les effets des images, que l’on pourrait, en d’autres termes, poser une continuité entre les représentations externes disséminées dans le monde social (celles de la culture de masse, par exemple) et les représentations internes de ceux qui les consomment. Jacques Rancière a critiqué ces déductions trop rapides et la chasse au stéréotype, cette image dont on soupçonne « l’effet d’incorporation chez un destinataire toujours présupposé suffisamment stupide et résigné pour être le seul à ne pas déchiffrer le secret que l’analyste lit à livre ouvert » [2]. Rancière nous invite à nous méfier du sentiment de supériorité que l’on peut éprouver lorsqu’on pourchasse les stéréotypes du passé, et que l’on s’imagine que nos aïeux étaient, à l’égard des images, plus naïfs que nous. (pp. 15-16)
Ce postulat effectivement « fragile » est souvent présent dans les propositions qui ont été faites en DLC pour la mise en œuvre de l'approche interculturelle : ce sont généralement les seules représentations « externes » qui sont présentées.
Quant à ce sentiment de supériorité dont parle Rancière, il me semble apparaître parfois chez les didacticiens dans leurs analyses des représentations tant des apprenants sur la culture étrangère, que des enseignants sur l'enseignement-apprentissage des langues-cultures. Ils opposent en effet les représentations en tant qu'images simplistes ou erronées aux conceptions qui sont les leurs, qui reposeraient sur des connaissances objectives. Voilà ce que j'ai écrit à ce propos dans un article de 2011:
À la lecture récente d’un appel à communications pour un colloque, m’est venue en particulier l’idée que ce couple représentations-conceptions pourrait bien fonctionner en partie chez les didacticiens de langues-cultures comme un marqueur de positionnement hiérarchique : ils parleraient généralement de « représentations » à propos des enseignants et des apprenants, mais de « conceptions » à propos de responsables ou experts institutionnels (comme si les premiers n’avaient pas aussi des conceptions, et les seconds des représentations…). (2011j, p. 33)
L'article des deux auteurs se termine par cette réflexion : « Un monde sans stéréotypes reste à inventer, et il n'est pas sûr qu'il soit concevable" (p. 17). Il est bien dommage qu'ils ne l'aient pas développée un minimum. Elle renvoie sans doute au fait que les stéréotypes, en tant que généralisations inductives, sont des simplifications inévitables de toute réalité complexe. On peut même les qualifier de profitables si on les considère comme des modélisations, avec les différentes fonctions qu'assurent ces outils conceptuels (cf. le document 014, récemment mis à jour, et mon essai 2022f).
[1] Note des auteurs : Ruth Amossy, « La notion de stéréotype dans la réflexion contemporaine », Littérature n° 73, 1989, p. 32.
[2] Note des auteurs : Jacques Rancière, « L’histoire “des” femmes : entre subjectivation et représentation (note critique) », p. 1016 in : Annales. Économies, sociétés, civilisations, 48(4), 1993.
"Project Method", par Michael Knolll (Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy, 2014)
L'auteur de cet article d'encyclopédie (en anglais) fait une synthèse très intéressante sur l'histoire de la pédagogie de projet, avec différentes tendances apparues successivement, et la description de ce qu'il considère comme le consensus actuel parmi les éducateurs.
Ci-dessous la traduction de la totalité de ce (court) article, avec les mises en italique des passages qui m'ont particulièrement attiré l'attention par rapport à la mise en oeuvre de la pédagogie de projet en perspective actionnelle, et une remarque personnelle finale.
___________________________
La méthode de projet, également discutée sous des titres tels que le travail par projet, l'approche de projet et l'apprentissage basé sur les projets, est l'une des méthodes d'enseignement standard. C'est une sous-forme d'apprentissage centrée sur l'action et dirigée par l'étudiant, et une entreprise dans laquelle les enfants s'engagent dans la résolution pratique de problèmes pendant une certaine période de temps. Les projets peuvent consister, par exemple, à construire un bateau à moteur, concevoir une aire de jeux ou produire un film vidéo. Dans la plupart des cas, les projets sont initiés par l'enseignant, mais dans la mesure du possible, ils sont planifiés et exécutés par les élèves eux-mêmes, individuellement ou en groupes. Dans le cadre du travail par projet, les étudiants créent des produits tangibles qui dépassent souvent les limites disciplinaires et sont généralement présentés au grand public lors des journées des parents ou des foires scolaires.
Contrairement aux méthodes traditionnelles, les projets mettent l'accent sur l'application, plutôt que sur la transmission, de connaissances ou de compétences spécifiques, et ils visent plus rigoureusement que les cours magistraux, les démonstrations ou les récitations, à renforcer la motivation intrinsèque, la pensée indépendante, l'estime de soi et la responsabilité sociale.
Origines en Europe
Historiquement, la méthode de projet est apparue en 1577 lorsque des maîtres constructeurs ont fondé l'Accademia di San Lucca à Rome pour améliorer leur statut social en développant leur profession comme une science et en améliorant l'éducation de leurs apprentis en offrant des leçons sur la théorie et l'histoire de l'architecture, les mathématiques, la géométrie et la perspective. Pour combler l'écart entre la théorie et la pratique, les architectes ont ensuite élargi leur répertoire au-delà des méthodes centrées sur l'enseignant et ont transféré leur travail quotidien de conception de bâtiments du studio à l'académie, de sorte que les étudiants acquéraient, grâce à l'apprentissage par la pratique et la simulation de situations réelles, l'expérience et l'habileté dont ils avaient besoin plus tard en tant que professionnels.
I
Ces débuts indiquent que la méthode de projet - comme l'expérience du scientifique, l'étude de cas de l'avocat et l'exercice du bac à sable de l'officier - a son origine dans l'académisation d'une profession et que le concept d'enseignement par projets n'est pas le résultat de délibérations philosophiques abstraites, par exemple de Rousseau, Froebel ou Dewey, mais de la réflexion pratique des enseignants de l'éducation professionnelle qui ont essayé d'activer l'esprit de leurs étudiants et de rendre leur formation intéressante, vivante, et, dans la mesure du possible, authentique et utile.
Il a fallu cependant plus de 150 ans et le transfert de l'Italie à la France pour que le travail par projet évolue d'un événement sporadique et volontaire pour quelques personnes à une partie récurrente et obligatoire du programme d'études pour tous les élèves. En effet, ce n'est qu'en 1763 que les étudiants avancés de l'Académie Royale d'Architecture de Paris ont reçu régulièrement des problèmes de conception (maintenant connus sous le nom de "projets") pour démontrer qu'ils étaient capables d'appliquer les principes de composition et de construction qu'ils avaient appris auparavant. Dès le début, la méthode de projet remplissait deux fonctions : d'abord, compléter la formation livresque et théorique des étudiants, et ensuite, tester leurs capacités artistiques et pratiques. En fait, la partie la plus difficile, et la plus chère, de l'examen final pour les étudiants français en architecture, et depuis 1829 en génie (à l'École Centrale des Arts et Manufacture), consistait à concevoir de manière imaginative des fontaines, des églises et des palais, des turbines, des grues et des ponts.
Trois modèles de base
En étudiant les meilleures pratiques européennes, William B. Rogers, le fondateur du Massachusetts Institute of Technology (MIT), découvrit la méthode du "projet" à Karlsruhe et à Zürich, et en 1865, fut le premier à l'adopter comme nouvelle méthode d'enseignement aux États-Unis. En 1876, son successeur à la présidence du MIT, John D. Runkle, remarqua une absence préoccupante de compétences manuelles parmi ses étudiants en ingénierie et créa une école des arts mécaniques pour remédier à ce défaut. Plus important encore, il promut l'introduction de la formation manuelle en tant que branche essentielle du programme scolaire commun et ouvrit ainsi la voie à la diffusion de la méthode du projet, de haut en bas, depuis le collège jusqu'à l'école et, éventuellement, la maternelle. Au cours des quatre décennies qui suivirent, des éducateurs éminents mirent en place trois types distincts de projets qui ont conservé leur attrait et leur importance jusqu'à aujourd'hui.
Le modèle linéaire, développé en 1879 par Calvin M. Woodward, professeur de génie mécanique à l'Université de Washington et fondateur de la première école de formation manuelle à St. Louis, se conformait au principe didactique principal selon lequel l'enseignement, pour être efficace, doit progresser du facile, du simple et du connu au difficile, au complexe et à l'inconnu. À la Manual Training High School, les cours d'artisanat et de dessin mécanique étaient donc dispensés en deux étapes. En suivant le "système russe", les étudiants apprenaient d'abord l'alphabet des outils et des techniques en passant par une série d'exercices de base, puis ils avaient le temps de réaliser des "projets". Woodward considérait ces projets comme des exercices synthétiques. Les compétences que les étudiants avaient apprises précédemment de manière isolée et sous la direction de l'enseignant étaient désormais mises en pratique dans un contexte et par eux-mêmes, par exemple, en concevant et fabriquant des porte-livres, des outils de feu ou des moteurs à vapeur. De cette manière, la formation progressait de manière systématique des principes aux applications, ou, comme le disait Woodward, de "l'instruction" à "la construction". À la fin de la quatrième année, le cours de formation manuelle était complété par ce qu'il appelait le "projet de fin d'études".
Le modèle holistique, proposé vers 1900 par Charles R. Richards, professeur de formation manuelle à l'École des enseignants de l'Université Columbia à New York, et influencé par le concept d'occupations actives de Froebel et Dewey, a remplacé le système consécutif d'instruction et de construction de Woodward par un système intégratif de "totalités naturelles" afin que les élèves puissent travailler ensemble et participer dès le début à la planification et à la réalisation du projet. Proposé par l'enseignant, les élèves de l'école primaire Horace Mann ont décidé, par exemple, de reconstruire un temple grec. Après avoir planifié le projet et acquis les compétences nécessaires, chaque enfant a fabriqué une colonne, un chapiteau et un fronton en argile, ainsi qu'un segment pour les fondations, le mur et le toit. En évaluant les résultats, les élèves ont sélectionné les meilleures pièces de travail, les ont moulées en plâtre et les ont assemblées pour créer un temple de trois mètres de long. Selon Richards, les élèves étaient motivés par le fait qu'ils coopéraient de manière significative et obtenaient au moment approprié les connaissances et les compétences nécessaires pour atteindre leur objectif. Par conséquent, contrairement à Woodward, L'"instruction" ne précédait pas le projet, mais faisait partie intégrante de la "construction".
Le modèle universel, propagé par William H. Kilpatrick de l'École des enseignants de Columbia dans son article mondialement célèbre intitulé "La méthode du projet" de 1918, définissait le projet de manière large en l'appelant un "acte enthousiaste et intentionnel". Tout ce que les enfants entreprenaient, tant qu'ils le faisaient avec un but, constituait un projet. Aucun aspect de la vie utile ne devait être exclu. Pour Kilpatrick, le projet n'était pas une méthode spécifique restreinte à la formation manuelle et à certaines étapes de l'enseignement, mais une méthode générale pouvant être utilisée en permanence, dans toutes les matières et englobant toutes les formes de comportement et d'apprentissage, que ce soit la confection d'une robe, la résolution d'un problème mathématique, l'écriture d'une lettre, la mémorisation d'un poème, l'observation d'un coucher de soleil ou l'écoute d'une sonate. Mis à part la lecture, l'écriture et l'arithmétique, il n'y avait pas de programme prescrit, et le travail sur les projets n'exigeait même pas une action active. Les enfants qui présentaient une pièce de théâtre réalisaient un projet, tout comme ceux qui se trouvaient dans le public et appréciaient le spectacle. Idéalement, le projet était proposé et mené à bien par les élèves eux-mêmes, c'est-à-dire sans aucune aide de l'enseignant; car seulement s'ils avaient "la liberté de pratiquer" et exerçaient "la pratique avec satisfaction", pourraient-ils accroître leur confiance en eux, leur autonomie et leur efficacité personnelle et améliorer leur capacité à initier, planifier, exécuter et juger - des capacités que Kilpatrick considérait comme essentielles pour la préservation et l'avancement de la démocratie.
L'échec de Kilpatrick et la mission démocratique de l'Amérique
Dès le début, le troisième modèle - contrairement aux deux premiers - a été vivement contesté tant par les éducateurs conservateurs que progressistes. Même les deux collègues de Teachers College dont Kilpatrick s'est servi pour étayer sa position en psychologie de l'apprentissage ont élevé la voix et ont objecté à sa définition large et à son concept axé sur l'enfant. Edward L. Thorndike et John Dewey, communément caractérisés comme défenseurs de philosophies éducatives opposées, ont unanimement mis en garde contre l'utilisation de la méthode du projet de Kilpatrick comme unique dispositif d'enseignement, voire comme principal, car l'apprentissage limité à des actions incidentes et instrumentales risquait d'être trop disjoint, dispersé et hasardeux pour fournir aux enfants le développement continu dont ils avaient besoin pour maîtriser pleinement les fondamentaux et avoir une compréhension plus profonde des questions et des sujets impliqués dans le projet.
En général, et résumant la critique avancée par des éducateurs tels qu'Ernest Horn, W.W. Charters, Boyd H. Bode, Ernest E. Bayles, Philip W. Jackson et Ellen C. Lagemann, la méthode du projet de kilpatrick présentait quatre graves lacunes : (1) elle ne reconnaissait comme valides que les intérêts momentanés des enfants et affirmait que la forte motivation intrinsèque garantirait les meilleurs résultats en apprentissage ; (2) elle n'offrait aucune solution pratique pour les tâches quotidiennes de l'enseignant concernant le contenu des matières, la gestion de classe et la performance des élèves ; (3) elle propageait un concept de liberté qui encourageait le développement d'attitudes égoïstes et individualistes plutôt que - comme c'était l'intention - la formation de vertus démocratiques et sociales ; et (4) c'était une philosophie de l'éducation qui prétendait être une méthode d'enseignement, promettant aide, conseils et orientation. À la fin des années 1920, Kilpatrick reconnut avoir commis une erreur en étendant le projet au-delà de son domaine traditionnel et s'abstint discrètement d'utiliser le terme pour son programme éducatif. Malgré les critiques acerbes de Dewey et de tous les éducateurs américains importants passés et présents, et malgré le fait que le concept de Kilpatrick n'ait jamais été mis en œuvre avec succès, son article de 1918 est encore considéré dans le monde entier comme le texte classique de l'approche par projet et comme la meilleure démonstration de la mise en pratique de la théorie éducative de Dewey.
Aux États-Unis, l'appel à l'apprentissage pratique faisait partie du credo national. Depuis le milieu du XIXe siècle, les Américains considéraient l'apprentissage par livre et par cœur comme "aristocratique", tandis qu'ils considéraient l'apprentissage par la formation et l'action comme "démocratique", car il utilisait les expériences des classes productives, facilitait l'avancement des enfants ayant des aptitudes pratiques et favorisait la formation de citoyens socialement responsables. Comme le travail en laboratoire et sur le terrain, la méthode du projet semblait parfaitement répondre au désir du public d'activité pratique et d'égalité des chances pour tous.
Pas étonnant que le projet ait de nouveau traversé l'Atlantique et ait été vivement débattu, surtout dans les pays qui luttaient pour surmonter leur passé autocratique ou fasciste. Dans les années 1920, les éducateurs soviétiques ont apprécié le projet comme l'approche idéale pour accélérer la transition du féodalisme tsariste au socialisme démocratique, mais en 1931, ils ont été réduits au silence lorsque le Comité central du Parti communiste est intervenu et a interdit la mise en œuvre des programmes de projets, en déclarant que le travail par projet était en désaccord avec la notion du parti d'un enseignement systématique et d'une endoctrination dogmatique. Près de 50 ans plus tard, en lien avec la rébellion étudiante, un mouvement puissant est apparu en Allemagne de l'Ouest et, en mentionnant explicitement le livre "Démocratie et éducation" de Dewey et la "Méthode du projet" de Kilpatrick, a identifié le projet dans son sens large comme le seul moyen de revitaliser l'apprentissage, d'humaniser l'enseignement, de démocratiser l'école et de transformer la société. Le mouvement s'est rapidement propagé au Danemark, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. À la fin des années 1980, le projet, défini de manière large, a connu un renouveau aux États-Unis, où la méthode définie de manière étroite avait survécu à la crise provoquée par Kilpatrick dans l'enseignement technique, agricole et scientifique.
Concepts actuels et résultats empiriques
Aujourd'hui, la méthode du projet est principalement discutée sous deux perspectives. En tant qu'approche par projet, propagée par Lillian G. Katz et Sylvia C. Chard, la méthode désigne toute "enquête approfondie sur un sujet du monde réel digne de l'attention et des efforts d'un étudiant" (Chard 2011) et est entreprise et menée de manière plutôt indépendante par une classe, un groupe ou un élève individuel. Dans les écoles maternelles et les jardins d'enfants, la méthode du projet peut être utilisée comme seule méthode, mais dans les écoles primaires, les lycées et les universités, elle doit être complétée par un enseignement systématique. Sans le savoir, Katz et Chard suivent les traces de Woodward et son modèle linéaire. Alors que l'enseignement systématique aborde les lacunes des élèves et garantit l'acquisition de compétences, disent-ils, le travail sur les projets s'appuie sur la compétence des élèves et représente l'application autonome des compétences acquises précédemment. mais contrairement à woodward, katz et chard ne limitent pas le projet au travail manuel et à la construction, c'est-à-dire que les élèves sont autorisés à se pencher sur n'importe quel phénomène réel qu'ils ne peuvent pas explorer et étudier uniquement par le biais de recherches sur internet et en bibliothèque.
Le projet d'apprentissage, développé en particulier par des équipes autour de Phyllis C. Blumenfeld et John R. Mergendoller, diffère de l'approche par projet en ce qu'il suit le modèle holistique de Richards et Dewey et intègre les deux phases, c'est-à-dire l'acquisition de compétences et leur application, en un seul processus. Fréquemment, la phrase "projet d'apprentissage" est utilisée de manière interchangeable avec "apprentissage par problème", mais - conformément à Dewey - on devrait clairement distinguer ces deux concepts. Alors que l'apprentissage par problème est centré sur l'enquête et se limite à la résolution de problèmes abstraits, l'apprentissage par projet est centré sur la production et requiert l'utilisation de stratégies de résolution de problèmes théoriques et pratiques. il y a encore des éducateurs qui adhèrent à la méthode du projet axée sur l'enfant de kilpatrick, mais dans la plupart des cas, ils prônent des projets qui - bien que "permettant une certaine liberté de parole et de choix aux étudiants" - sont "soigneusement planifiés, gérés et évalués pour aider les élèves à apprendre les principaux contenus académiques, à pratiquer des compétences du XXIe siècle (telles que la collaboration, la communication et la pensée critique), et à créer des produits et présentations authentiques et de haute qualité" (Buck Institute for Education, 2012).
En faisant spécifiquement référence à Dewey, Vygotsky et Jérôme Bruner, tous les éducateurs modernes situent la méthode du projet dans un cadre théorique basé sur le constructivisme. Ils considèrent les étudiants comme des agents actifs engagés dans des tâches authentiques, résolvant des problèmes réels et générant des connaissances et des compétences dans une interaction dynamique avec leur environnement physique et social, créant ainsi du sens pour eux-mêmes et le monde qui les entoure. Ils reconnaissent cependant que l'approche constructiviste doit être équilibrée par un concept d'enseignement structuré et une orientation pédagogique directe et solide.
Selon des recherches récentes, le travail sur les projets répond, dans une certaine mesure, aux attentes de ses partisans en ce sens que la méthode améliore - en plus de l'apprentissage factuel - la motivation, la confiance en soi et la pensée critique des élèves, ainsi que leurs compétences en résolution de problèmes, prise de décision, recherche et collaboration. Mais il y a aussi des preuves indiquant qu'il existe des obstacles qui entravent la réalisation des objectifs visés, car ni les élèves ni les enseignants ne remplissent toujours complètement les prémisses et les qualifications nécessaires. Les enseignants, par exemple, ont du mal à suggérer et concevoir des projets stimulants, à suivre les progrès, à donner des commentaires et à apporter un soutien lorsque nécessaire, à créer et maintenir une atmosphère propice à l'étude et au travail, et enfin à développer des outils pour évaluer les résultats. De même, les étudiants se sentent souvent mal préparés et dépassés par la complexité des tâches à accomplir, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas du tout comment définir le problème, choisir la méthodologie appropriée, trouver les ressources nécessaires, réviser les plans et les procédures si nécessaire, respecter les délais et présenter les résultats de manière appropriée. Après tout, les projets peuvent échouer car peu d'étudiants sont constamment disposés à un apprentissage autonome, créatif et innovant. En principe, ils apprécient la liberté d'action que la méthode du projet leur offre, mais, comme dans les contextes traditionnels, ils utilisent souvent des stratégies de marchandage, d'esquive et de dissimulation afin de réduire, d'éviter ou même de résister au temps, à l'énergie et à l'imagination supplémentaires requis par le travail sur les projets.
Références complètes: KNOLL Michael, "Project Method", pp. 665-669 in: Encyclopedia Of Educational Thory and Philosophy, 2014, pp. 665-669. Mis en ligne par l'auteur : https://www.researchgate.net/publication/316554427.
________________________________________
Remarque personnelle
Je relève particulièrement le passage suivant, dans l'avant-dernier paragraphe:
[...] tous les éducateurs modernes situent la méthode du projet dans un cadre théorique basé sur le constructivisme. Ils considèrent les étudiants comme des agents actifs engagés dans des tâches authentiques, résolvant des problèmes réels et générant des connaissances et des compétences dans une interaction dynamique avec leur environnement physique et social, créant ainsi du sens pour eux-mêmes et le monde qui les entoure. Ils reconnaissent cependant que l'approche constructiviste doit être équilibrée par un concept d'enseignement structuré et une orientation pédagogique directe et solide.
Cette position consensuelle chez les éducateurs me semble elle aussi la meilleure à retenir en didactique de langues-cultures : l'apprentissage formel de la langue étrangère exige en effet "un concept d'enseignement structuré", et j'ai noté ailleurs, en raison de cette exigence, l'insuffisance du recours au seul modèle cognitif du constructivisme (cf. par ex. mon précédent billet de blog en date du 18 janvier 2012). C'est cette conception de la pédagogie de projet que j'ai proposé de mettre en oeuvre dans les manuels de langue, sous la forme d'unités didactiques conçues comme des "mini-projets" (cf., entre autres nombreux articles sur mon site, mon article 2021i, "Fonctions intégratives des « mini-projets » des unités didactiques des manuels de langue en perspective actionnelle". Version anglaise disponible: 2021i-en.
À cette condition, et en tenant compte des obstacles justement signalés par l'auteur à la fin de son article, le modèle pédagogique de la perspective actionnelle, à savoir la pédagogie de projet, me parâit fournir à la didactique actuelle des langues-cultures "une orientation pédagogique directe et solide".
Christian Puren, 19/05/2024
"Un mot/un enjeu : Problème ou problématique ?"
Le site du Café pédagogique a publié ce jour sous ce titre une belle présentation de l'opposition entre "problème" et "problématique" faite par deux pédagogues, Daniel Gostain et Jacques Marpeau.
Cette opposition est depuis longtemps au centre de ma conception de la didactique "complexe" des langues-cultures. La rubrique bibliographique "Complexité, didactique complexe, modélisation(s)" regroupe, classés par thématiques, les liens vers les très nombreux textes où j'ai abordé cette question.
Pour me limiter ici à trois documents très schématiques, cf. :
- -"Problème versus problématique", 023
- -"Les composantes de la complexité", 046
- -"Pour une didactique complexe des langues-cultures", 2003b (disponible en anglais, 2003b-en, et en espagnol, 2003b-es).
Par rapport à tout ce que j'ai pu écrire de mon côté, je note, dans ce texte de D. Gostain et J. Marpeau, trois idées m'ont paru particulièrement pertinentes:
- le lien établi entre problème et orientation produit, et entre problématique et orientation processus ;
- le "problème" caractérisé comme "le meilleur ennemi de la problématique" ;
- l'entraînement des élèves à la problématisation comme outil de formation à la pensée critique.
Christian Puren, 21 03 2024
À propos des dispositifs de traduction automatique en temps réel : quelques réflexions didactiques prospectives
L'idée de ce billet est partie de l'information suivante, du site 01net.com, qui m'est parvenue ce jour: "Ces lunettes AR utilisent ChatGPT pour traduire vos conversations en temps réel".
Extrait:
Les lunettes de réalité augmentée de Solos ambitionnent de mettre un terme à la barrière de la langue. Pour traduire les conversations en temps réel, les lunettes connectées s’appuient sur ChatGPT et Whisper, deux technologies phares d’OpenAI.
(...) les microphones captent les paroles de votre interlocuteur. Celles-ci sont automatiquement traduites et diffusées dans les oreilles de l’utilisateur par le biais des haut-parleurs dans les branches. Solos assure que l’opération se veut la plus discrète possible.
(...)
Solos Translate dispose aussi d’un mode dédié aux groupes. Celui-ci propose de traduire les conversations entre plusieurs personnes. Chaque participant peut écouter les échanges dans sa langue natale.
(...) Enfin, les lunettes peuvent également traduire du texte, partagé par le biais de l’application compagnon de Solos.
Les traductions orales automatiques existaient déjà sur smartphone, mais il s'agissait de traductions consécutives, phrase par phrase, avec les manipulations peu commodes que l'on imagine. La nouvelle technologie proposée ici opère un saut qualitatif en termes de praticité. Si on ajoute aux possibilités de cette technologie la traduction des textes écrits déjà assurée par des IA tels que ChatGPT, il est évident que les didacticiens de langues-cultures doivent réfléchir sérieusement non pas seulement à l'utilisation de l'IA pour l'apprentissage, mais pour reconsidérer leur paradigme dominant, qui est, depuis la fin du XIXe siècle, un apprentissage de la L2 principalement par un enseignement en L2, dans le cadre de ce que l'on appelle alors la "méthode directe intégrale".
Je vois a priori trois domaines à reconsidérer d'urgence: celui des relations entre enseignement, apprentissage et usage, celui de la traduction d'apprentissage, et celui de la relation langue-culture.
- La relation entre enseignement, apprentissage et usage
Depuis des décennies, la problématique didactique est conçue comme une problématique d'enseignement-apprentissage, alors même que l'objectif est l'usage, et qu'en raison du principe d'homologie fin-moyen, l'outil principal d'apprentissage de la L2, même dans l'espace et le temps de la classe, est son usage. J'ai publié à ce sujet un billet de blog en date du - 04 décembre 2023. "La didactique des langues-cultures, ou la problématique de l''enseignement-apprentissage-usage", dans lequel je présente les sept arguments qui obligent, à mon avis, à parler en DLC non plus d'"enseignement-apprentissage", mais d'"enseignement-apprentissage-usage". Cette évolution de la problématique didactique est d'autant plus indispensable que les dispositifs de traduction automatique permettent désormais aux élèves de produire avant d'apprendre, alors que jusqu'à présent il leur fallait apprendre avant de produire. En d'autres termes, l'usage peut précéder l'apprentissage : il est évident qu'il s'agit d'une rupture paradigmatique dont il faut tirer les conséquences et implications didactiques. On peut maintenant imaginer, par exemple, de commencer par faire produire par les étudiants des dialogues en L2 que constitueront les supports des "unités didactiques", i.e. d'enseignement-apprentissage.
- La traduction d'apprentissage
Sa disponibilité immédiate en temps réel en classe et la qualité d'ores et déjà obtenue pour les conversations et textes simples en font un outil d'apprentissage désormais d'autant plus incontournable en classe que les élèves, de toutes manières, l'utiliseront massivement pour leurs activités personnelles d'apprentissage. Je signalais, à la fin d'un billet en date du 17 janvier 2023 intitulé "Le ChatGPT3 d'OpenAI et la didactique des langues-cultures", la publication en ligne, par le CAVILAM-Alliance française de Vichy, d'une série de fiches pratiques "pour faire de l’IA le meilleur assistant pédagogique des enseignants". Les activités proposées aux élèves sont intéressantes et créatives, elles sont certainement à retenir, mais elles se font uniquement en L2. Le CAVILAM de Vichy, comme le CLAB de Besançon et autres organismes d'enseignement du FLE à des adultes en France, travaille avec des apprenants de langues différentes, et les activités intégrant le recours aux différentes L1 en présence posent problème, par conséquent, dans un enseignement collectif sur une durée limitée. C'est d'ailleurs pour cette raison que la didactique du FLE a mis très longtemps à s'intéresser à l'usage de la L1 dans l'enseignement scolaire des L2 en France. Mais la relation L1-L2 est une problématique incontournable en didactique scolaire, et la recherche en FLE doit désormais encore moins la négliger. Aux traductions automatiques comme outil d'apprentissage doit certainement succéder, à partir d'un certain niveau de complexité des textes (et donc, de la part de la traduction automatique, d'inexactitudes ou à l'inverse d'"exactitudes" effaçant les implicites et connotations culturelles), l'apprentissage du contrôle de cette traduction.
- La relation langue-culture
J'ai récemment, dans un billet de blog en date du 21 septembre 2022, soutenu l'idée selon laquelle, dans l'appellation de "didactique des langues-cultures", il fallait considérer "langue-culture" comme une modélisation qui inclut les cas où l'on veut neutraliser au maximum la culture (comme dans les textes scientifiques), à l'image de la série des nombres entiers naturels, qui inclut le nombre nul, le zéro. On peut désormais imaginer des séquences d'enseignement voire des cours entiers où c'est à l'inverse la langue que l'on s'efforce de neutraliser au maximum en la faisant prendre en charge par la traduction automatique, au profit d'un travail sur la seule culture.
Christian Puren, le 10 janvier 2024
"L'inversion" un modèle de relation hétéronomie-autonomie indispensable en perspective actionnelle
J'ai publié depuis plusieurs années sur mon site (en Bibliothèque de travail, Document 022) un "méta-modèle complexe des relations entre deux pôles opposés" qui regroupe les modèles de relations que l'on peut concevoir, par exemple, entre les processus ou les cultures d'enseignement et d'apprentissage, entre l'hétéonomie et l'autonomie, entre l'hétéro-formation (à l'enseignement ou à la recherche) et l'autoformation.
Aux sept modèles de relation déjà pris en compte dans ce méta-modèle - le continuum, l'opposition, l'évolution, le contact, la dialogique, l'instrumentalisation et l'encadrement -, une nouvelle version de décembre 2023 ajoute un nouveau modèle, "l'inversion". C’est le modèle des vases communicants, mais inversé: plus de ceci d'un côté, moins de cela de l'autre, ou le contraire. Ce modèle est indispensable à la mise en œuvre de la pédagogie de projet : la première tâche de projet, en effet, celle de la conception, doit être réalisée par les élèves de la manière la plus autonome possible parce que c’est la condition de leur engagement personnel dans la réalisation du projet qui est ainsi le leur. Or plus les élèves font jouer leur autonomie à ce moment-là – ils vont choisir, par exemple, une variante de projet différente de celle proposée dans le manuel ou préparée par l’enseignant –, plus ce dernier peut être amené à être directif pour la suite. Il va leur dire, par exemple : « Vous avez choisi tel projet sur telle thématique, c’est bien. Mais je sais que vous allez avoir besoin de travailler auparavant sur telle ou telle structure grammaticale, ou sur tel ou tel champ sémantique." Autre exemple: si les enseignants choisissent eux-mêmes toute la documentation de leur projet, l'enseignant devra peut-être leur suggérer, ou leur proposer, voire leur imposer, tel ou tel document supplémentaire qu'il jugera alors indispensable.
J'aurais pu penser depuis longtemps à cet autre modèle de "l'inversion", puisqu'il se combine naturellement avec deux autres déjà intégrés précédemment dans mon méta-modèle, à savoir l'opposition (c'est l'opposition qui fait que l'augmentation du niveau de directivité fait mécaniquement baisser le niveau d'autonomie, et l'inverse), et l’évolution (l’autonomie des élèves ne peut augmenter que si l’enseignant diminue son niveau de directivité). Et aussi parce qu'on le retrouve dans des idées exprimées par certains pédagogues dans des passages que j'ai déjà cités par ailleurs (en particulier dans la conférence 2017c, qui porte précisément sur la pédagogie de projet:
Philippe Perrenoud : « Le projet, un générateur de situations complexes » (Cahiers Pédagogiques n° 10, Janvier 2014. Paris : CRAP, pp. 21-23) :
Un projet entièrement conçu par le professeur ne sera pas acheté par les élèves. Mais il est peu probable qu'un projet proposé par les élèves rejoigne comme par miracle les objectifs de formation du professeur. Il importe donc d'engager une négociation, le professeur tirant le projet vers les apprentissages, les élèves vers la réussite, le plaisir, le jeu. Il n'y a aucune raison de ne pas faire de cette tension l'objet d'une réflexion commune. On peut imaginer un professeur qui ouvrirait une démarche de projet en définissant un cahier des charges ouvert [...]. (p. 23)
BORDALLO Isabelle & GINESTET Jean-Paul, Pour une pédagogie du projet, Paris: Hachette-Éducation, 1993, 192 p. (cf. les deux dernières dérives qu'ils constatent dans la pédagogique de projet :
– La dérive productiviste
Le produit à fabriquer est plus important que les apprentissages visés. […]
– La dérive techniciste
La planification par l’enseignant est excessive. […] L’élève est l’exécutant d’un projet entièrement conçu par l’enseignant. […]
– La dérive spontanéiste
Le projet s’invente au fur et à mesure sans objectifs clairement définis au départ. […]
Si pour apprendre il faut un projet, avoir un projet ne suffit pas. Les périls sont nombreux: si l’enseignant met exclusivement l’accent sur les désirs des élèves, leur prise de responsabilité, il risque soit de concevoir un projet irréalisable, soit d’amuser les élèves avec un projet dans lequel ils ne vont rien apprendre.
S’il est particulièrement soucieux de rigueur ou de rentabilité, il a tendance à planifier toute la démarche, l’élève devient un O.S. (ouvrier spécialisé), et là aussi le bénéfice escompté au niveau des apprentissages laisse à désirer. (pp. 11-13)
A ces deux passages peuvent être ajoutés ici l'ensemble de mon article 2014d, dont le titre à lui seul exprime la combinaison entre les modèles de l'inversion et de l'opposition: contrôle vs. autonomie, contrôle et autonomie : deux dynamiques à la fois antagonistes et complémentaires".
La nouvelle version de ce méta-modèle, proposant huit modèles différents de relation, est donc désormais disponible au lien 022.
La didactique des langues-cultures, ou la problématique de l''enseignement-apprentissage-usage"
L'expression traditionnelle pour caractéristiser la problématique didactique en langues-cultures est celle de l"l'enseignement-apprentissage", à tel point que la lexie est devenue pratiquement obligée, et même utilisée par certains étudiants alors même qu'il ne s'agit en contexte que d'enseignement, avec des énoncés tels que "les enseignants sont invités à innover dans leurs pratiques d'enseignement-apprentissage"...
On aurait dû être surpris depuis longtemps par le fait qu'à l'inverse un troisième terme manquait pour compléter l'expression, celui d'"usage". Voici quelques arguments mobilisables à ce propos, dont certains se recoupent :
1) L'objectif ultime des cours de langue-culture n'est ni l'enseignement, ni l'apprentissage, mais l'usage que les apprenants pourront en faire ensuite.
2) L’usage intervient constamment en classe de manière non simulée lorsque les apprenants utilisent la L2 pour s’exprimer personnellement et travailler, que ce soit sur des documents authentiques ou à propos des activités qu'ils réalisent en classe.
3) L’approche communicative vise la compétence de communication en L2 dans des situations de la vie quotidienne. C’est pourquoi, au moins à la fin de chaque unité didactique, on propose aux apprenants une simulation d’usage dans la société étrangère.
4) Dans le FOS et le FOUS, et autres modèles de cours sur objectif spécifique, c’est par l’analyse préalable de l’usage visé de la langue que l'on détermine les contenus d’enseignement.
5) La "perspective actionnelle" (ou "action-oriented approach", dans la version originale anglaise du CECR de 2001) se base sur une forme d'usage de la langue, à savoir la langue comme moyen d'action sociale.
6) Dans les évaluations sommatives et certificatives, on n’évalue ni l’enseignement, ni l’apprentissage, mais la compétence d’usage.
7) Enfin, last but not least, le principe sans doute le plus important de la didactique des langues-cultures est le principe d'"homologie fin-moyen": on apprend à communiquer en L2 en communiquant en L2 en classe; on apprend à agir socialement en société en agissant socialement en classe (d'où le modèle pédagogique de la pédagogie de projet, fondé sur ce principe appliqué à l'agir citoyen). Et les autres types d'activité (le travail d'entraînement aux différentes "activités langagières" et les exercices langagiers) ne viennent qu'en étayage de ce principe, qui consiste à considérer l'usage comme le moyen priviligié de l'enseignement-apprentissage.
Pour ma part, j'ai donc décidé de ne parler désormais, quand il s'agit de la problématique didactique globale, que d'"enseignement-apprentissage-usage".
Langue-culture(s): quand la culture de chaque nation investit le "BELF" (Business English as a Lingua Franca)
A propos de l'article de Chavi Chi-Yun Chen (Assistant Professor, International Negotiation and Sales Management, IÉSEG School of Management), "Le style des communiqués de presse, une question de culture nationale", theconversation.com, 5 novembre 2023
L'auteur rend compte d'une expérimentation concernant un genre de texte pourtant a priori le plus simplement "informatif" possible dans un anglais conçu en outre comme une "Lingua Franca", où l'on pourrait donc penser a priori que les cultures particulières ont été évacuées : les "communiqués de presse" des grandes entreprises internationales. Il a analysé dans un premier temps plus de 2 000 communiqués rédigés par 86 multinationales britanniques, américaines, françaises et allemandes au moyen dun logiciel d’analyse de l’utilisation des mots (LIWC). Dans un second temps, il a vérifié les résultats par des tests de lecture:
Nous avons créé quatre versions différentes d’un communiqué pour analyser les attitudes de plus de 1 000 investisseurs/clients potentiels dans les quatre pays en question (Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, France). Leurs réactions à l’égard des communiqués de presse ont globalement confirmé que les différentes pratiques répondaient bien aux attentes des destinataires.
Par exemple:
[...] les multinationales américaines et allemandes mettent davantage l’accent sur la complexité et la profondeur de l’analyse (le "traitement cognitif") que les multinationales britanniques et françaises." (...)
[...] les multinationales britanniques font souvent référence à leurs partenaires. A contrario, les multinationales françaises et allemandes minimisent leur présence dans leurs communications. (...)
[...] Quant aux multinationales britanniques et allemandes, leurs communications mobilisent davantage le registre de l’émotion – contrairement à celles de leurs homologues françaises. Les entreprises américaines ont, de leur côté, plus tendance à adopter un ton impersonnel et distant.
Sa conclusion est claire:
Les résultats soulignent le caractère unique de la culture nationale et séparent la langue de cette culture [...]. Malgré cette base linguistique commune, le pays d’origine de la multinationale forme l’architecture du style qui affecte la manière dont leurs communiqués de presse sont rédigés.
Un colloque le 16 11 2013 sur l'oeuvre de l'épistémologue Jean-Louis LE MOIGNE
Sur le site "Réseau Intelligence de la Complexité" est annoncé pour le 16 novembre 2013 un grand colloque à Paris , consacré à l'"Actualité de l'oeuvre de Jean-Louis Le Moigne", épistémologue décédé il y a un an. Ce colloque peut être suivi à distance.
J'ai souvent cité les travaux de J.-L. Lemoigne - qui a été un compagnon de route d'Edgard Morin avec lequel il partageait beaucoup d'idées - pour ses réflexions sur la complexité et la modélisation des systèmes complexes. Une recherche avec son nom sur mon site au moyen de son moteur de recherche interne pourra vous l'attester: c'est l'une de mes références épistémologiques pour ce que j'appelle, précisément, la "didactique complexe des langues-cultures" (cf. mon article-manifeste 2003b).
Je l'avais invité à un colloque de mon centre de recherche de Saint-Etienne, le CELEC-CEDICLEC en 2005, et le texte de sa conférence avait été publié à la suite dans les ELA:
« Les enjeux éthiques de la didactique des langues et des cultures n’appellent-ils pas un "Nouveau discours sur la méthode des études de notre temps" » ? ELA revue de didactologie des langues-cultures et de lexiculturologie, n° 140, juil.-sept. 2005, pp. 295-308.
Parmi ses travaux disponibles en ligne se trouve l'un de ses ouvrages les plus importants, La théorie du système général. Théorie de la modélisation, 1994, rééd. 2006.
Parmi les citations que je préfère, et que j'ai été amené à rappeler à plusieurs reprises:
- "Il en va des définitions comme des brouets: plus ils sont clairs, moins ils sont nutritifs." (p. 2), "Qu'est-ce qu'un modèle?" (1987).
- "Ne nous enfermons pas dans l’alternative stérilisante du choix binaire entre l’objectivité et la subjectivité ! Ce n’est pas l’un ou l’autre, c’est un troisième terme qui est au dessus et que, pour faire image, je vais appeler la « projectivité ». Dis-moi quels sont les projets par rapport auxquels tu ordonnes, tu organises, tu donnes sens, tu articules, les propositions que tu me proposes." (ELA 2005, cf. la référence plus haut).
Cette annonce me donne l'occasion de saluer sa mémoire.
Christian Puren, 27 10 2023
Innovation technologique et changement didactique (bis ou ter...)
A propos de: Dominique Desjeux, "L’innovation, bien plus qu’une question technologique", Site theconversation.com, 10 octobre 2023,
Les idées exprimées dans les passages suivants de cet article publié le 10/10/2023 sur le site theconversation.com, concernent l'innovation technologique "en faveur de la transition écologique" et "d'une déconsommation énergétique et matérielle", mais elles peuvent être très exactement transposées dans l'enseignement en général, et l'enseignement des langues-cultures en particulier.
Pour qu’une innovation réussisse, il faut qu’elle soit en partie transformée, réinterprétée, par les acteurs qui sont concernés par ses effets. Il n’existe pas de lien mécanique entre la qualité scientifique d’une innovation et son acceptation par une population donnée.
[...]
Quelle que soit l’innovation, son entrée dans le monde réel reste perturbée par des contraintes d’apprentissage, celles de sa mise en œuvre concrète, celles des règles du jeu social et celles des groupes sociaux les plus aptes à se l’approprier.
[...]
Pour innover en faveur de la transition écologique, il ne suffira donc pas d’avoir une vision pour produire du changement. Il s’agira aussi de comprendre les logiques sociales invisibles qui organisent le milieu dans lequel le changement va se produire, c’est-à-dire du moment de la réception. Ce milieu est vivant, il n’est pas passif, il propose des changements. En même temps, il réinterprète le changement par rapport à ses contraintes et à ses intérêts. Il a des effets en retour sur l’organisation ou le système politique ou administratif qui émet du changement.
On comprend donc que la question centrale du changement en faveur d’une déconsommation énergétique et matérielle pose la question de la négociation de la transition et donc de la gouvernabilité.
_________________
Chez les responsables de l'Education nationale française, et dans beaucoup de recherches universitaires, la seule question semble être celle de l'expérimentation plus ou moins ponctuelle, évaluée qui plus est, lorsqu'elle l'est, en termes de résultats, et non en termes de transformation et de réinterprétation par les enseignants.
C'est une thématique que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder dans plusieurs articles, en particulier celui intitulé, précisément: "La didactique des langues-cultures face aux innovations technologiques : des comptes rendus d’expérimentation aux recherches sur les usages ordinaires des innovations" (2016d).
Nouvelle version du dossier de formation "Les trois perspectives constitutives la didactique des langues-cultures étrangères"
Cette nouvelle version du 05 08 2023 opère deux modifications très ponctuelles, mais importantes:
· 1) Ajout de l’élément « usage » dans la définition de la discipline, qui devient la suivante : "Didactique des langues-cultures discipline centrée sur l'observation, l’analyse, l’interprétation, l’évaluation et l’intervention concernant les environnements, pratiques et processus situés et interreliés d'enseignement-apprentissage-usage des langues-cultures" (p. 2). Cet ajout est justifié pp. 4-5.
· 2) Ajout p. 12 de la justification de l’expression « langues-cultures » dans l’appellation « didactique des langues-cultures ». Cette justification est extraite d’un essai d’octobre 2022 intitulé Modélisation, types généraux et types didactiques de modèles en didactique complexe des langues-cultures (2022f), chapitre 3.1.3 « "Langues-cultures" dans "didactique des langues-cultures" » : une série modèle à deux éléments », pp. 12-13. Je défends déjà cette appellation, qui est critiquée par certains didacticiens, dans un billet de blog en date du 21 septembre 2022 : « À propos de l'appellation "didactique des langues-cultures" »
Une thèse de 2020 concluant sur l'intérêt de combiner perspective actionnelle et pédagogie de projet
Référence de la thèse, disponible en ligne:
GUZMAN VEGA Laura. Articuler projets individuels de mobilité et dispositifs didactiques en français : publics colombiens en contexte francophone, Thèse dirigée Florence Mourlhon-Dallies (DILTEC, Univ. Paris III), soutenue le 14 décembre 2020, https://theses.hal.science/tel-03711808
Cette thèse porte, comme on le voit à son titre, sur les mêmes objectifs combinés que le cours FRANMOBE (voir la reproduction de Guide pédagogique sur ce site, Document 083) , à savoir la conception et préparation d'un projet de mobilité, et l'apprentissage du français, mais dans un contexte différent - francophone, i.e. homoglotte dans cette thèse, hétéroglotte dans FRANMOBE, les apprenants étant des étudiants latino-américains dans leur pays.
L'auteure de la thèse présente ainsi, dans la conclusion générale de sa thèse, la principale conclusion à laquelle elle a abouti:
[...] la lecture et l’interprétation de nos données a pris une direction bien différente de ce que l’on a l’habitude de faire pour une analyse de besoins en FOS ou en FOU. [...] Le face à face entre programme de formation tel que l’on le conçoit en FOS et FOU et le projet pédagogique a conduit à comprendre que pour pouvoir répondre aux démarches projectives des apprenants il nous fallait considérer des modalités de formation plus flexibles et moins fermées que le programme pédagogique classique. [...] [Nous pourrions proposer] des dispositifs pédagogiques [...] inspirés davantage du projet pédagogique et de l’apprentissage par l’action ou actionnel [...]. (p. 531, p. 533)
C'est précisément de ces mêmes idées que sont partis, empiriquement, les concepteurs de FRANMOBE.
Le référentiel actionnel qu'ont élaboré dès le départ les concepteurs de FRANMOBE pour guider la préparation collective des projets individuels peut certainement être comparé aux référentiels professionnels présentés dans plusieurs articles de ce numéro de revue dirigé par la directrice de cette thèse, Florence Mourlhon-Dallies:
MOURLHON-DALLIES Florence (dir.): "Langue et travail". Le Français dans le monde, "Recherches et applications" n° 42, juillet 2007, 192 p.
L'apprentissage de la langue au travail ne relève pas en effet d'une approche communicative, mais actionnelle de la langue, puisqu'elle est considérée comme un élément constitutif de la compétence professionnelle.
Agir commun, praxis et co-culture d'enseignement-apprentissage
Sur le site laviedes idees.fr, Pierre Sauvêtre, en date du 21 novembre 2014, a publié une recension de l'ouvrage de Pierre Dardot et Christian Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris : La découverte, 2014, 593 p. L'intérêt de ce livre, selon lui, est qu'il "introduit en France la question du « commun » qui était jusqu’ici absente du débat hexagonal, alors qu’elle irrigue depuis les premiers travaux d’Elinor Ostrom il y a vingt ans le champ des sciences humaines anglo-saxonnes."
Cette notion est reprise depuis quelques années en France par quelques philosophes et sociologues (par ex. François Jullien, cf. mon billet de blog en date du 20 décembre 2016 , et Francis Dubet, cf. mon Post-scriptum en date du 22 septembre 2014 sur la page de téléchargement de mon article de 2011j consacré aux composantes de la compétence culturelle en classe de L2.
Cette notion de "commun" intéresse fortement la DLC pour la réflexion sur la notion de "co-culture" d'enseignement-apprentissage en classe de langue étrangère, puisqu'il s'agit dans ces classes, au-delà des cultures sociales, profils cognitifs, habitudes et autres stratégies d'enseignement et d'apprentissage des uns et des autres, de se créer une culture commune pour mener à bien le projet commun d'enseignement-apprentissage.
L'ouvrage de Pierre Dardot et Christian Laval apparaît particulièrement intéressant pour la DLC parce que les auteurs y relient étroitement la création du commun à la praxis: les auteurs, selon le recenseur,
s'efforcent alors d’enrichir leur vision du commun en conceptualisant le passage de l’agir commun au droit du commun. En s’inspirant de Castoriadis, ils définissent l’émancipation comme une « praxis instituante ou activité consciente d’institution » (p. 440) qui consiste dans l’ « autoproduction d’un sujet collectif dans et par la coproduction continuée de règles de droit » (p. 445). Le commun est le fait pour les participants à une même activité de délibérer et de co-instituer les règles de droit qui la gouverne en se produisant par là-même comme un nouveau sujet collectif.
Or, entre les modèles scientifiques et les modèles pratiques, c'est à l'occasion des processus d'élaboration conjointe, entre les apprenants et les enseignants des modèles praxéologiques, que peuvent peut s'élaborer progressivement cette culture commune. On pourra se reporter, concernant la modélisation praxéologique en didactique des langues-cultures, aux textes suivants :
- 2023b. Le traitement des « modèles » en didactique internationale de l’anglais : une conception épistémologique réductrice de la discipline. L’exemple du « modèle » PPP (Présentation, Pratique, Production). Essai, chap. 1.4.3 "Modélisation praxéologique" (j'y distingue entre la praxéologisation mentale et la praxéologisation pratique). (Version anglaise disponible 2013b-en)
- 2020a. "Le système des modèles en didactique des langues-cultures : modèles pratiques, praxéologiques, théoriques, didactologiques".
- 2015a. Théorie générale de la recherche en didactique des langues-cultures. Essai. Chap. 4 "Du sous-système théorique au sous-système praxéologiques" (version espagnole disponible 2015a-es).
___________
Cf. également mon billet de blog en date du 32 août 2022, intitulé "Trois formes de perception prioritaire de l'interculturalité : les différences, les ressemblances et les communs"
Le Chatbot GPT3 d'OpenAI et la formation en didactique des langues-cultures
GPT signifie "Generative Pre-training Transformer". C'est un modèle de langage développé par l'entreprise OpenAI. Le programme de chatbot que j'ai testé est animé par l’algorithme GPT-3 d’OpenAI (https://chat.openai.com).
J'ai posé quelques questions à cet "chabot conversationnel" pour tester sa fiabilité en didactique des langues-cultures (DLC). En commençant par sa définition elle-même.
Ma question : Quelle est la définition de la "didactique des langues-cultures"
Sa réponse :
La didactique des langues-cultures est l'ensemble des théories et des pratiques qui visent à enseigner une langue étrangère de manière à intégrer ses aspects culturels. Cela implique de prendre en compte les différences culturelles et de comprendre comment elles peuvent influencer l'apprentissage de la langue. La didactique des langues-cultures met l'accent sur l'importance de l'interculturalité et de la communication interculturelle dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Elle vise à aider les apprenants à acquérir une meilleure compréhension de la culture de la langue étudiée et à développer des compétences de communication efficaces dans un contexte culturellement diversifié.
Mon commentaire :
L'IA a bien interprété le tiret entre "langues" et "cultures", comme dans sa réponse à une autre question où je lui ai demandé la différence entre la "didactique des langues et des cultures" et la "didactique des langues-cultures".
Par contre, la réponse se limite, comme on le voit, au cadre de l'approche communicative-interculturelle. Elle ne prend pas en compte les développements de la perspective actionnelle et des approches plurilingues, qui sont pourtant déjà anciennes. Les textes qui alimentent l'IA du ChatGPT vont en principe jusqu'en 2021; j'ai plutôt l'impression, à lire cette définition, que ceux qui sont mobilisés pour la DLC datent du CECRL de 2001.
J'ai voulu confirmer cette évaluation
Ma question : Qu'est-ce que la "perspective actionnelle" en didactique des langues-cultures?
Sa réponse : La perspective actionnelle en didactique des langues-cultures est une approche de l'enseignement des langues étrangères qui met l'accent sur l'utilisation de la langue dans des situations de communication réelles. Selon cette perspective, l'apprentissage d'une langue étrangère doit permettre aux étudiants de communiquer efficacement dans des situations de la vie quotidienne, plutôt que de se concentrer uniquement sur la maîtrise formelle de la grammaire et du vocabulaire.
Pour mettre en œuvre cette approche, les enseignants peuvent utiliser des activités de simulation de la vie quotidienne, telles que des jeux de rôle, des débats, des ateliers de cuisine ou de voyage, qui permettent aux étudiants de pratiquer la langue dans un contexte authentique. L'objectif est de donner aux étudiants les compétences nécessaires pour communiquer efficacement avec des locuteurs natifs de la langue cible, tout en prenant en compte les différences culturelles qui peuvent influencer la communication.
Mon commentaire : Cette réponse confirme que l'IA reste bloquée historiquement sur l'approche communicative-interculturelle. Elle m'apprend quelque chose de plus (et de plus inquiétant pour un usage par des étudiants): de toute évidence, l'IA ne connaissait pas le concept de "perspective actionnelle" dans la discipline, mais elle a néanmoins répondu à partir de sa reconnaissance de l'expression "didactique des langues-cultures" et des données concernant la "perspective actionnelle" telle qu'on peut la comprendre en reliant les sens généraux des deux termes. On comprend que ce mode de fonctionnement puisse générer de nombreuses erreurs ou insuffisances...
Dans la réponse donnée à la définition de la DLC, le fait d'en rester à l'opposition classique théorie-pratique m'a semblé une limitation quant à la compréhension de l'épistémologie de la discipline, qui est, à l'instar de la pédagogie selon Emile Durkheim, une "théorie pratique", c'est-à-dire, pour utiliser une notion actuelle, un "modèle" dans le sens d'un produit d'une modélisation fonctionnant comme une interface entre la théorie et la pratique.
J'ai voulu vérifier si cette absence de la notion de "modèle" venait d'une non mise en relation des ressources documentaires de l'IA entre celles portant sur la DLC et celles portant sur l'épistémologie:
Ma question : Quelle est la différence entre théorie, pratique et modèle?
Sa réponse : La théorie est une explication rationnelle et cohérente d'un phénomène ou d'un ensemble de faits qui permet de comprendre et de prévoir le comportement de quelque chose. Elle est basée sur des concepts et des principes qui ont été établis par la recherche et l'observation.
La pratique est l'application de la théorie dans la vie réelle. Cela peut être l'utilisation d'une technique ou d'une méthode qui a été développée en théorie pour résoudre un problème ou atteindre un objectif.
Un modèle est une représentation simplifiée d'une réalité complexe, qui permet de comprendre et de prévoir le comportement de cette réalité. Un modèle peut être mathématique, physique ou conceptuel et il peut être utilisé pour illustrer une théorie ou une pratique.
Mon commentaire : La définition de "modèle" est acceptable, et les trois fonctions qui lui sont assignées sont correctes dans les sciences exactes (fonctions cognitive, prévisionnelle et pédagogique, respectivement), même s'il y en a d'autres (Bernard WALLISER, dans Systèmes et modèles. Introduction critique à l'analyse de systèmes, 1977, en signale huit différentes: cf. sur mon site le Document 014). En ce qui concerne la DLC, cependant, cette réponse est
- en partie erronée: la pratique n'y est pas l'application de la théorie (cette idée est celle de l'applicationnisme théorique - linguistique et cognitif -, dépassé en France dans la discipline, en principe, depuis un demi-siècle, depuis le début des années 1970);
- en partie insuffisante: ce qui intéresse, du point de vue de la réflexion épistémologique en DLC, ce n'est pas la définition de chaque notion, mais la relation entre elles. Il est vrai que ma question n'orientait pas vers une mise en relation.
D'où une nouvelle question de ma part, plus précise:
Ma question : Quelle est la relation entre théorie, pratique et modèle en didactique des langues-cultures?
Sa réponse : En didactique des langues-cultures, la théorie, la pratique et le modèle sont également liés.
La théorie en didactique des langues-cultures peut être comprise comme un ensemble de concepts et de principes qui ont été développés pour comprendre et expliquer le processus d'apprentissage d'une langue et de sa culture. La pratique en didactique des langues-cultures est l'application de ces théories pour enseigner et apprendre une langue et une culture.
Un modèle en didactique des langues-cultures peut être utilisé pour illustrer une théorie ou une pratique d'enseignement et d'apprentissage. Par exemple, un modèle d'acquisition de la langue peut être utilisé pour expliquer comment les apprenants acquièrent une langue et comment l'enseignement peut influencer cet apprentissage. Un modèle de planification de l'enseignement peut être utilisé pour guider l'élaboration de programmes et de leçons.
En résumé, la théorie, la pratique et le modèle sont étroitement liés en didactique des langues-cultures, et ils peuvent être utilisés de manière complémentaire pour comprendre et améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues et de leurs cultures.
Mon commentaire : On retrouve les mêmes éléments de réponse qu'à la question générale précédente, avec pour les modèles la fonction pédagogique mise en avant (illustrer, expliquer) et une nouvelle fonction, la fonction normative ("guider l'élaboration de programmes et de leçons"), sans doute parce que l'IA prend en compte le terme "didactique" précisé dans la question.
Cette réponse reprend l'idée de relation entre théorie, pratique et modèle exprimée dans la question. Elle ajoute l'idée de relation étroite parce que complémentaire, ce qui montre, je pense, qu'elle a elle-même relié la DLC aux Sciences humaines. Par contre, la seule indication concernant le mode de complémentarité, qui est la même que dans la réponse à la question générale précédente, est clairement erronée en ce qui concerne la DLC: la pratique n'y est pas une simple application de la théorie; et le modèle y a un statut particulier, central, en tant qu'interface entre la théorie et la pratique.
J'ai formulé deux autres questions permettant à l'IA de préciser le statut des modèles par rapport à la pratique et à la théorie.
Question 1 : Quel est l'avantage des modèles par rapport à la pratique dans le domaine de l'enseignement?
Sa réponse : Il y a plusieurs avantages à utiliser des modèles pour comprendre ou agir sur le processus d'enseignement et d'apprentissage, par rapport à l'utilisation de la pratique seule.
Tout d'abord, un modèle peut être utilisé pour comprendre les mécanismes sous-jacents à l'enseignement et à l'apprentissage. En effet, en représentant de manière simplifiée les éléments les plus importants de ces processus, un modèle peut permettre de mieux comprendre comment ils fonctionnent et quels sont les facteurs qui les influencent. Cela peut être utile pour identifier les points forts et les points faibles de l'enseignement et de l'apprentissage et pour en améliorer l'efficacité.
Deuxièmement, un modèle peut être utilisé pour prévoir le résultat de l'enseignement et de l'apprentissage, ce qui peut être utile pour prendre des décisions en conséquence. Par exemple, un modèle de prédiction de l'apprentissage peut être utilisé pour évaluer le niveau d'apprentissage des élèves et pour adapter en conséquence les méthodes d'enseignement.
Enfin, un modèle peut être utilisé pour tester et valider une pratique d'enseignement et d'apprentissage. En effet, en comparant les prédictions d'un modèle basé sur une pratique à des observations de la réalité, on peut vérifier si cette pratique est efficace ou non. Si les prédictions du modèle correspondent aux observations, cela peut renforcer la validité de la pratique. Si elles ne correspondent pas, cela peut montrer que la pratique est insuffisante ou inefficace, ce qui peut alors inciter à la réviser ou à en développer de nouvelles.
En résumé, les modèles peuvent être utiles pour comprendre et prévoir le résultat de l'enseignement et de l'apprentissage, et pour tester et valider les pratiques d'enseignement et d'apprentissage.
Question 2 : Quel est l'avantage des modèles par rapport aux théories en didactique des langues-cultures?
Sa réponse : Il y a plusieurs avantages à utiliser des modèles pour comprendre ou agir sur le processus d'enseignement et d'apprentissage des langues et de leurs cultures, par rapport à l'utilisation de théories seules.
Tout d'abord, un modèle est une représentation simplifiée d'un phénomène complexe, ce qui peut rendre la compréhension de ce phénomène plus facile. En effet, un modèle peut représenter de manière claire et concise les éléments les plus importants d'un processus d'enseignement et d'apprentissage des langues et de leurs cultures, ce qui peut être utile pour comprendre comment ce processus fonctionne et quels sont les facteurs qui l'influencent.
Deuxièmement, un modèle peut être utilisé pour prévoir le résultat de l'enseignement et de l'apprentissage des langues et de leurs cultures, ce qui peut être utile pour prendre des décisions en conséquence. Par exemple, un modèle de prédiction de l'apprentissage d'une langue peut être utilisé pour évaluer le niveau d'apprentissage des élèves et pour adapter en conséquence les méthodes d'enseignement.
Enfin, un modèle peut être utilisé pour tester et valider une théorie en didactique des langues-cultures. En effet, en comparant les prédictions d'un modèle basé sur une théorie à des observations de la réalité, on peut vérifier si la théorie est valide ou non. Si les prédictions du modèle correspondent aux observations, cela peut renforcer la validité de la théorie. Si elles ne correspondent pas, cela peut montrer que la théorie est insuffisante ou erronée, ce qui peut alors inciter à la réviser ou à en développer de nouvelles.
En résumé, les modèles peuvent être utiles pour comprendre et prévoir le résultat de l'enseignement et de l'apprentissage des langues et de leurs cultures, et pour tester et valider les théories en didactique des langues-cultures. Ils peuvent ainsi contribuer à améliorer l'efficacité et la pertinence de l'enseignement
Mon commentaire : L'IA a clairement mobilisé, pour les deux comparaisons, l'épistémologie des sciences exactes, où les modèles permettent de prouver l'efficacité de telle ou telle dispositif, et même de valider ou invalider telle ou telle théorie. En didactique des langues-cultures comme dans les sciences humaines, les facteurs en jeu dans toute pratique, en particulier les facteurs environnementaux, sont trop nombreux et décisifs pour parvenir à des conclusions certaines.
J'ai fait une dernière expérience de la fiabilité des réponses de ce chatbot à la suite d'une réponse qui m'a été posée le 12/01/2023, à l'adresse contact de mon site, par un étudiant en didactique des langues-cultures. J'ai d'abord répondu moi-même, et j'ai ensuite demandé au chatbot de répondre.
Question de l'étudiant :
La didactisation et la transposition didactique, on peut les considérer comme des synonymes?
Ma réponse personnelle :
Non, ce ne sont pas des synonymes. On peut par contre considérer que le recours à la transposition didactique se base sur l'idée que la didactisation des documents doit s'inspirer le plus directement possible des théories (en l'occurrence celles concernant la langue, la culture, la psychologie de l'apprentissage ou la pédagogie), et que ses procédés peuvent être de ce fait un moyen de didactiser les documents de manière plus "scientifique".
Pour une réflexion théorique sur cette question du point de vue de la discipline didactique, c'est-à-dire opposé à la transposition didactique (parce que celle-ci impose une relation hiérarchique entre les sciences et la didactique), cf. mon essai 2015a (il y a un chapitre sur la transposition didactique).
Sophie Moirand, il y a longtemps, a proposé un recours aux théories linguistiques qui est une version "faible" de la transposition didactique, et qui me semble toujours acceptable parce que c'est l'enseignant qui finalement conserve la maîtrise du mode de recours aux descriptions linguistiques: https://www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/056/.
J'ai posé la même question sur le chatbot GPT3, sous deux formes différentes :
Ma question 1 : Peut-on considérer comme synonymes la didactisation et la transposition didactique en didactique des langues?
La réponse générée par l'IA : La didactisation est généralement considérée comme le processus de création d'un enseignement spécifique pour un domaine donné, tandis que la transposition didactique est le processus de traduction des connaissances d'un domaine à un autre. En didactique des langues, la didactisation implique généralement la création de méthodes et de matériels d'enseignement pour une langue spécifique, tandis que la transposition didactique concerne la manière dont ces méthodes et matériels sont adaptés pour s'adapter à des contextes d'apprentissage spécifiques. Il est donc possible de considérer les deux comme étant liés mais pas synonymes.
J'ai un peu modifié la question.
Question 2 : Peut-on considérer que la didactisation et la transposition didactique sont des synonymes en didactique des langues ?
La réponse générée par l'IA :
Non, on ne peut pas considérer la didactisation et la transposition didactique comme des synonymes en didactique des langues. La didactisation est le processus de création d'un enseignement spécifique pour une langue, tandis que la transposition didactique est le processus d'adaptation de cet enseignement pour s'adapter à des contextes d'apprentissage spécifiques. Les deux termes décrivent des processus différents, même si ils peuvent être liés et complémentaires dans le développement d'un enseignement efficace en didactique des langues.
Mon commentaire :
On retrouve, dès que les questions sont à peu près équivalentes, les mêmes "éléments de langage" dans les réponses, ce qui n'est certes pas critiquable en soi. Par contre, le sens donné par l'IA à "didactisation" n'est pas valable en DLC, parce qu'il y est limité au traitement des documents. De même, le sens que donne l'IA à "transposition" est trop large, parce qu'en didactique générale (plus précisément, à l'origine, en didactique des mathématiques), il est limité à la transposition des savoirs (on parle de "transposition des savoirs savants aux savoirs enseignables"). Je n'irai pas jusqu'à reprocher à l'IA de ne pas connaître ma position sur l'inadéquation du concept de "transposition didactique" à la didactique des langues, l'objectif n'y étant pas des savoirs, mais des savoir-faire; les savoirs sur la langue, grammaticaux ou lexicaux, n'y sont que des moyens au service des savoir-faire : savoir comprendre des documents, savoir communiquer et savoir agir socialement, pour reprendre les savoirs de référence des trois dernières configurations didactiques, à savoir la méthodologie active, l'approche communicative et la perspective actionnelle.
Mes conclusions forcément très provisoires et pour l'instant seulement basées sur la seule intuition personnelle, sont les suvantes :
- La qualité de l'écriture de l'IA va certainement fasciner les étudiants, et intéresser tout particulièrement les étudiants étrangers en didactique du FLE, qui sont souvent en insécurité linguistique. Ils savent déjà, ou sauront vite, qu'il existe aussi des logiciels générant automatiquement des paraphrases, qu'ils pourront faire tourner sur les réponses de l'IA...
- Les réponses sont toujours données de manière générale, sans exemples concrets: cette absence, si elle se retrouve dans des copies d'étudiants, sera certainement un indice de recours à un chatbot.
- Les enseignants universitaires déjà confrontés à l'usage de l'IA par leurs étudiants (l'un d'eux témoignait récemment qu'il avait repéré sur un devoir que la moitié de ses étudiants y avaient eu recours...) ont noté que, tout autant voire plus que les contenus des réponses, c'est la structure très standardisée des réponses qui avait attiré leur attention: on peut effectivement le constater très clairement sur les réponses de l'IA que j'ai transcrites ici.
- Les réponses de l'IA sont "datées" historiquement et ne correspondent pas, en DLC du moins, aux évolutions des deux dernières décennies.
- Certaines réponses partent d'une définition de concepts qui n'est pas celle qui a cours en DLC (la "transposition didactique"), ou qui est trop générale pour être pertinente (la "perspective actionnelle"). L'IA ne sait pas dire qu'elle comprend la question générale mais ne connaît pas la réponse en contexte. Or la connaissance, comme l'a souvent écrit Edgar Morin, consiste aussi à connaître et reconnaître les limites de sa connaissance ; la compétence consiste aussi à connaître et reconnaître son incompétence.
- Ce qui est encore le plus gênant, par rapport à ma conception de la DLC (mais c'est je pense celle de tous les didacticiens universitaires, quelle que soit leur discipline), c'est l'absence de problématisation : l'IA est programmée pour donner des réponses, et elle va les chercher dans son énorme base de données, mais elle ne questionne pas la question (si elle ne l'a pas comprise, c'est le questionneur qu'elle questionne), ... et bien sûr elle ne se questionne pas elle-même (pour cela, il faudrait qu'elle ait une conscience).
- Il me semble évident malgré tout que le recours à ce chatbot d'OpenAI a dès à présent toute sa place en formation, mais seulement une fois que les étudiants maîtriseront les concepts didactiques parce qu'ils les auront utilisés eux-mêmes pour leurs premières recherches. Ils auront alors les moyens d'illustrer les réponses du chatbot ou de les critiquer, et la pertinence de leurs illustrations ou de leurs critiques fournira certainement à leur formateurs de bons éléments d'évaluation de leur compétence en DLC.
- De toutes manières, la plupart des étudiants (et je fais le pari que tous les étudiants étrangers) utiliseront les chatbots. Alors la seule solution raisonnable sera d'entraîner les étudiants à leur utilisation, comme on entraîne depuis longtemps les collégiens à l'utilisation des dictionnaires : des questions reformulées, ou plus précises, ou plus contextualisées, permettent par exemple, en comparant les réponses, de repérer les limites de l'IA en se donnant l'occasion de mobiliser ses propres connaissances et réfléchir, puis de produire par soi-même.
Christian Puren 17 01 2023
Complément en date du 23 janvier 2023
Le site 01net, sous le titre "Cinq astuces pour obtenir de meilleurs réponses avec ChatGPT", donne quelques conseils aux utilisateurs (23 01 2023). Voici quelques remarques à propos de ces conseils, au vu des premières expériences personnelles que j'ai pu faire avec ce chatbot :
1. Ajoutez du contexte
Conseil particulièrement pertinent en DLC étant donné sa logique fortement contextuelle.
2. Soyez précis et concis dans votre demande
Un étudiant en DLC ne connaît pas forcément les questions précises à poser, et donc son objectif, avant d'avoir la réponse, doit être de parvenir à poser les bonnes questions... c'est-à-dire de "problématiser"! Il faut donc, après avoir suivi le conseil n° 1, qu'il lise ensuite les réponses du Chatbot d'abord et avant tout pour essayer d'en induire des questions plus précises ou plus pertinentes.
3. Demandez-lui de développer si vous trouvez sa réponse incomplète.
4. Demandez à ChatGPT de reformuler sa réponse.
Je pense que la plupart du temps, étant donné les réponses très générales et pas toujours d'actualité que propose le Chatbot, ainsi que sa tendance à reprendre les mêmes éléments de langage, ce sont vraiment les conseils n° 1 puis à la suite le conseil n° 2 tel que je l'ai modifié ci-dessus, qu'il faut suivre en priorité.
5. Demandez à ChatGPT de formater les réponses ou de répondre avec un style spécifique.
Ce conseil suppose que l'on veuille utiliser telles quelles les réponses du Chatbot, ou du moins certaines parties. Je pense vraiment que c'est à éviter de la part de ceux qui seront le plus tentés de le faire, qui sont les étudiants en insécurité linguistique quant à la correction de leur français écrit. Ne serait que parce que ce sont eux qui se feront facilement et immédiatement repérer par l'enseignant s'ils copient-collent une partie des réponses du Chatbot...
Christian Puren, 23 01 2023
Ajouts en date du 14 06 2023
1. Signalée par le site du Café pédagogique le 13 juin 2023, une liste de conseils publiée par l'Université du Québec à Montréal (UQAM), intituliée "10 stratégies Pour éviter le plagiat lors de l'utilisation d’un agent conversationnel (ChatGPT) dans les évaluations." Elle me paraît très pertinente, et pouvoir enrichir la réflexion des étudiants sur cet outil par la perspective adoptée ici, qui est celle des enseignants.
2. Signalée par le site liseo.france-education-international.fr/, la publication par le CAVILAM-Alliance française de Vichy d'une série de fiches pratiques "pour faire de l’IA le meilleur assistant pédagogique des enseignants".
Innovation, piège à... ?
Sur le site du quotidien français Libération, le pédagogue Philippe Meirieu signe, en date du 16 novembre 2022, une tribune intitulée "Les paradoxes de l'innovation scolaire". Il me semble que les idées qu'il y défend dans une perspective de pédagogie générale appliquée à l'ensemble de l'enseignement scolaire français, complètent utilement les réflexions que j'ai régulièrement menées pour ma part sur l'innovation en général et l'innovation technologique en particulier dans l'enseignement des langues-cultures.
Ph. Meirieu constate que "toute innovation ne constitue pas un progrès", qu'elle permet aux institutions "de donner à voir, grâce à quelques belles vitrines de luxe, un image "innovante" de leur fonctionnement quand, par ailleurs, elles abandonnent une partie de leurs acteurs dans des situations archaïques et misérables". Il pointe cette particularité à première vue surprenante de l'Education nationale française, qui est le paradoxe qu'elle offre, constant dans l'histoire, entre l'affichage officiel du soutien à l'innovation, et les réticences vis-à-vis de l'innovation sur le terrain : "Alors que le discours officiel - du plus haut sommet de l'État aux plus petites circonscriptions - exalte l'innovation, les pratiques quotidiennes de la hiérarchie en freinent systématiquement la mise en oeuvre." L'une de ses conclusions est qu'"il faut se dégager de l'obsession maladive pour la nouveauté des modalités, et y substituer un travail collectif sur la pertinence de celles-ci au regard des finalités que l'on vise. Innover pourquoi ? Pour qui ? Pour aller où ensemble demain ?"
Cf. par exemple, en ce qui concerne mes propres publications :
- "Innovation didactique et innovation technologique en didactique des langues-cultures: approche historique", version française 2022c, version anglaise 2022c-en.
- "La problématique de l'"innovation" en didactique des langues-cultures. Proposition de modélisation conceptuelle", original français 2021e, version anglaise 2021e-en.
- "Innovation et changement en didactique des langues-cultures", 2018c.
- "La didactique des langues-cultures face aux innovations technologiques : des comptes rendus d’expérimentation aux recherches sur les usages ordinaires des innovations", 2016d.
- "Que reste-t-il de l'idée de progrès en didactique des langues ?", original français 1997d, version anglaise 1997d-en.
A propos de l'appellation "didactique des langues-cultures"
Dans mon essai "Modélisation, types généraux et types didactiques de modèles en didactique complexe des langues-cultures" (2022f), je défends la légitimité de l'expression "langues-cultures" dans l'appellation disciplinaire "didactique des langues-cultures" par le fait qu'il s'agit d'un modèle à deux éléments résultant d'une modélisation du champ disciplinaire. Et j'analyse ainsi la réticence voire l'opposition frontale de certains didacticiens à la reprendre :
Le fait qu’il y ait des usages de la langue où l’on s’efforce de neutraliser tout aspect de culture sociale, comme dans la communication scientifique, n’invalide pas plus le modèle « langue-culture » que le fait que parfois, en classe de L2, l’enseignant passe à la L1 pour expliquer un point de culture uniquement dans cette langue, neutralisant ainsi la L2. Le modèle « langue-culture » est renforcé au contraire par le fait qu’il permet d’appréhender la relation didactique langue-culture dans toute sa complexité, qui intègre les cas de neutralisation de l’un ou l’autre de ses éléments.
Juger que l’existence de la communication scientifique ou de l’anglais langue de communication internationale invalide l’expression proposée en son temps par Robert Galisson, « didactique des langues-cultures », est donc aussi erroné que juger que le zéro ne fait pas partie de la série des nombres entiers naturels, alors qu’il est conçu depuis le Ve siècle comme un « nombre nul ». La modélisation a été inventée et développée par des scientifiques : la culture scientifique très limitée qu’ont beaucoup de spécialistes en DLC explique sans doute en partie leur rejet naïf du modèle « langue-culture » comme représentation de l’objet central de leur discipline (chap. 3.1.3, p. 12).
L’expression de « didactique des langues et des cultures » (par rejet implicite, chez beaucoup de ses utilisateurs, de celle de « didactique des langues-cultures) me semble aussi curieuse, et aussi inadéquate parce réduisant la complexité au cœur même de la discipline, que celle de « problématique d’enseignement et d’apprentissage ».
Je pense que malheureusement, comme sur l'autres idées que j'ai avancées en opposition avec la doxa didactique (en particulier l'insuffisance de la notion d'"interculturel" et de celle de "représentations" ; la nécessité de passer de la notion d'éclectisme à celle de didactique complexe ; la rupture entre l'approche communicative et la perspective actionnelle dès que l'on prend sérieusement en compte les implications de cette dernière), aucun de ces didacticiens n'entrera dans un débat public arguments contre arguments.
Christian Puren
Publication d'un compte-rendu de mon Essai sur l'éclectisme (1994)
- La Revue Marocaine d'Evaluation & de la Recherche Educative a publié dans son numéro spécial 2022 un article de Khadija EL HARTI, de la Cellule TEC et Gestion, Faculté des Sciences et Techniques de Fès (Maroc), intitulé "La Didactique des Langues Étrangères à la croisée des méthodes. Compte-rendu de lecture en hommage au professeur émérite M. Christian PUREN". Liens directs vers l'article : sur le site de la revue ou lien DOI. Il s'agit d'un compte-rendu de mon Essai sur l'éclectisme de 1994.
Trois formes de perception prioritaire de l'interculturalité : les différences, les ressemblances et les communs
Dans un article intitulé "Pourquoi prenons-nous parfois les robots pour des humains" publié le 29 août 2022 sur le site TheConversation.com, l'auteur, chercheur à l'Istituto Italiano di Tecnologia de Gênes, écrit :
_____________________
Une récente étude nous avons montré que [...] des participants coréens/japonais et allemands/états-uniens attribuaient le même niveau de capacités cognitives, émotionnelles et intentionnelles à un robot, mais au travers de processus sociocognitifs sensiblement différents.
Pour les participants coréens et japonais, l’important est de constater le partage d’une caractéristique commune avec le robot à juger. La logique est la suivante : puisque nous partageons une essence, une « quiddité », alors nous partageons peut-être des capacités cognitives, émotionnelles ou intentionnelles. Le résultat est un anthropomorphisme du robot basé sur la constatation de ressemblances.
Les participants occidentaux se comparent en fait avec le robot. Plus le robot est considéré comme éloigné de l’observateur, moins il est considéré comme possédant des capacités cognitives, émotionnelles ou intentionnelles. Ici, on serait plus proche d’un « égomorphisme » basé sur la recherche de différences, c’est-à-dire l’attribution au robot des caractéristiques du prototype de ce qui définit un humain… ce prototype étant l’observateur lui-même.
____________________
Il serait intéressant de vérifier - c'est une hypothèse vraisemblable - si les mêmes mécanismes cognitifs différents s'exercent dans le cas d'un autre type de reconnaissance, celle des humains vis-à-vis d'autres humains. C'est-à-dire, concrètement, de vérifier si l'interculturel, qui est en Europe le domaine de la reconnaissance des différences (l'une des finalités de l'éducation interculturelle dans l'enseignement des langues en Europe est le respect des différences) n'est pas plus orienté en Asie vers la reconnaissance des ressemblances.
Ce n'est peut-être pas un hasard si l'un des philosophes très connus qui mettent actuellement l'accent sur le thème des "communs", François Jullien, est un sinologue français qui propose avec ce concept de dépasser l'alternative entre différences et ressemblances : pour lui, l'important est ce que l'on partage avec les personnes d'autres cultures. L'avantage à ses yeux des "communs" par rapport tant aux "ressemblances" qu'aux "différences" est qu'ils ne mettent pas en jeu les identités, et donc permettent d'évlter le culturalisme. Cf. mon billet de blog en date du 20 décembre 2016 à propos d'un nouvel ouvrage de F. Jullien intitulé Il n'y a pas d'identité culturelle (Éd. de l’Herne, 2016), dont un résumé est repris sur la page de téléchargement de mon "modèle complexe de la compétence culturelle", 2011j.
La logique de la modélisation. A propos d'un article d'Yves Reuter, "Faire ou ne pas faire? Telle n'est pas la question pédagogique" (2020)
A propos de : REUTER Yves. 2020. "Faire ou ne pas faire? Telle n'est pas la question pédagogique", TRACeS n° 245, revue de "Pédagogies actives", mouvement pédagogique "ChanGements pour l'égalité", Bruxelles, avril 2020.
Dans ce court article, Yves Reuter rappelle les deux "thèses (qui) structurent un débat pédagogique récurrent concernant les activités scolaires", que l'on peut considérer comme deux pôles opposés, et donc relever du "méta-modèle complexe" présenté dans le document intitulé "Un méta-modèle complexe: typologie des différentes relations logiques possibles entre deux pôles opposés" (Document 022).
Tel que je définis pour ma part ces deux pôles, il s'agit d'une part de la pédagogie traditionnelle transmissive (le savoir est transmis par l'enseignant), d'autre part de la pédagogie constructiviste de l'autre (le savoir est construit par l'apprenant lui-même). Il juge que les étiquettes souvent utilisées, "(pédagogie) passive", et "(pédagogie) active", ne conviennent pas, faisant remarquer avec raison que "dans les pédagogies les plus classiques, l’élève est incité à être attentif, écouter, prendre des notes, faire des exercices, réviser, restituer…".
Deux affirmations, par contre, me paraissent discutables lorsqu'il s'efforce de nuancer l'opposition entre ces deux pôles :
- "(...) tout savoir est construit, il est impossible d'apprendre sans rien faire". La deuxième partie de cet énoncé renvoie à la citation précédente: on peut considérer effectivement qu'en pédagogie traditionnelle l'élève est incité à faire (au minimum à apprendre, puisque l'enseignant enseigne...). De là à considérer qu'il "construit" son savoir, il y a un grand pas difficile à faire, sauf à réduire à ce point l'idée de construction du savoir par l'èlève telle que développée par la théorie constructiviste, que l'on finit par jouer sur des sens très différents du même mot.
- Lorsqu'il ajoute à la suite que "toute pédagogie suppose la mise en œuvre, de la part de l’enseignant, d’un ensemble d’actions visant à susciter chez les élèves un ensemble d’activités", on pourra lui faire remarquer que c'est là la définition même de la pédagogie moderne telle que la définit Gabriel Compayré dans son Histoire critique des doctrines de l'éducation en France depuis le XVIe siècle (Paris : Hachette, 2e éd. 1880, T. 1, 460 p.):
L’âme n’est pas une matière inerte qui se laisse façonner comme on l’entend, qui obéit passivement à tout ce qu’on entreprend sur elle : loin de là, elle réagit sans cesse, elle mêle son action propre à celle du maître qui l’instruit. (p. 383)
Ce pédagogue aurait certainement été surpris de voir son idée reprise pour définir "toute pédagogie", y compris la pédagogie traditionnelle. La pédagogie (vraiment) traditionnelle, celle en vigueur jusqu'à la fin du XIXe siècle en France, avant l'arrivée des "méthodes actives", ne fait assurément pas partie de ces "pédagogies les plus classiques" telles que les décrit Reuter.
Qu'en réalité tout élève au minimum sélectionne et recombine le savoir transmis par le maître n'empêche pas que l'enseignant traditionnaliste considérait que l'élève n'avait qu'à bien l'écouter de manière à être capable de bien restituer les connaissances qu'il lui transmettait : on ne définit pas une pédagogie seulement par l'activité réelle des élèves, mais aussi par ses principes.
Le passage suivant, à la suite de ce texte de Reuter, mérite d'être cité in extenso:
"(...) il me paraît indispensable de sortir d’oppositions présentées comme irréductibles. Pour ce faire, il est intéressant de penser les pratiques comme des modalités pédagogiques possibles au sein d’un continuum entre deux pôles : à savoir et pour schématiser, la pédagogie magistrale-transmissive et les pédagogies « différentes » (3). Ces pôles actualisent des dimensions à la fois constitutives et en tension des pratiques pédagogiques : contrôle ou autonomie des élèves, compétition ou coopération, évaluation sommative ou évaluation formative… En d’autres termes, les pratiques n’existent pas sans l’une et sans l’autre de ces dimensions, quelles que soient les formes d’équilibre-déséquilibre entre elles. Par voie de conséquence, penser les modalités d’articulation de ces dimensions pourrait permettre de mieux rendre compte de la complexité des pratiques effectives qui ne sont quasiment jamais situées de manière absolue sur l’un ou l’autre pôle. Elles sont en général métissées dans la mesure où les enseignants les ajustent en fonction des élèves considérés, des moments du cursus et des disciplines.
______________
(3) Je ne prends pas en compte ici, ce qui est très discutable, la diversité des pédagogies différentes."
Voici les trois principales remarques que me suggère ce passage en ce qui concerne cet outil privilégié de la réflexion didactique qu'est la modélisation.
1. On se demande pourquoi l'auteur s'est évertué à atténuer la distinction entre les deux pôles. Dans la logique de la modélisation, il faut créer deux oppositions franches, même abstraites - en l'occurrence, les pédagogies transmissive et constructiviste - ce qui justement amène à définir celles-ci en fonction de leurs principes -, de manière à pouvoir ensuite positionner les pratiques réelles sur le continuum. Si, comme l'écrit l'auteur, "dans les pédagogies les plus classiques, l’élève est incité à être attentif, écouter, prendre des notes, faire des exercices, réviser, restituer…", cela veut dire tout simplement que ces pédagogies ne sont pas, dans leurs pratiques réelles, "situées de manière absolue" sur le pôle traditionnaliste.
2. On se demande aussi pourquoi l'auteur ne pourrait pas prendre en compte "la diversité des pédagogies différentes" (note 3) : son modèle permet de le faire d'une phrase, par laquelle il signalerait qu'elles se positionnent à des endroits différents du continuum. Mais il lui aurait fallu caractériser le pôle opposé au pôle traditionnaliste autrement que par l'expression de "pédagogies différentes", qui ne le satisfait pas lui-même. Il aurait suffi pour cela de réserver le concept de "construction (des savoirs par l'élève)" à ce pôle, en le prenant dans sa version la plus forte, celle de la théorie constructiviste, au lieu, en quelque sorte, de l'"étaler" sur le continuum.
On retrouve dans les deux cas la même atteinte à la logique de la modélisation, laquelle consiste en une simplification assumée qui permet ensuite de reconstituer la complexité ; l'auteur, au contraire, veut intégrer de la complexité au sein même des pôles, alors que c'est justement la fonction du mode du continuum, qu'il propose lui-même, de l'intégrer au sein de cet espace intermédiaire. "Faire ou ne pas faire" n'est peut-être pas la question pédagogique, mais c'est la question modélisatrice.
3. On aura reconnu sans peine, dans la modélisation de la relation entre les deux pôles proposée par Reuter, ce mode de mise en relation des deux pôles opposés qu'est le continuum. Ce mode permet effectivement "de mieux rendre compte de la complexité des pratiques effectives". Mais la complexité réelle exige de penser la relation entre ces deux pôles selon bien d'autres modes. Dans mon "méta-modèle" complexe dont j'ai rappelé les références au début du présent texte, j'en décrivais six autres : l'opposition, l'évolution, le contact, la dialogique, l'instrumentalisation et l'encadrement.
La proposition éducative de Richard RORTY : s’appuyer sur la découverte interculturelle pour faire reconnaître le transculturel
Richard RORTY (1931-2007), philosophe pragmatiste anglo-saxon, fait partie de mes quatre principales références épistémologiques (cf. "Les quatre références épistémologiques d'une didactique complexe des langues-cultures", Document 048). L’auteur d’un compte-rendu d’un recueil récemment publié de quelques-unes de ses conférences commente ainsi une conférence de 1996 [1] :
Pour Rorty, la fonction de l’éducation est de socialiser de jeunes générations de façon à éviter qu’elles développent un « moi psychopathe » et à les amener à se montrer capables de reconnaître comme des semblables la part d’humanité la plus large possible. Pour Rorty, le développement de cette reconnaissance inclusive n’est pas quelque chose que l’on pourrait s’obtenir par l’argumentation : ce n’est pas avec des arguments que nous pourrons rendre plus inclusifs les antisémites, les racistes ou les homophobes. Ici, la raison ne suffit pas. Pour devenir plus inclusif, il faut être mis dans une situation amenant à reconnaître – on pourrait même dire à sentir – que telle ou telle catégorie de personne est semblable à nous. Le dispositif pédagogique que Rorty favorise pour mettre les étudiants dans de telles situations consiste à leur faire lire des récits écrits à la première personne – comme Le journal d’Anne Frank, Black Boy ou Le mystère du lac – des récits leur permettant d’être témoins de ce que vivent les juifs, les noirs ou les homosexuels et de sympathiser avec eux (p. 79).
Si j'interprète cette proposition au moyen de mon modèle des composantes de la compétence culturelle (2011j & Document 020), je dirai que R. Rorty s’appuie sur la découverte des différentes, i.e. l’interculturel, mais ce n’est pour lui qu’un moyen pour faire reconnaître le transculturel.
______________________
[1] PEUCH Benoît, « À bas l’autorité ! À propos de : Richard Rorty, Pragmatism as Anti-Authoritarianism, Belknap Press, 2021, 272 p., 21 octobre 2021.
Le goût de la découverte dans la recherche en didactique des langues-cultures
La petite anecdote suivante m'a fait sourire, parce qu'elle me rappelle ce qui m'est souvent arrivé après avoir eu l'impression d'avoir trouvé une idée vraiment "nouvelle" dans la recherche dans ma discipline (voir le dernière paragraphe de la citation ci-dessous) :
______________________
L’euphorie de la découverte
J’ai eu la chance d’expérimenter l’euphorie de la « découverte » mathématique assez tôt pendant mes études.
Dans le cadre d’un « projet encadré », je me suis retrouvé à étudier mathématiquement les solutions d’un petit jeu de société. Après quelques recherches sur Internet, j’en étais venu à la conclusion que personne n’avait vraiment étudié ce problème, il allait donc falloir que je fasse quelque chose de complètement nouveau.
Après plusieurs semaines à tourner en rond, rien ne marchait. J’y pensais tout le temps, dès que mon esprit était libre, il fallait qu’il se retourne vers ce problème. Au bout d’un moment, comme un déclic : « Et si… ? » Sans même me lever de mon lit, j’écris rapidement ce que j’avais en tête, et… ça marche ! Quelle euphorie de résoudre un problème sur lequel on planchait depuis si longtemps, et surtout, que personne n’avait encore jamais attaqué !
Bon, j’ai aussi découvert plusieurs années après que ce jeu avait en fait été étudié sous tous les angles depuis de nombreuses années, et que ce que j’avais fait n’avait absolument rien de nouveau. Mais tant qu’on ne sait pas que ça existe déjà, toute trouvaille a le goût de la découverte.
MOULOT Etienne, "Mathématicien, je cherche des émotions plus que des équations", The Conversation 17 octobre 2021.
___________________________
Sinon l'"euphorie", du moins le "goût" de la découverte perdure lorsque l'idée, même si elle n'est pas nouvelle en philosophie, en épistémologie, en psychologie, en sociologie, etc., est introduite pour la première fois en didactique des langues et y produit des effets de connaissance.
Christian Puren, 14 novembre 2021
A propos de l'efficacité des inspections dans l'enseignement secondaire français
Suite à la publication d'un ouvrage (d'un inspecteur...) célébrant, statistiques à l'appui, l'efficacité des inspections dans le secondaire (Éric Maurin, Trois leçons sur l'école républicaine, Seuil, 2021), on lira avec intérêt les critiques pertinentes de François Jarraud sur le site du Café pédagogique, dans un article intitulé ironiquement "Les inspecteurs vont-ils sauver l'École ?".
Il publie à la suite une interview de l'auteure d'une thèse intitulée Activité de jugement des inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et développement de l’activité professionnelle en entretien d’inspection dans le système éducatif français : règles, jeux de langage, et conflits d’une activité dialogique pluri-adressée (VOISIN-GIRARD Bernadette, Université de la Réunion, vendredi 27 novembre 2020, teléchargeable en ligne).
Le lien vers le présent billet de blog a été ajouté, sur mon site, sur la page de téléchargement de l'analyse détallée que j'avais faite d'un rapport au ministre de l'éducation nationale rédigé par trois inspecteurs généraux (2013j). Ce qui apparaît de commun dans ce rapport et dans cet ouvrage, c'est une capacité de l'inspection générale à s'autopromouvoir inversement proportionnelle à la capacité à s'autoanalyser de manière critique.
La recherche interventionnelle, indispensable pour assurer l'implémentation durable des réformes ou innovations
TUA Marina, Lire et apprendre au collège : lire et apprendre au collège: évaluation d’un dispositif de remédiation des difficultés de lecture en 6e, thèse Université de Grenoble, 30 octobre 2020. Disponible en ligne.
Cette thèse porte sur l'utilisation à grande échelle d'un dispositif d'amélioration d'un dispositif de remédiation conçu à partir des recherches universitaires sur la question, et censé améliorer la lecture fluide. Le dispositif était lourd, puisqu'il comportait, pour les élèves, 12 séances de 55 minutes d'entraînement à la lecture fluide), 24 séances de 55 minutes sur la capacité à effectuer des inférences, et pour les enseignants, une formation spécifique.
Le résumé, après la présentation du dispositif, reprend la conclusion de la thèse (p. 191):
Cette thèse a pour objectif de définir un dispositif lecture efficace et transférable destiné aux élèves de sixième repérés en difficulté de lecture, de le mettre en place et de mesurer son efficacité dans plusieurs collèges. Le dispositif comprend une évaluation des élèves, une formation des enseignants à l'enseignement explicite de la lecture et des ateliers de remédiations menés par les enseignants de toutes les disciplines sur les heures dédiées à l'aide personnalisée. Les ateliers sont construits autour d’activités visant l’amélioration de la lecture fluide (12 séances de 55 minutes) et la capacité à effectuer des inférences (24 séances de 55 minutes). Nos résultats confirment que les prédicteurs des habiletés de fluence et de compréhension en lecture sont les mêmes chez les élèves en difficulté que chez les normo-lecteurs. Essayer d’améliorer ces habiletés devraient donc améliorer la lecture et contribuer à remédier aux difficultés des collégiens. Malheureusement, les résultats relatifs à l’effet du dispositif mis en place ne permettent pas de conclure à son efficacité. En effet, les ateliers n’ont pas permis d’accélérer la progression des élèves en compréhension en lecture ou dans les habiletés spécifiquement ciblées (Fluence de texte, Inférences. On n’observe pas non plus d’amélioration dans les autres matières scolaires, ni d’effet du dispositif sur la motivation des élèves, le sentiment d’auto-efficacité des enseignants et sur les relations entre les parents et l’établissement. L’absence d’effet du dispositif contraste avec les avis recueillis auprès des personnels (principaux et enseignants) qui dans l’ensemble se sont déclarés satisfaits du dispositif et du travail proposé. Nos résultats ne sont pas isolés et viennent renforcer une base de données croissante indiquant que mettre en place un soutien supplémentaire et diffuser des outils issus de la recherche auprès des établissements, ne suffit pas pour observer des progrès tangibles. L’évaluation rigoureuse des dispositifs est nécessaire pour s’assurer de leur efficacité au moment de leur diffusion sur le terrain scolaire. Nos observations ont d’ailleurs permis de constater des difficultés d’implémentation importantes, tant dans l’organisation administrative des ateliers que dans leur compréhension et appropriation par les enseignants. Cela nous conduit à penser que la démonstration de l’efficacité d’un dispositif pédagogique à grande échelle doit tenir compte des paramètres d’implémentation qui favorisent l’engagement et l’accompagnement des enseignants afin qu’ils s’approprient les outils et les pratiques pédagogiques correspondantes. Des recherches complémentaires restent donc nécessaires pour à la fois chercher à définir un dispositif efficace et pour favoriser son implémentation à grande échelle. Les recherches actuelles sur l’implémentation nous semblent une voie prometteuse.
Ce constat final rejoint l'argumentation en faveur de la "recherche interventionnelle", qui porte précisément sur les conditions optimales, forcément variables, d'implémentation de toute réforme ou innovation. C'est sans doute celui-là, le "dispositif efficace" auquel l'auteure fait allusion en prolongement de sa recherche.
Cf. mes deux documents en ligne sur la question:
- 2019c. "La 'recherche interventionnelle' au service de la généralisation et pérennisation des réformes institutionnelles : le cas de la réforme en cours de l’enseignement des langues en Algérie." (article)
- 2020h. « Une stratégie de formation didactique des enseignants dans leurs classes : la "recherche interventionnelle" sur l'usage adéquat des manuels » (conférence vidéoscopée)
Thèse signalée sur Le site du Café pédagogique le 24 06 2021.
Un bel exemple de projet pédagogique plurilingue en classe terminale
Ce projet, signalé par le site du Café pédagogique le 7 juin, rappelle beaucoup celui que je cite souvent (cf. par ex., sur mon site, le document 053), et qui porte sur des extraits de poésie française sélectionnés, traduits en espagnol et lus dans d'autres établissements scolaires de la ville par les élèves d'un lycée français d'Amérique centrale.
Texte de présentation sur le site du lycée:
"Yoruba, araméen, créole, italien, turc, portugais, espagnol,... Des poèmes en plusieurs langues en Terminale HLP - Lycée Jean-Jacques Rousseau (ac-versailles.fr)", http://www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr/spip.php?article647 (mise en ligne 11 mai 2021)
Dans le cadre d’une séquence sur "Dire la violence", et d’un travail de lecture de textes de Gandhi et de Fanon en philosophie, les élèves de Terminale spécialité Humanités, Littérature et Philosophie ont travaillé sur des poèmes en littérature.
A travers les poèmes d’Aimé Césaire, de Léon Gontran Damas, de Toni Morrison, de Maya Angelou, d’Audre Lorde, de Gloria Anzaldua, de Kitty Tsui et de Mohja Kahf, les élèves ont réfléchi à la manière dont la violence est évoquée par les mots.
Dans une volonté de s’approprier pleinement les poèmes, les élèves ont pu :
1. sélectionner les passages jugés les plus marquants ;
2. réfléchir à la manière de mettre en voix les poèmes;
3. insérer, entre les phrases du texte, des mots ou des phrases qu’ils auraient envie d’écrire ;
4. ajouter la traduction d’un passage du poème dans une autre langue.
La "HLP", c'est une filière "Humanités, Littérature et Philosophie" que les élèves peuvent choisir en classe de fin d'études secondaires, celle qui se termine par l'examen du baccalauréat (voir le programme officiel de cette filière).
Il faut savoir aussi que dans la zone de la région parisienne où se situe le lycée beaucoup d'élèves sont de familles d'origine immigrée. On peut supposer que toutes ces langues prises en compte dans le projet sont celles d'origine de ces familles. Outre la sensibilisation à la question de la violence, il y a donc un second objectif citoyen dans ce projet, celui d'aider à une reconnaissance et à une représentation positive de l'immigration et de la diversité culturelle.
Ce projet rappelle beaucoup celui que je cite souvent, qui porte sur des extraits de poésie française sélectionnés, traduits en espagnol et lus dans d'autres établissements scolaires de la ville par les élèves d'un lycée français d'Amérique centrale, et qui me sert à monter que des projets de ce type, d'un certain niveau de complexité, amènent à mobiliser toutes les matrices méthodologiques et toutes les logiques documentaires (cf. le Document 053).
Un exemple du fonctionnement systémique du modèle des composantes de la compétence culturelle
J'ai reçu d'un lecteur de mon site, qui fait travailler ses étudiants sur les composantes de la compétence culturelle, une question concernant "la diversité culturelle et le vivre ensemble" pour laquelle ils ont comparé deux mouvements populaires protestataires, celui des Gilets jaunes en France et celui du Hirak en Algérie, en aboutissant à la conclusion de "la nécessité pour coexister pacifiquement, de respecter l'autre culture, les emblèmes de l'autre, etc." La question de ce collègue est si l'on peut "considérer ce thème comme faisant partie de la composante transculturelle ou de la composante co-culturelle".
La réponse à la question posée par ce collègue me semble une bonne illustration de ce mode de fonctionnement des modèles, et c'est pourquoi, avec son accord, je publie ci-dessous la réponse que je viens de lui envoyer, que j'ai légèrement reprise et développée.
____________________________
Votre message me permet d'illustrer de manière concrète le fonctionnement de ce "modèle" des différentes composantes de la compétence culturelle. C'est un "modèle" dans le sens qu'a ce mot lorsque l'on parle d'un "modèle systémique" (voir PUREN 014). Il ne s'agit pas de cases fixes à remplir, mais d'un mécanisme dynamique constitué d'éléments simples (les différentes composantes) que l'on va faire "fonctionner" (cf. les différentes "fonctions" du modèle dans le texte référencé ci-dessus) pour reconstituer la complexité de la réalité. Si cette réalité est complexe, c'est en particulier parce qu'elle dépend toujours fortement de l'environnement (cf. "Les composantes de la complexité (PUREN 046), et c'est pourquoi le modèle doit être réorganisé à chaque fois en conséquence.
- Dans votre projet sur "la diversité culturelle et le vivre ensemble", je suppose que la diversité culturelle est considérée comme devant être mise au service du vivre ensemble. Par conséquent ce projet est centré sur la composante pluriculturelle, qui y est la composante privilégiée. Elle relève des attitudes et comportements, comme le respect des emblèmes de l'autre, que vous citez justement en exemple.
Mais vous vous souvenez sans doute de cette "expérience mentale" que j'ai présentée dans plusieurs articles, sous cette forme ou une autre (par exemple encore tout récemment dans l'article intitulé "La compétence culturelle et ses composantes interculturelle et co-culturelle", PUREN 2021d, point 5 p. 7) :
Pour être culturellement compétent dans un travail de longue durée avec des personnes d’autres cultures, il faut impérativement :
(1) s’être créé ou avoir adopté une culture d’action commune (composante co-culturelle).
Mais cela aide aussi :
(2) de bien connaître la culture des autres (composante métaculturelle) ;
(3) d’avoir pris de la distance par rapport à sa propre culture et être attentif aux incompréhensions et mauvaises interprétations toujours possibles d’une culture à l’autre (composante interculturelle) ;
(4) de s’être mis d’accord sur des attitudes et comportements acceptables par tous (composante pluriculturelle) ;
(5) de partager des finalités et des valeurs au-delà du seul domaine professionnel (composante transculturelle).
Si vous commencez par "Pour être culturellement compétent en tant que citoyen d'une société multiculturelle...", c'est le (4) du tableau ci-dessus qui va devenir le (1) de votre nouveau tableau. C'est alors en effet, dans la compétence culturelle, la composante pluriculturelle qui est la compétence minimale requise, le "niveau-seuil de compétence culturelle nécessaire dans cette situation sociale", pour parler en termes didactiques.
Mais si vous avez une conception plus exigeante de ce que doit être une société - c'est le cas dans la philosophie politique française traditionnelle - comme un ensemble cohérent de citoyens partageant un même ensemble de valeurs qui leur permet de "faire société" ensemble, d'avoir le même "projet de société", alors il y a deux composantes privilégiées simultanément: c'est non seulement la composante pluriculturelle (pour le vivre ensemble) mais aussi et même d'abord la composante co-culturelle (pour le faire ensemble). La composante transculturelle que vous citez est dans les deux cas une aide importante (comme toutes les autres composantes, en l'occurrence les composantes trans- et métaculturelle), mais ce sont les deux premières, pluri- et co-culturelles qui sont alors "centrales" et donc "stratégiques" : ce seront par conséquent celles qui devront être affichées et visées par exemple dans des campagnes publiques de sensibilisation à la citoyenneté partagée, et dans le travail quotidien d'éducation des enseignants.
Le point d'équilibre choisi au sein de la combinaison entre le vivre (dans la même société) ensemble et le faire (société) ensemble est un élément central de tout consensus national démocratique. Dans la tradition anglo-saxonne, par exemple, ce point est beaucoup plus proche du vivre ensemble - on y admet le rôle important des "communautés" que dans la tradition française, tellement orientée vers le "faire ensemble" que le mot "communautarisme" y a une connotation négative, celle du mot plus "politiquement correct" choisi par l'actuel gouvernement français, celui de "séparatisme".
______________________________________
L’évolution des constructions méthodologiques sur le modèle d’évolution des perspectives internes de la dlc : méthodologie -> didactique -> didactologie
"8 ans après..." : préface en date du 27 octobre 2020
Le billet de Blog-Notes ci-dessous date du 16 octobre 2012 mais n'a jamais été disponible sur mon site en raison d'une erreur de date au moment de son enregistrement, et je viens seulement de m'en rendre compte. Je le republie maintenant, le 23 octobre 2020, huit ans plus tard et 20 ans après la publication du CECR, pour les deux raisons suivantes :
1) Parce que l'idée d'une évolution historique des méthodologies constituées se réalisant en parallèle avec la maturation épistémologique de la discipline « didactique des langues-cultures » (perspectives méthodologique -> didactique -> didactologique) me semble toujours pertinente : au sein des configurations didactiques qui apparaissent lorsque s'imposent un nouvel objectif social et une nouvelle situation sociale de référence (cf. le Document 029 et la première référence citée p. 3 de ce document, 2012f), les méthodologies se construisent en empruntant leurs matériaux aux modèles linguistique, cognitif, culturel et pédagogique de l'époque, mais aussi, de manière logique, en fonction de la conception du moment de la discipline, en l'occurrence en fonction de la perspective disciplinaire alors dominante : voir en fin de ce billet de blog le tableau présentant ce parallélisme.
2) Parce que dans ce billet de 2012 je faisais un certain nombre d'analyses et de prévisions concernant l'élaboration de la perspective actionnelle, sur lesquelles il est possible maintenant de faire le point :
– du point de vue rétrospectif, sur les vingt années passées depuis la publication du CECR (2001) ; il me semble possible de dégager sinon trois phases très clairement distinctes, du moins trois stratégies différentes au cours de cette élaboration telle que je peux la reconstituer à partir de mes publications tout au long de ces années,
– et du point de vue prospectif, sur les prévisions que je faisais à ce moment-là dans ce billet, ce qui s’est réellement passé, et les prévisions que je peux faire maintenant.
Ces deux points de vue sont repris dans la conclusion d'un article publié fin novembre 2020, « Retour réflexif sur vingt ans d’élaboration de la perspective actionnelle : quatre stratégies différentes », 2020f.
________________________________
Billet du 16 octobre 2012
Un collègue formateur m'a récemment écrit pour me demander si le concept de « noyau dur méthodologique » était ou non pertinent pour décrire la perspective actionnelle (et si oui, quel était-il ?). J’ai constamment utilisé en effet ce concept pour décrire les cohérences des méthodologies traditionnelle, directe, active, audio-orale et audiovisuelle. On pourra faire une recherche sur l’expression « noyau dur » dans la version numérisée d’Histoire des méthodologies (1988a) ; ou consulter la présentation des différents schémas correspondants dans l’Essai sur l’éclectisme (1994e, pp. 151-155) ; ou encore se reporter, dans mon cours « La didactique des langues comme domaine de recherche », dans le Dossier n° 2 consacré à « La perspective méthodologique » : le chapitre 2 y est consacré à ces noyaux durs (pp. 5-11), avec l’ajout d’une schématisation du noyau dur de l’approche cognitive (chap. 2.4., pp. 9-11).
On lira ci-dessous, réécrit pour l’occasion, le contenu de la réponse que j’ai faite à ce collègue, et qui m'a amené à expliciter – ce que je n'avais pas fait dans mes publications jusqu'à présent, je pense – la relation entre l'évolution des méthodologies, et celle de la discipline (du moins en ce concerne le FLE) par le passage de la perspective méthodologique, jusqu’à la fin des années 1960, à une perspective méta-méthodologique, à savoir la perspective didactique, au début des années 1970, puis au début des années 1980 à une perspective méta-didactique, à savoir la perspective didactologique.
Cette évolution a été présentée pour la première fois dans un article de 1994 intitulé « Quelques remarques sur l'évolution des conceptions formatives en français langue étrangère de 1925 à 1975 » (1994a). On pourra aussi consulter, dans mon cours « La didactique des langues-cultures comme domaine de recherche », le Dossier n° 1 intitulé précisément « Les trois perspectives constitutives de la didactique des langues-cultures ». Les lecteurs pressés ou qui veulent simplement réactiver leurs souvenirs pourront se contenter du schéma reproduit sur mon site dans la rubrique « Bibliothèque de travail », Document 002, dans lequel chaque perspective est illustrée d’exemples d’activités s’y rattachant.
-------------------------------------
Le concept de « noyau dur méthodologique » ne peut pas être pertinent pour décrire la perspective actionnelle, ni telle qu’elle est actuellement, en cours d’élaboration, ni sans doute dans les années qui viennent, parce que la cohérence du processus d'enseignement-apprentissage n’y est plus conçue dans une perspective méthodologique, ni même didactique, mais dans une perspective didactologique, celle de la finalité de formation des apprenants comme des acteurs sociaux.
La perspective actionnelle ne peut donc être construite ni décrite comme une méthodologie constituée. Elle n'a d’ailleurs pas été annoncée comme telle dans le CECRL, que ce soit dans sa présentation succincte (p. 15 de l’édition française Didier de 2001)» ou dans le reste de ce document, les auteurs ayant choisi de ne prendre aucune position méthodologique. Sage décision, parce que les années suivantes leur auraient donné tort, pendant lesquelles la perspective actionnelle s’est construite en opposition avec l’approche communicative dont on voit bien, à l’analyse de leurs descripteurs de compétence, qu’elle était encore leur seule référence méthodologique.
Cette absence de principes méthodologiques spécifiques dans les fondements de la perspective actionnelle explique sa très grande ouverture a priori dans ce domaine : tout procédé, démarche ou approche ont vocation à y être mis en œuvre du moment qu’ils sont mis au service de cette finalité. Au niveau micro-méthodologique – le niveau des « méthodes » dans le sens que je donne à ce concept, celui d’unités minimales de cohérence méthodologique (voir le même dossier 4 de mon cours cité plus haut, ou les Documents 04 à 08 en Bibliothèque de travail) –, la méthode massivement privilégiée sera forcément la méthode active, mais c’était déjà le cas, du moins en principe, dans l’approche communicative, dans la « méthodologie active » (méthodologie officielle dans l’enseignement scolaire français des langues des années 1920 aux années 1960), et auparavant dans la méthodologie directe, où la méthode active faisait déjà partie du noyau dur avec les méthodes directe et orale (cf., dans Histoire des méthodologies, le schéma de la p. 121 et la présentation des formes de mise en œuvre de cette méthode au chap. 2.2.3, pp 131-136).
La cohérence de l'approche communicative, quant à elle, s’était construite dans une perspective didactique, à savoir à partir des objectifs (cf. l’importance de l'analyse des besoins langagiers dans les Niveaux-seuils) et d’un série de modèles : le modèle pédagogique de la « centration sur l’apprenant », le modèle linguistique de la grammaire notionnelle-fonctionnelle, et un modèle très abstrait mais prégnant, celui de l'opérateur « inter », que l'on retrouve dans les concepts-clés « interaction », « interculturel » et « interlangue"[1]. Or avec les objectifs et les modèles, on est dans l'élaboration première de l'approche communicative au moyen d'éléments qui font pour moi partie du champ de la perspective didactique : cf. mon schéma du Document 044.
On retrouve la perspective principalement mobilisée dans les appellations elles-mêmes :
– « méthodologie directe » : directe fait référence à un choix méthodologique, celui d’éviter au maximum le recours à l’intermédiaire de la L1 en classe ;
– « méthodologie active » : active fait référence à toutes les formes de mise en œuvre de la méthode active (cf. Document 006);
– « approche communicative » : communicative fait référence à l’objectif de compétence de communication ;
– « perspective actionnelle » : actionnelle fait référence à la finalité de formation d’un acteur social.
On peut résumer cette évolution parallèle dans le tableau suivant.
|
Périodes |
Perspective disciplinaire dominante |
Construction méthodologique |
|
années 1900-1970 |
perspective méthodologique |
méthodologies directe, active, audio-orale et audiovisuelle |
|
années 1970-1990 |
perspective didactique |
approche communicative |
|
années 2000- ? |
perspective didactologique |
perspective actionnelle |
---------------------------------
Christian Puren, octobre 2012
À propos des nécessaires approches multi- et pluriméthodologiques, dans la recherche en didactique des langues-cultures comme dans leur enseignement
L'ATIEF, Association des Technologies de l’Information pour l’Éducation et la Formation, a mis en ligne en mai 2020
un "Avis du Conseil d'Administration" protestant contre les
prétentions du CSEN (Conseil Scientifique de l’Éducation Nationale) à imposer dans la recherche la seule méthode de l'expérimentation contrôlée, qui imposerait, comme elle l'écrit justement un
"réductionnisme scientifique".
On lira avec intérêt ce texte (au besoin, le visualiser sur mon site). J'y retrouve pour ma part les grandes orientations de ce que
l'appelle une "didactique complexe des langues-cultures" (cf. mon manifeste 2003b): reconnaissance de l'importance des acteurs (élèves et
enseignants) avec leur subjectivité ; attention aux pratiques et usages réels des enseignants, dont la compétence est conçue en tant que capacité à gérer la variété et variabilité de leurs
environnements ; refus de l'applicationnisme, enfin référence à l'épistémologie de la complexité, et - c'est la raison de la référence à ce texte dans le présent billet de blog - affirmation de
la nécessité du recours à des méthodologies de recherche différentes.
Il en est de même en didactique des langues-cultures: sur les approches multi- et pluriméthodologiques dans l'enseignement des langues-cultures, cf. sur ce site le document 073 "Matrices méthodologiques actuellement disponibles en didactique des langues-cultures (tableau). Un outil au service des approches multi- et
pluriméthodologiques" .
Cela fait longtemps qu'au Canada, où la recherche est pourtant très influencée par les conceptions nord-américaine, est apparue la même revendication d'une approche multi- et/ou
pluriméthodologique. Thierry KARSENTI, Professeur à l'Université de Montréal et Directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, CRIFPE, ainsi
publié dans la revue Formation et profession d'octobre 2006 un article intitulé "Pragmatisme et méthodologie de recherche en sciences de l’éducation :
passons à la version 3.0", Formation et Profession, octobre 2006. Sa revendication d'éclectisme méthodologique se limite à la combinaison des approches quantitative et qualitative, mais on
sait que cette dernière, en réalité, se décline en de multiples méthodes différentes (documentaire, historique, comparative, recherche-action, recherche-application...) et se réalise au sein de
dispositifs très variés (cf. ma modélisation croisant les axes objet-sujet et compréhension-intervention, Cours "Méthodologie de la recherche en DLC, Chapitre 5, p. 3).
Extraits de l'article de Th. KARSENTI:
[...] la recherche en éducation était jadis dominée par les méthodes dites "quantitatives" qui incitaient le chercheur à commencer une recherche avec des hypothèses, puis à chercher à les
valider ou à les invalider. C’est ce que je nommerais la version 1.0 des méthodes de recherche en sciences de l’éducation. La version 2.0 est arrivée avec une option supplémentaire, celle de
pouvoir choisir entre la recherche quantitative et la recherche qualitative, dont l’application en sciences de l’éducation s’est surtout accélérée après le milieu des années 1980.
[...]
Selon moi, tout chercheur ou apprenti chercheur en sciences de l’éducation doit impérativement passer à la version 3.0 de la méthodologie de recherche.La version 3.0, ce n’est pas
l’imposition de la méthodologie mixte. C’est plutôt la possibilité de choisir, de façon éclectique, les méthodes de collecte de données qui pourront être utilisées en fonction du problème ou des
objectifs de recherche. Dans certains cas, l’approche quantitative unique sera peut-être la meilleure; dans d’autres, ce sera l’approche qualitative. Mais, souvent, ce pourrait aussi être une
méthodologie mixte, à condition évidemment qu’elle soit articulée de façon rigoureuse, raisonnée, cohérente et harmonieuse, et ce, en fonction de l’objectif de la recherche. Dans ce cas, pour
prétendre aux méthodes mixtes dans un projet de recherche, il faudrait nécessairement avoir apprivoisé les méthodologies qualitatives et quantitatives et, donc, faire doublement preuve de
rigueur. (p. 4)
Ce que Th. KARSENTI appelle la "version 3.0" correspond à la fois à l'approche multiméthodologique (cf. les méthodes de collecte de données qui pourront être utilisées en fonction du problème ou
des objectifs de recherche) et à l'approche pluriméthodologique (la "méthodologie mixte").
Une approche didactique d'un risque accru en enseignement-apprentissage hybride : le décrochage
A propos du texte de Yves REUTER, "Dans la classe, quels sont les facteurs qui peuvent contribuer au
décrochage scolaire ?", The Conversation, 9 novembre 2020.
L'auteur, didacticien des disciplines bien connu en France, a publié le 9 novembre un article qui concerne une recherche récente (elle a encore donné lieu à la publication d'un ouvrage en 2016)
sur les facteurs du décrochage scolaire. Or cette recherche prend, comme il l'écrit justement, un intérêt tout particulier dans la perspective d'un enseignement scolaire partiellement à distance,
lequel risque, si l'on n'y prend garde, d'aggraver ce phénomène de décrochage chez une population d'élèves déjà en difficulté. Il rejoint en cela les avis de nombreux sociologues, comme je le
rappelle dans mon dernier essai, qui porte sur l'enseignement hybride (2020e, pp. 5-6).
L'autre intérêt de ce texte, à mes yeux, réside dans la perspective adoptée par l'auteur, qui n'est pas sociologique, mais didactique:
(...) en tant que didacticiens (c'est-à-dire en tant que chercheurs qui cherchent à comprendre les fonctionnements de l'enseignement et des apprentissages à partir des contenus
disciplinaires), nous avons proposé une approche sensiblement différente. Il nous semblait en effet que le vécu des élèves - c’est-à-dire leurs manières de vivre les disciplines scolaires, les
émotions et les sentiments qu’ils leur associent - pesait aussi d’un poids non négligeable dans les mécanismes de décrochage.
Cette hypothèse lui semble confirmée par cette recherche, pour laquelle ont été passés plus de 2000 questionnaires et ont été menés près de 200 entretiens "avec des élèves, à l’école primaire, au
collège, incluant des élèves de SEGPA (sections d’enseignement général et professionnel adapté), au lycée (incluant des élèves de lycées professionnels), et au-delà (BTS, GRETA,
étudiants)".
A partir des facteurs pédagogiques et didactiques repérés par l'analyse des données ainsi recueillies comme influençant négativement le vécu des élèves dans différentes disciplines, il dégage un
certain nombre de "pistes de travail quant aux configurations disciplinaires les plus favorables à l'accrochage scolaire":
- (1) alléger les impositions inutiles et laisser des espaces de choix possibles aux élèves ;
- (2) garantir et sécuriser la compréhension, clarifier les apprentissages à effectuer et effectués ;
- (3) respecter les élèves et bannir les humiliations, privilégier l’évaluation formative ;
- (4) travailler les relations aux questions que se posent les élèves ;
- (5) porter l’accent sur le sens des apprentissages. (la numérotation est mienne).
Et il conclut à la suite son article:
En effet, la manière dont les élèves peuvent s’approprier les disciplines, que ce soit sous forme de compréhension, d’expression ou d’articulation à leur identité et/ou à leur projet
personnel ou professionnel s’avère fondamental. Enfin, l’appui sur des démarches pédagogiques qui privilégient les recherches des élèves, le travail coopératif, l’autonomie et les projets semble
déterminant.
Cette conclusion me semble clairement orienter, comme "configuration disciplinaire" la plus favorable - pour reprendre l'expression d'Yves REUTER- vers la perspective actionnelle. Reste à
combiner fortement celle-ci, dans la conception d'une didactique de l'hybridation en langue-culture, avec les orientations pédagogiques qu'il énumère plus haut. Mais on peut déjà noter que celles
de la perspective actionnelle coïncide parfaitement avec la première (laisser des espaces de choix possibles aux élèves), une partie de la troisième (privilégier l'évaluation formative) et la
cinquième (porter l'accent sur le sens des apprentissages), et se demander si, à l'inverse de la classe inversée, il ne faudrait pas, pour la plupart des élèves, que le travail en présentiel
consacre une large part à la préparation du travail en distanciel.
De très mauvaises nouvelles à propos des premières épreuves PISA en langue étrangère (anglais) annoncées pour 2025
On savait depuis plusieurs années que l'OCDE allait étendre ses enquêtes PISA aux langues 2 (pour l'instant seules les langues 1 sont concernées). Elle annonce maintenant que seront proposées en
2025 des épreuves d'anglais langue étrangère, et qu'elles seraient élaborées par Cambridge Assessment English.
Ce n'est pas une bonne nouvelle pour au moins trois raisons :
1) Ces épreuves ne concerneront en 2015 que l'anglais. Il n'est pas nécessaire ici d'expliquer pourquoi ette décision est critiquable : l'OCDE a pris là une décision qui va à l'encontre de la
défense et promotion du plurlinguisme dans le monde.
2) Le site vousnousils.fr consacré à l'éducation, qui annonce la nouvelle (https://www.vousnousils.fr/2020/10/09/pisa-evaluera-bientot-les-competences-en-anglais-des-eleves-635571), présente
Cambridge Assessment English comme "un département à but non lucratif de l’Université de Cambridge". Ce n'est pas exact, comme l'a longuement montré Bruno Maurer, preuves à l'appui, dans notre
ouvrage commun CECR : par ici la sortie (ouvrage téléchargeable gratuitement en ligne, https://eac.ac/books/9782813003522), tout au long du chapitre qui est entièrement consacré (chap.
1.1.1.1, pp. 8-13). Directement ou indirectement, ce Département profite des certifications payantes qu'il élabore, et l'un de ses récents contrats, récemment passé avec le M.E.N français, est
qualifié par B. Maurer d'"affaire juteuse", en particulier parce qu'il a un coût pour chaque élève qui ne prend pas en compte le fait que les correcteurs sont les enseignants français.
L'attribution de la préparation des épreuves d'anglais langue étrangère de PISA à ce Département va encore renforcer sur la certification des langues étrangères en Europe son emprise, qui est
tout sauf désintéressée. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un processus général de privatisation de l'éducation à l'échelle internationale.
3) Du point de vue strictement didactique, la nouvelle est on ne peut plus inquiétante. Cambridge Assessment English propose des certifications adossées aux échelles de compétence du CECR qu'il a
lui-même contribué à élaborer à l'époque, avec une conception de l'évaluation orientée certification, et certification de la seule compétence communicative. La raison en est, comme je l'ai montré
dans notre ouvrage commun, que ces deux caractéristiques sont adaptées à l'élaboration d'épreuves conçues par des organismes internationaux de manière totalement indépendante des enseignements
nationaux. On peut craindre que la conception des épreuves PISA en anglais langue étrangère (et dans les autres langues qui suivront) reprenne celle du CECR, et ne s'inspire pas de celle des
épreuves PISA en langues maternelles, dont j'ai montré qu'elles étaient adaptées à l'enseignement scolaire, bien meilleures du point de vue technique (voir en part. sur ce point le chap. 1.3.3),
et plus en phase avec l'évolution récente de la didactique des langues-cultures.
Francis Dubet : "Après le virus", il faudra utiliser le temps de "l'école à l'école" "d'abord pour (y) faire quelque chose"
Sur le site des Cahiers pédagogiques, François Dubet, sociologue de l'éducation, publie en date du 20 avril 2020un article intitulé "Après le virus, l'école sera-t-elle comme avant ?", où il se pose les questions suivantes:
Pendant la « continuité pédagogique », l’école n’est plus ce qu’elle était. Qu’en restera-t-il « après », quand le déconfinement aura permis que les élèves se retrouvent en présence de leurs enseignants ? L’école reprendra-t-elle « comme avant » ?
Le chapitre suivant que je reproduis en totalité, intitulé "Faire à l'école", résonne avec un écho particulier quand on le lit en pensant à la perspective actionnelle.
« FAIRE » À L’ÉCOLE
Mais comme l’école connectée n’est pas l’école, comme elle instruit sans éduquer, le temps de « l’école à l’école » pourrait être utilisé pour faire autre chose, et d’abord pour faire quelque chose. Rappelons que pour la majorité des collégiens, des lycéens et des étudiants français, l’essentiel du temps scolaire consiste à prendre des notes, à apprendre des leçons et à se préparer aux évaluations. Le travail collectif reste extrêmement rare ; les élèves français travaillent seuls dans la mesure où ils apprennent d’abord pour être évalués et classés.
De ce point de vue, les élèves ne font rien ou pas grand chose : ils apprennent les sciences mais n’en font pas beaucoup ; ils apprennent la littérature mais n’écrivent pas et ne font pas de théâtre ; ils doivent avoir des idées mais n’en discutent pas. Non seulement l’idée de faire quelque chose n’est pas très vivante dans la culture scolaire française, mais elle a du mal à se couler dans le module homogène de la classe. Alors, elle est souvent renvoyée au « périscolaire » et au seul enthousiasme des enseignants.
La classe, la prise de notes et l’interrogation pèsent d’autant plus qu’elles semblent être seules en mesure de conduire les meilleurs élèves vers l’excellence des « voies royales ». Le travail commun, l’activité partagée, la pratique, sont alors réservés aux élèves les plus faibles, ceux qu’il faut motiver et qui sont en difficultés, ceux qui feront quelque chose dans les filières technologiques et professionnelles. Ceux qui occuperont demain les emplois peu valorisés dont le confinement démontrent qu’ils sont aussi nécessaires à notre survie et à notre vie commune que ceux des « premiers de cordées » qui sont aussi d’anciens « premiers de la classe ». Faire quelque chose à l’école, et quelque chose ensemble, permettrait aux élèves de découvrir des talents, des compétences et des métiers que l’école ignore et méprise parfois.
Les élèves ont besoin de « l’école à l’école » parce qu’elle est un espace de vie indispensable. Mais la vie juvénile s’y déroule à l’ombre de la vie scolaire plus que dans la vie « normale » de l’école, de la même manière que la vie étudiante reste, en France, très largement indifférente au fonctionnement des institutions et des associations universitaires. Aussi, n’est-il pas certain que les élèves et les jeunes Français fassent l’expérience des fonctionnements et des valeurs démocratiques dans le monde scolaire. Comparées aux attitudes des autres jeunesses européennes, leur défiance envers les autres et les institutions et leur très faible confiance en eux démontreraient plutôt que l’affichage des valeurs démocratiques n’est pas une expérience scolaire partagée.
L'enseignement des langues vivantes étrangères, où la perspective actionnelle a été officiellement introduite depuis maintenant une quinzaine d'années, n'est pas à priori le moins bien placé pour relever ce défi.
À propos d'évaluation sommative/certificative en intercompréhension réceptive de l'oral
J'emprunte le titre de ce billet à celui d'un article sur « L’évaluation sommative/certificative en intercompréhension réceptive de l’oral »[1], dans lequel son auteure, Marie-Christine JAMET, propose d'évaluer le niveau des étudiants selon la difficulté de la tâche, le troisième critère qu'elle propose, après les contenus et les supports, étant « les activités cognitives des exercices de vérification ».
L'idée est déjà en soi surprenante, parce qu'elle laisse ainsi entendre que le critère d'évaluation serait le niveau de difficulté des exercices d'évaluation, et non celle des documents. Ce qu'il faut évaluer, ce sont les activités cognitives nécessaires à la compréhension des documents, et non celles nécessaires à la réalisation des exercices d'évaluation de ces documents. Or ce n'est pas forcément la même chose : on peut, sur des documents difficiles, proposer des exercices de compréhension faciles à comprendre et à réaliser, et l'inverse.
On se dit que c'est l'expression de l'auteure qui est peut-être ambiguë, et qu'il faudrait lire « les activités cognitives sur les documents demandées par les exercices de vérification ». L'analyse de ses propositions de progression, à la suite, invalide malheureusement cette hypothèse. Ce sont les suivantes :
– au niveau I, des exercices ne demandant que peu de réélaboration : repérage d’informations simples données par le questionnaire (avec QCM simple ou appariement) ;
– au niveau II, repérage d’informations plus fines suggérées par QCM ou questionnaire à réponse vide fermée/ouverte ;
– au niveau III, repérage libre d’informations (comme la prise de notes) ou QCM plus complexe avec des items qui impliquent une élaboration de l’information, ou questionnaire ouvert. (pp. 84-85)
Il s'agit bien, dans l'esprit de l'auteure, de la difficulté des exercices de compréhension : « QCM simple ou appariement au niveau 1 » ; QCM demandant « des réponses plus complexes » au niveau 2 ; QCM « plus complexe » au niveau 3.
La matrice méthodologique de référence de l'auteure est claire, et elle unique : il s'agit de l'approche communicative. Toutes les activités sur les documents, en effet, commencent par un repérage d'informations qui n’est ni motivé ni orienté par une action à réaliser, comme l'exigerait la perspective actionnelle. Écrire que la prise de notes correspond à un « repérage libre d'informations » est à ce propos très significatif. Une prise de notes s'opère en effet en fonction de ce que l'on veut faire ensuite de ces notes : elles ne sont « libres » que du point de vue de l'auteur des exercices d'évaluation : c'est ce même point de vue qui explique, comme nous l’avons vu plus haut, que la progression envisagée du niveau de difficulté soit celle de ces exercices.
Sont demandées dans un deuxième temps une « réélaboration » (niveau 1) ou une « élaboration » (niveau 3) de l'information. Ces deux notions suscitent au moins trois remarques :
– Quelle est la différence entre ces deux notions ? Intuitivement, on assignerait une difficulté plus grande à la « réélaboration » qu'à l' « élaboration » ; mais c'est la « réélaboration » qui est placée par l’auteure au niveau 1.
– Pourquoi le niveau 2 ne comporte-t-il pas d'activité de (ré)élaboration ? Si on considère qu’un critère est pertinent au niveau 1 et au niveau 3, cela implique qu’il l’est aussi au niveau 2, parce qu'on a forcément postulé qu’il existe pour ce critère un « continuum de difficulté », pour reprendre la formule utilisée par les experts de PISA.
– Mais surtout, qu'entend exactement l'auteure par "(ré)élaboration" ? En approche communicative, la notion d'"élaboration" peut se comprendre comme l'opération qui consiste à sélectionner, réorganiser et reformuler les informations repérées de manière à pouvoir gérer efficacement une situation de communication proposée. Mais il ne s'agit plus alors de compréhension, il s'agit de production. Quoi qu'il en soit, on se demande quelle "réélaboration" peut bien être effectuée dans un exercice de compréhension au moyen d'un "QCM simple ou appariement" (niveau 1).
Quand on a lu en outre, au début de l'article, que ces propositions d'évaluation s'inspirent directement de ce que proposent « les certifications unilingues » (p. 84), on se dit que la réflexion sur « l’évaluation sommative/certificative en intercompréhension réceptive de l’oral » demande encore sérieusement à être approfondie ; que l' « éducation plurilingue et pluriculturelle », dont l'auteur se réclame sans doute comme la revue où est publié son article (elle s'appelle Educazione Linguistica), que cette éducation ne parvient décidément pas à s'opérationnaliser, et qu'elle n'y parviendra sûrement pas sans « sortir » du CECR et de l'approche communicative[2].
[1] JAMET Marie-Christine, « L’évaluation sommative/certificative en intercompréhension réceptive de l’oral », pp. 65-90 in DE CARLO Maddalena (dir.), « Recherches sur les compétences en intercompréhension. Développements du projet Miriadi », EL.LE Educazione Linguistica, vol. 8, n° 1, mars 2019, https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/journals/elle/2019/1/iss-8-1-2019.pdf (dernière consultation 18/02/2020).
[2] Cf. Maurer B. & Puren C., CECR : par ici la sortie !, Editions des Archives Contemporaines, décembre 2019. Disponible en ligne : https://eac.ac/books/9782813003522.
Analyse de la médiation par couples de concepts antagonistes : une application à la "médiation scientifique"
Sur le site The Conversation a été publié le 26 février 2016 un article de Richard-Emmanuel Eastes, "Head of the academic development : University of applied arts and sciences Western Switzerland (HES-SO, Suisse)" intitulé "Peut-on se former à la médiation scientifique ?" Il m'a semblé intéressant de l'analyser au moyen de la grille d'analyse que j'ai proposée dans mon essai sur la médiation (L'outil médiation en didactique des langues-cultures: balisage notionnel et profilage conceptuel, 2019b). Cette grille est composée de sept couples de concepts antagonistes : objet/ sujet, humain/ non-humain, horizontalité/ verticalité, proximité/ distance, ressemblance/ différence, immédiateté/ durée, réaction/ proaction. En voici les résultats.
Deux couples sont fortement mobilisés dans cet article sur la médiation scientifique, verticalité/ horizontalité et objet/ sujet, couples qui sont d'ailleurs naturellement liés entre eux : l'orientation objet entraîne la verticalité de la transmission de haut en bas, du "sachant" à l'apprenant ; l'orientation sujet implique l'horizontalité provoquée par la centration sur l'apprenant :
Verticalité/ horizontalité
La médiation scientifique [...] est issue de la vulgarisation et en englobe diverses pratiques, mais elle ne se confond pas avec elle. Car contrairement à la vulgarisation, la médiation scientifique n’a pas pour but de transmettre des connaissances complexes à un public plus ou moins considéré comme ignorant.
[...] dans sa version forte et citoyenne, on pourrait dire qu’elle consiste plutôt à "travailler" la place de la science et de la technologie en société : à soumettre ces dernières au débat public, le plus sereinement possible, à croiser les savoirs savants et les savoirs profanes. Jusqu’à permettre parfois d’évaluer la pertinence des politiques publiques en matière de choix technologiques à l’aune des opinions exprimées au sein de la société civile.
[...] Là où la vulgarisation invente des formats qui placent les détenteurs du savoir à transmettre sur un piédestal, la médiation introduit l’usage d’outils participatifs permettant à tout un chacun de construire son savoir savant à partir de son savoir profane.
Objet/ sujet
Là où la vulgarisation scientifique cherche à nourrir la culture générale en sciences d’un grand public indifférencié dont elle croit parfois évaluer l’ignorance par des sondages portant sur des connaissances spécifiques et anecdotiques, la médiation cherche à développer une culture de science, sur la science. Dans la perspective de conférer à ses publics une autonomie de pensée, et pas une adhésion aveugle à la science et à ses applications.
[...]
C’est ainsi que des associations comme Les Atomes Crochus ou L’île Logique sont allés jusqu’à imaginer des spectacles de clowns de science. [...] Dans une perspective de médiation, avec pour objectif premier de lutter contre l’autocensure de ces mêmes jeunes vis-à-vis de la science et de la technologie, de leur permettre de prendre confiance en leurs capacités à apprendre, à comprendre, à réussir, à entreprendre dans les domaines scientifiques.
Ce sont les concepts d'horizontalité et de sujet qui permettent en effet à l'auteur de poursuivre son objectif, dans cet article, qui est d'opposer le plus fortement et clairement possible la médiation scientifique à l'ancienne vulgarisation scientifique.
Deux autres couples apparaissent, proximité/ distance et humain/ non-humain :
Proximité/ distance
La notion de distance apparaît à propos de la formation du médiateur scientifique (l'abandon des "idées reçues spontanées et naïves", tant du public non-scientifique que du public scientifique (concernant ce dernier, pensons à ce qu'implique l'allusion à l'épistémologie ou à la sociologie des sciences); mais on peut penser qu'il s'agira ensuite pour le médiateur de reproduire cette mise à distance dans son travail avec des groupes mêlant les deux publics :
En conséquence, la pratique de la médiation scientifique ne peut se passer de la compréhension de la manière dont ses acteurs et interlocuteurs (scientifiques et non-scientifiques réunis) pensent, réagissent, comprennent, apprennent ou produisent des connaissances. Des disciplines comme les sciences de l’apprendre, l’épistémologie ou la sociologie des sciences peuvent dès lors jeter des éclairages particulièrement percutants sur les pratiques des médiatrices et des médiateurs. Elles leur permettent en effet d’abandonner leurs idées reçues spontanées et naïves sur la manière dont leurs publics apprennent et forgent leurs opinions, mais aussi sur la manière dont la connaissance scientifique se construit.
La notion de distance apparaît également dans la réflexion du médiateur sur sa propre action de médiation :
Mais surtout la médiation nécessite, comme un préalable que nous jugeons indispensable, de s’être interrogé sur les fonctions de cette communication publique de la science, c’est-à-dire sur les besoins sociétaux auxquels elle prétend répondre. (...) Cette réflexion sur notre rôle en tant que médiatrices et médiateurs, et la vérification que nos actions sont bien en adéquation avec nos objectifs, relève de ce que l’on nomme la « réflexivité » de la médiation scientifique.
Humain/ non humain
La notion de non humain apparaît, même si elle qualifie pas des médiateurs (alors qu'elle aurait pu être aisément mobilisée à propos des dispositifs scientifiques utilisés dans les activités de médiation), mais les agents sociaux pris en compte par le médiateur:
[...] la médiation scientifique suppose en deuxième lieu une compréhension fine des relations entre science, politique, économie, société, c’est-à-dire des questions socialement vives liées à la mise en application des sciences. Et donc une compréhension de la société et des agents, humains et non humains, qui la peuplent et l’animent.
Réaction/ proaction
C'est la réaction qui est mise en avant, sous la forme de la réactivité aux évolutions des enjeux de la médiation. L'auteur considère la médiation scientifique comme...
[...] un métier véritable [...] qui nécessite de perpétuelles mises à jour au gré des évolutions du rapport nature-science-technologie-société.
Au vu de cette analyse de la médiation scientifique au moyen de la grille des couples de concepts antagonistes, la réflexion apparaît déjà relativement élaborée en termes de nombre de concepts utilisés : on peut les comparer à mon analyse de la médiation culturelle (cf. 2019b, tableau p. 36), qui bénéficie pourtant d'une bien plus longue expérience historique. Mais l'objectif de l'auteur, qui était d'insister sur les différences entre la vulgarisation et la médiation scientifiques, l'a sans doute empêché de ne pas se contenter d'opposer ces couples de concepts, mais de les mettre en relation dialogique, comme le veut l'épistémologie de la complexité.
Pluralisme de juxtaposition et pluralisme d'intégration. Où l'on retrouve la critique du CECR et de son volume complémentaire
Le site La vie des idées publie ce jour, signé de deux économistes, Florence Jany-Catrice & André Orléan, un compte rendu d'un manuel d'économie disponible gratuitement en ligne, L'Économie, « résultat d’un vaste travail collectif réunissant depuis 2013, sous l’intitulé CORE [« Curriculum Open Access Ressources in Economics »], des centaines d’économistes de toutes nationalités, parmi lesquels nombre de grands noms de la discipline, autour d’une équipe de 23 rédacteurs. » Les auteurs de ce compte rendu sont très critiques sur l'orientation idéologique de l'ouvrage, qui représente pour eux « le paradigme économique de ce Nouveau Monde dans lequel le capitalisme règne sans rival d’un bout à l’autre de la planète ».
Si j'en fais mention dans ce billet de blog, ce n'est bien sûr pas pour discuter de cette question, mais pour signaler que les auteurs du compte rendu sont amenés, à l'occasion de leur analyse de l'ouvrage, à présenter ainsi les « différentes conceptions du pluralisme » dans les théories économiques, selon Samuel Bowles, l'un des coordonnateurs de l'ouvrage :
Pour ce faire [i.e. justifier les choix faits par l'équipe de coordination], Bowles commence par déprécier le pluralisme tel que nous l’entendons en le nommant « pluralisme de juxtaposition », pour lui préférer ce qu’il nomme le « pluralisme d’intégration ». Cette attaque ne manque pas d’esprit. Il faut reconnaître que le terme « pluralisme de juxtaposition » est bien trouvé puisqu’en effet, l’attitude pluraliste suppose, en un premier temps, d’appréhender séparément chacune des approches examinées dans le but d’en dégager la logique intérieure avec le plus de netteté possible.
Cependant il faut souligner que l’examen pluraliste ne s’arrête nullement à cette juxtaposition qui n’en constitue que la première étape car, enfin, ce qui est recherché est bien la mise en relation des approches dans le but d’en expliciter les forces et les faiblesses, au regard des faits comme au regard de la fécondité conceptuelle, par le jeu de la comparaison. Ce moment de la mise en rapport est le moment crucial de la pédagogie pluraliste, celui qui permet d’approfondir notre compréhension des concepts en concurrence grâce à la lumière vive que jette sur eux la comparaison avec ce qu’ils ne sont pas, et même, quelquefois, contre quoi ils ont été pensés. Pour cette raison, le terme « pluralisme de juxtaposition » ne convient pas. L’appellation « pluralisme de comparaison » serait plus appropriée, si toutefois on souhaite qualifier la notion de pluralisme. [1]
Cependant, de quelque manière qu’on le nomme, Bowles lui préfère cette autre approche qu’il nomme « pluralisme d’intégration ». De quoi s’agit-il ? Bowles écrit : « Le pluralisme peut également être obtenu en combinant les idées des différentes écoles de pensée au sein d’un paradigme commun. Appelons-le « pluralisme par intégration ». Tel serait le pluralisme mis en œuvre dans le manuel. À ceux qui seraient tentés de voir, dans cette présentation unilatérale, une préjudiciable absence de pluralisme, Bowles répond qu’ils ont tort de s’inquiéter car ce paradigme unique intègre tous les paradigmes ! Cet argument ne résiste pas à l’analyse. En effet, nous avons montré que le rapport qu’entretient le paradigme expérimental aux différentes théories n’est en rien un rapport d’intégration mais bien plutôt un rapport instrumental : il s’agit de s’approprier un morceau de théorie isolé de son cadre conceptuel.
Cette analyse critique rappelle fortement les descriptions que j'ai pu faire dans mon essai de 1994 de l'éclectisme en didactique des langues-cultures (1994e). J'y présente en introduction générale (pp. 11-13) le principe épistémologique de Victor Cousin, le « pape de l'éclectisme » en philosophie, dont l'un des postulats, dans son ouvrage intitulé Du bien (Paris : Librairie Académique Didier, Perrin et Cie, Libraires Éditeurs, 1886, 240 p.) était le suivant :
Postulat n° 3 : Chacun des systèmes apparus au cours du passé dégageait des vérités mais aussi commettait des erreurs à l’intérieur de sa propre problématique, de sorte que l’on doit à la fois absoudre et condamner tous les systèmes pour la vérité qui est en chacun d’eux et pour les erreurs que tous mêlent à la vérité (p. 149).
Et il en tirait la conclusion suivante en termes de démarche philosophique :
[Si] tous les systèmes [...] nous livrent en quelque sorte, divisés et opposés les uns aux autres, tous les éléments essentiels de la moralité humaine, [...] il ne s’agit plus que de les rassembler pour restituer le phénomène moral tout entier (idem, p. 119)
Cette position de Victor Cousin peut être qualifiée de « pluralisme de juxtaposition » : sa doctrine a d'ailleurs été critiquée à l'époque comme une philosophie d'Arlequin (cité in 1994e, p. 11). N'étant pas philosophe, je me garderai bien d'en juger, mais il me semble que, même si cette critique est pertinente, si son pluralisme philosophique, pour le dire autrement, n'est pas suffisamment « d'intégration », la logique environnementale de son projet, en tout cas, est très moderne : « De quel droit – écrit-il – ne met-on l’unité d’une doctrine à ne souffrir en elle qu’un simple principe ? […] Dans la réalité, tout est déterminé, et par conséquent tout est complexe. » (idem p. 152)
J'ai considéré pour ma part, dès avant la fin de mes recherches pour la rédaction de mon essai, que l'éclectisme est en DLC la réponse empirique des enseignants confrontés à la complexité irréductible de leur domaine d'action. Or la méthodologie qu'on leur propose, quelle qu'elle soit, a dû, pour se constituer en tant que telle, c'est-à-dire en cohérence globale, universelle et permanente, expulser la contradiction, alors que celle-ci est une composante fondamentale de la complexité (cf. 046). Preuve en est, entre autres, l'organisation historique spontanée (les épistémologues diraient l'« auto-organisation émergente ») des différentes « méthodes » d'enseignement (dans le sens d'unités minimales de cohérence méthodologique) en paires opposées: méthodes transmissive/active, déductive/inductive, conceptualisatrice/imitative, applicatrice/répétitive, etc. : cf. 008). J'ai considéré aussi que les didactiques devaient dépasser cet éclectisme empirique pour élaborer ce que j'appelais, et que j'appelle toujours, une « didactique complexe » (cf. 1995b, 1998b).
Dans l'ouvrage commun que Bruno Maurer et moi avons rédigé et qui doit être publié ces jours-ci (CECR : par ici la sortie !, Éditions des Archives Contemporaines, 314 p., 2019d), nous préconisons l'un et l'autre le « pluralisme méthodologique », lui pour la méthodologie plurilingue (version modernisée de l'ancienne « didactique intégrée »), moi pour l'évaluation, en nous opposant en cela au choix exclusif des auteurs du CECR de 2001, repris par ceux du Volume complémentaire, en faveur de l'approche communicative.
Nous considérons que ce pluralisme méthodologique doit être composé en fonction du terrain (dans le sens où on dit « composer un menu ») au moyen de sélections, combinaisons et/ou articulations méthodologiques aux niveaux macro (celui des méthodologies constituées), méso (celui des « objets », ou éléments autonomes de méthodologies constituées, cf. 2012f) et/ou micro (celui des « méthodes » dans le sens indiqué plus haut) (cf. 2019g), à partir d'un principe unique, celui d'adéquation, et d'une exigence unique, celle d'efficacité, le modèle de cohérence privilégié parmi les quatre modèles disponibles (cf. 050) étant celui des « cohérences multiples ». C'est une position que l'on peut appeler de « relationnisme » intégral, ce concept, contrairement à celui, très connoté négativement, de « relativisme », signifiant que le principe mis en œuvre est celui de la mise en relation, pour mise en adéquation, des choix méthodologiques avec l'ensemble des paramètres d'enseignement-apprentissage. La mise en œuvre d'un tel pluralisme méthodologique suppose bien entendu une bonne connaissance du terrain, mais aussi une bonne connaissance des particularités, avantages et inconvénients des différentes méthodologies et de leurs différents composants internes : on peut reprendre à ce propos, si l’on veut, l’idée de « pluralisme de comparaison ».
Ce pluralisme méthodologique repose sur une logique que l'on peut appeler « environnementale » ou « écologique » : un dernier chapitre de mon Essai sur l'éclectisme s'intitulait d'ailleurs « L'éco-méthodologie » (chap. 2.4.2.3, pp. 117-118). Il s'agit bien d'un « pluralisme méthodologique intégré », mais dans lequel les éléments méthodologiques intégrés et leurs modes d'intégration sont eux-mêmes pluriels, dans le sens où ils sont non seulement divers, mais différents d'un ensemble méthodologique ainsi composé à un autre. La critique que font les auteurs à l’idée de Bowles qu’un paradigme unique pourrait « intégrer tous les paradigmes » est assurément pertinente, et rejoint une autre, faite déjà de son temps à V. Cousin et complémentaire de celle visant sa « philosophie d’Arlequin », à savoir qu’il est impossible de construire une doctrine unique à partir de principes opposés : il faut pour cela un cadre épistémologique capable de gérer la complexité, c’est-à-dire des exigences contradictoires. J’ai traité la question telle qu’elle se pose dans notre discipline dans un texte intitulé « Gérer la complexité en didactique des langues-cultures : penser conjointement la diversité-pluralité, l’hétérogénéité et l’unité » (2017e).
Le fait que ce pluralisme méthodologique doive être composé, comme je l’ai écrit plus haut, « en fonction du terrain », ne signifie pas qu'il soit élaboré « sur le terrain », i.e. par les seuls enseignants : les responsables politiques et éducatifs peuvent légitimement imposer non seulement les objectifs et les programmes officiels, mais certaines orientations idéologiques (c'est bien le cas en Europe, avec l'exigence de respect des valeurs humanistes et démocratiques), certaines finalités éducatives, certains principes pédagogiques et même certaines orientations didactiques au titre de leur adéquation à ces finalités et à ces principes. Pour la « méthodologie plurilingue intégrée » qu'il propose dans notre ouvrage commun, Bruno Maurer va jusqu'à proposer un « modèle d'acquisition » unique, celui de Hufeisen (2019d, pp. 244-245), mais il s'agit d'un modèle qu'il qualifie lui-même d'« empirique », c'est-dire élaboré à partir du terrain. Dans certains pays, pour des raisons telles que la maîtrise des coûts et le niveau de formation des enseignants, les autorités se réservent le droit de labelliser les manuels en fonction de leur cahier des charges, voire imposent un manuel unique élaboré sous leur contrôle. En tant que didacticiens, nous n'avons pas à critiquer ces choix, mais à en prendre acte et à faire avec…
... sauf bien sûr à refuser le travail. Les conditions que nous mettons Bruno Maurer et moi à notre participation sont d'une part le respect du pluralisme méthodologique – aucune méthodologie unique n'est crédible, et chaque méthodologie dominante a par le passé produit autant d'effets négatifs que positifs –, d'autre part le maintien pour les enseignants d'une marge d'adaptation de leurs contenus et de leurs modes d'enseignement, indispensable, et à un certain niveau incompressible, ne serait-ce que pour des raisons d'efficacité, sans parler de la reconnaissance due aux enseignants de leur responsabilité professionnelle, et donc d'une marge elle aussi incompressible d'autonomie. Même si, là encore pour prendre en compte le niveau de formation des enseignants, des recherches spécifiques, telle que celles dites de « recherche interventionnelle » (cf. 2019c), peuvent les aider à cette adaptation en leur fournissant de nombreux modèles différenciés de pratiques accompagnés de leurs indications, conditions et règles d'usage.
Dans notre ouvrage de 2019, Bruno Maurer et moi avons qualifié chacun notre proposition d'« intégrée » : « méthodologie plurilingue intégrée », « évaluation intégrée », ce qualificatif renvoyant dans notre esprit à la fois en interne à une mise en synergie et à une mise en cohérence des éléments retenus, et en externe à une mise en adéquation avec, comme je l'ai écrit plus haut, « l'ensemble des paramètres d'enseignement-apprentissage », qui doivent forcément être pris en compte dans la conduite du processus conjoint correspondant. Ces trois principes s'opposent frontalement aux choix des auteurs du CECR, repris par ceux de son Volume complémentaire, à savoir :
– le découplage total, malgré leurs dénégations constantes – qui commencent dès le sous-titre de leur ouvrage : Apprendre - Enseigner – Évaluer – entre la méthodologie de l'évaluation qu'ils proposent, celle d'une certification standardisée, monolingue et mono-méthodologique, et les processus d'enseignement et d'apprentissage ;
– l'affichage d'une neutralité méthodologique de principe – au prétexte que la science ne permettrait pas « à l'heure actuelle », « actuellement », « à ce jour », « encore »[2] de définir la bonne méthodologie, neutralité clairement contredite dans le texte même, en particulier dans les descripteurs des échelles de compétence, par l'exclusivité accordée de facto à l'approche communicative : les auteurs du CECR de 2001, et, de manière encore plus incompréhensible, ceux du Volume complémentaire de 2018, se situent en-deçà de tout questionnement sur le pluralisme méthodologique, qu'il soit « de juxtaposition », « de comparaison » ou « d'intégration ».
Le « pluralisme culturel » que les auteurs du CECR et du Volume complémentaire promeuvent par ailleurs ne concerne que les cultures sociales, et – preuve s’il en fallait encore de leur désintérêt réel pour l’enseignement-apprentissage – non les cultures scolaires, dans lesquelles le chevauchement de traditions didactiques et orientations officielles parfois très diverses, quand elle ne sont pas opposées, ainsi que l’extrême diversité des profils, habitudes, conceptions et stratégies des enseignants et des élèves, forment naturellement un très fort « pluralisme de juxtaposition ». L’un des défis les plus importants à relever pour une didactique des langues-cultures véritablement soucieuse des problèmes de terrain, assurément, c’est, pour que les uns et les autres parviennent à travailler ensemble de manière harmonieuse et efficace, parvenir à transformer ce pluralisme de juxtaposition en pluralisme d’intégration.
Christian Puren
18/12/2019
[1] Je dois dire que j’ai du mal à comprendre cette distinction que font les auteurs du compte rendu entre le pluralisme de juxtaposition et le pluralisme de comparaison : la comparaison est une méthode qui permet de dégager les éléments de pluralisme (comme on le verra plus bas dans les passages cités de V. Cousin), mais elle ne détermine en rien ce que l'on en fait ensuite : on peut les juxtaposer, ou au contraire les intégrer.
[2] Voir 2015f pp. 11-12 pour le relevé des passages comprenant ces expressions dans le CECR, et leur critique en tant que relevant d'une "idéologie scientiste", à l'opposé de l'épistémologie de la complexité.
À propos de la question de l'engagement des enseignants dans l'innovation technologique
Trois professeurs en management, Florence Jeannot, Gabriel Guallino et Romain Gandia, ont publié il y a quelques jours, le 14 novembre, sur le site theconversation.com, un long article intitulé "La simulation mentale, un outil pour limiter les échecs commerciaux dans la high-tech".
Ils y rappellent des faits bien connus : "Entre 75% et 90% des produits lancés chaque année dans le secteur high-tech sont retirés du marché moins de douze mois après leur lancement". Et la cause première repérable de ces échecs, c'est la complexité d'usage de ces nouveaux produits, qui provoque une double incertitude chez les utilisateurs: ils ne sont pas sûrs (1) de pouvoir maîtriser cette complexité technique, (2) d'obtenir des bénéfices supérieurs au coût que représente le nouvel apprentissage qu'ils devront faire, tout cela constituant chez eux autant de "freins à l'engagement".
Pour "optimiser l'engagement du consommateur", indispensable au succès commercial du nouveau produit, les trois auteurs proposent un outil, la "simulation mentale", à mettre en oeuvre auprès du public avant l'introduction du produit sur le marché, en tant que "moyen pédagogique pour minimiser les coûts d'apprentissage et éduquer le consommateur à l'usage du produit".
Il ne s'agit ici pour moi de juger de l'intérêt de cet outil ni en management, qui n'est pas mon domaine de spécialité, ni même en didactique des langues-cultures, mais d'illustrer, une fois encore, combien la recherche en management est en avance sur la recherche dans notre discipline, qui s'occupe d'un domaine dans lequel sont régulièrement lancées de manière institutionnelle des innovations technologiques sans mise en oeuvre préalable auprès des enseignants, fort paradoxalement, d'aucun "moyen pédagogique", et dans lequel sont publiés des résultats d'expérimentations plus ou moins personnelles sans prise en compte, dans l'immense majorité des cas, des "freins à l'engagement" des enseignants. Quel est le pourcentage d'échecs dans les innovations en didactique des langues-cultures, c'est-à-dire de cas de non diffusion et/ou de non pérennisation parmi les enseignants ?
On peut faire l'hypothèse qu'il est encore plus élevé. Dans la pratique enseignante "ordinaire" en effet, en dehors des périodes d'expérimentation caractérisées par le surinvestissement des expérimentateurs et généralement la mise en place par leurs soins d'un dispositif le plus favorable possible, le coût d'une innovation technologique est d'autant plus élevé qu'il exige une réorganisation d'ensemble du dispositif habituel d'enseignement, de manière à y rétablir les degrés de faisabilité et de stabilité indispensables à une pratique professionnel durable, c'est-à-dire confortable. L'innovation technologique doit être pensée de manière systémique - comme peut l'être une forme langagière nouvelle introduite en classe, qui va devoir réorganiser l'interlangue de l'apprenant pour s'y intégrer - : le coût final d'une innovation va bien au-delà de la simple introduction et gestion de la seule technologie nouvelle.
J'ai traité de ces questions dans plusieurs articles ou conférences dont les titres me paraissent suffisamment explicites :
- 2009e. "Nouvelle perspective actionnelle et (nouvelles) technologies éducatives : quelles convergences... et quelles divergences ? "
- 2016d. "La didactique des langues-cultures face aux innovations technologiques : des comptes rendus d’expérimentation aux recherches sur les usages ordinaires des innovations"
- 2018c. "Innovation et changement en didactique des langues-cultures".
Un exemple de problématisation conceptuelle : l'approche conceptuelle... d'un concept
Géraldine GALINDO a publié le 29/10/2019 sur le site theconversation.com un article intitulé "La laïcité, un principe de plus en plus complexe à manier pour les entreprises", dans un domaine dont j'ai eu l'occasion déjà de montrer la proximité épistémologique avec la didactique des langues, DLC (cf. "De l’approche communicative à la perspective actionnelle. À propos de l’évolution parallèle des modèles d’innovation et de conception en didactique des langues-cultures et en management d’entreprise", 2006f).
Cette proximité se confirme avec cet article, qui fournit un bon exemple de ce que l'on peut appeler un modèle d'"approche conceptuelle" tout à fait pertinent pour la DLC. Il ne s'agit pas, dans ce modèle, de simplement utiliser différents concepts au cours de l'analyse, mais de partir d'un cadre conceptuel en l'utilisant comme grille d'analyse. Il se trouve qu'ici l'approche conceptuelle porte sur un concept, ce qui correspond à une démarche de problématisation conceptuelle sur un mode "méta".
Dans cet article de G. Galindo, le cadre (ou modèle) conceptuel est constitué de trois concepts correspondant aux trois "hypothèses fortes" nécessaires selon l'auteur pour considérer que le principe de laïcité est aisé à appliquer dans les entreprises. Je les énumère ci-dessous en les transposant en DLC, parce qu'en fait ces hypothèses sont précisément celles qui sont souvent utilisées sans le dire - comme des postulats non explicités, donc - dans beaucoup de travaux de recherche en DLC :
- La stabilité : "Le concept est toujours défini de la même manière."
- L'universalité : "Tous les [utilisateurs du concept] adoptent la même définition."
- L'imperméabilité : Le concept a un sens bien défini qui ne relève que du domaine d'emploi dans lequel on l'utilise.
Or les concepts sont par nature des objets "spongieux" (cf. 2013a, p. 4) qui, dans les environnements complexes - et la DLC en est un, assurément aussi complexe que celui des entreprises -, s'imbibent d'éléments sémantiques divers, instables et évolutifs. De telle sorte qu'ils reçoivent des descriptions différentes en diachronie et en synchronie, ne sont pas définis de la même manière par leurs utilisateurs, et sont influencés par les descriptions qui leur sont attachés dans d'autres domaines d'emploi, avec les connotations et implicites que ces descriptions contiennent. Ce sont là des idées que j'ai développées déjà dans un article de 1997 intitulé "Concepts et conceptualisation en didactique des langues : pour une épistémologie disciplinaire" (1997b).
Sur l'indispensable distinction à faire entre la définition et la description d'un concept, cf. l'ensemble du chapitre 1, pp. 8-26, de mon essai intitulé Le travail d’élaboration conceptuelle dans la recherche en didactique des langues-cultures. L’exemple de l’approche par compétences et de la perspective actionnelle (2016g), où cette distinction est successivement appliquée aux notions de "tâche", d'"exercice" et d'"agir". Sur la distinction entre "notion" et "concept", cf. 2015a, p. 16 (la distinction entre définition et description vaut aussi bien pour les notions que pour les concepts). Le caractère spongieux des concepts demande de se limiter à des définitions les plus abstraites possibles, et de considérer tout le reste comme des adhérences sémantiques contextuelles relevant de la description.
J'ai proposé récemment un exemple personnel d'analyse conceptuelle d'un manuel de FLE, les concepts étant ceux de "méthodologie constituée" et d'"objets méthodologiques": "Analyse macro et mésométhodologique d'un manuel communicatif, Grand large 1, Unité 4" (document 077).
Ce sont ces particularités des concepts en DLC (comme sans doute dans toutes les sciences humaines, dont les sciences de gestion font assurément partie) qui obligent tout étudiant chercheur, dans son mémoire de master ou dans sa thèse, à commencer par problématiser les concepts spécifiques qu'il utilise (cf. le chapitre 4 "Élaborer sa problématique de recherche", chap. 2, pp. 11-14 du cours "Méthodologie de la recherche en DLC"). Ce chapitre présente aussi la distinction, elle aussi indispensable, entre concepts génériques et concepts spécifiques.
Un article recommandé de présentation de la perspective actionnelle
Ahmet Acar, enseignant au Département d'anglais à la Dokuz Eylül University d'Izmir (Turkey), a publié un article intitulé "The Action-Oriented Approach: Integrating Democratic Citizenship Education into Language Teaching" principalement basé sur mes publications. L'article peut être téléchargé sur le site de la revue sur le site de la revue (English Scholars Beyond Borders, Volume 5, Issue 1, 2019) à ce lien. Extrait de l'introduction (traduit de l'anglais avec www.DeepL.com/Translator) :
L'approche orientée vers l'action dans l'enseignement des langues adoptée par le Cadre européen commun européen de référence pour les langues (CECR) et développée en détail par Puren (2004a, 2009b, 2011d, 2013, 2014a, 2014b, 2014b, 2016, 2017g), a un double objectif, contrairement à l'approche communicative, à savoir de proposer un cadre pour enseigner les langues, et de former des citoyens démocratiques dans une société démocratique. Le premier objectif, celui de l'enseignement des langues, est au service du second. Cet article a pour but de présenter les principes de base et les processus méthodologiques de l'approche orientée vers l'action dans le cadre de Puren (2004a, 2009b, 2011d, 2013, 2014a, 2014b, 2016, 2017g). Il vise également à expliquer comment l'approche orientée vers l'action se détache du développement récent de l'approche communicative, à savoir l'enseignement des langues basé sur les tâches. Alors que l'approche communicative et l'enseignement des langues basé sur les tâches visent à former les apprenants à communiquer entre eux, ce qui est principalement un échange d'informations, l'approche orientée vers l'action va plus loin et vise à préparer les apprenants à vivre et à travailler ensemble dans une société démocratique. Un tel objectif exige des apprenants qu'ils développent les principales compétences attendues d'un acteur social telles que l'autonomie personnelle, la responsabilité collective, le travail en groupe, la gestion de l'information, la négociation, la conception et la mise en œuvre d'actions complexes, car ces compétences sont importantes pour que les apprenants en langues vivent et travaillent efficacement dans leur société démocratique.
De l'expérimentation à la généralisation : l'exemple de la mise en oeuvre des résultats des recherches cognitives sur l'enseignement de la lecture-décodage
Édouard Gentaz, professeur en Psychologie du développement à l'Université de Genève, a publié en septembre 2018 un article intitulé "Du labo à l'école : le délicat passage à l'échelle", sur le site www.larecherche.fr.
Ce chercheur considère que " les résultats de l'apprentissage de la lecture issus des sciences cognitives sont solides et [que] les principes pédagogiques qui en découlent sont désormais bien connus", mais qu'ils ont été obtenus "dans des conditions contrôlées, en petits groupes, avec des effectifs réduits allant de 40 à 100 élèves". Il tire d'une expérience à grande échelle qu'il a menée sur plusieurs centaines d'élèves en 2013, dans laquelle les élèves des groupes expérimentaux n'ont pas eu de meilleurs résultats que ceux des groupes-témoins, la conclusion qu'"on ne peut déduire de résultats de recherche, spécifiques à une situation, des procédures détaillées, applicables à toutes les situations et pour tous les publics" et que "leur mise en application dans les classes demande encore un effort considérable de recherches interventionnelles"", recherches conçues à partir d'une "co-construction de programmes interventionnels par les chercheurs et les enseignants", dans lesquelles ces derniers bénéficieraient ainsi d'"une formation par la recherche".
Cette "recherche interventionnelle" que propose ce chercheur est, comme on le voit, un type hybride de recherche, mi recherche-application, mi recherche-action, ce qui est cohérent avec son projet, puisque la première relève du laboratoire, et la seconde de l'école. Étant donné l'importance de l'environnement en pédagogie en général, et en didactique en particulier, ce type de recherche apparaît a priori intéressant.
Dans l'hybride tel que Édouard Gentaz le conçoit ainsi, la recherche-application semble bien l'élément prépondérant, dans la mesure où les résultats des recherches qu'il considère comme des acquis scientifiques vont jusqu'à fixer les détails pratiques de ce qu'il appelle la "méthode pédagogique" de l'enseignement-apprentissage de la lecture-décodage, qu'il rappelle dans les lignes suivantes :
Les résultats de la synthèse des études internationales, comme ceux des études françaises, montrent que, pour être efficaces, les interventions doivent être explicites : les compétences travaillées pendant chaque séance doivent être très clairement établies - apprentissage d'une seule correspondance graphème-phonème, par exemple. Elles doivent également être très structurées, avec un enchaînement précis d'exercices planifiés, et s'effectuer en petits groupes. Les séquences, de courte durée (20 à 30 minutes), doivent être répétées plusieurs fois dans une même semaine et ce pendant un ou deux mois. Les études françaises montrent également que les capacités à identifier et à manipuler les phonèmes peuvent être entraînées très tôt, en grande section de maternelle.
En accord avec la littérature scientifique internationale, nos études montrent également que les interventions les plus efficaces sont celles dans lesquelles le travail oral sur les phonèmes s'effectue avec le support écrit des lettres qui leur correspondent.
On se demande du coup si l'objectif réel de ce chercheur, avec ces "recherches interventionnelles" dans lesquelles tous les enseignants seraient en mesure de bien se former à ce qu'il considère comme la bonne méthode d'enseignement du décodage, n'est pas de tenter à nouveau de valider sur le terrain les résultats ses recherches en laboratoire et la "méthode pédagogique" qu'il en a déduit. Mais il se retrouve de ce fait dans une situation fort paradoxale, qui est de vouloir valider hors-laboratoire l'efficacité d'une méthode sur un terrain où il va contrôler la condition qu'il juge par ailleurs la plus décisive - celle qui a provoqué selon son lui l'échec de son expérience à grande échelle -, à savoir le niveau de formation des enseignants à l'application de cette méthode.
Si ce chercheur voulait véritablement vérifier la corrélation entre le niveau de formation des enseignants et l'efficacité de sa méthode, l'expérimentation qui semblerait s'imposer du point de vue de la recherche scientifique serait de comparer les résultats obtenus avec cette méthode par des enseignants non formés à cette méthode, et par d'autres bien formés à cette méthode, avec des publics et dans des conditions d'enseignement par ailleurs comparables.
Une recherche qui irait plus loin, toujours à partir des hypothèses de ce chercheur, consisterait de comparer non seulement les résultats obtenus par la méthode, mais les adaptations de la méthode - et les corrélations entre les résultats et les adaptations - telle qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions comparables par des enseignants débutants et par des enseignants expérimentés, tous non formés à sa méthode, en partant du postulat que les seconds savent mieux s'adapter que les premiers. Ce n'est que ce dispositif de recherche qui pourrait, il me semble, éventuellement valider l'hypothèse posée par ce chercheur suite au bilan de son expérience à grande échelle, à savoir que l'efficacité de sa méthode dépend des "procédures détaillées" mises en oeuvre par les enseignants en fonction de leur public et des conditions d'enseignement-apprentissage.
La recherche qui irait le plus loin, enfin, viserait à tenter de dégager, à partir des résultats de la recherche ci-dessus, des règles contextuelles d'adaptation des procédures de mise en oeuvre de sa méthode en fonction des différents facteurs qu'il évoque par ailleurs de manière non exhaustive dans son article : "méthode pédagogique utilisée, taille de la classe, niveau de formation des enseignants, niveau socio-économique des familles dont sont issus les élèves..."
Je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin, c'est-à-dire qu'on puisse jamais dégager en didactique des langues des lois générales permettant de passer, comme le dit ce chercheur, "du labo à l'école". Mais ce serait déjà bien avancer...
Christian Puren
Le "savoir-y-faire", "savoir-être" de la perpective actionnelle
J'ai eu l'occasion, dans mon ouvrage intitulé Le travail d’élaboration conceptuelle dans la recherche en DLC. L’exemple de l'approche par compétences et de la perspective actionnelle (2016g, 1e éd. numérique sept. 2016, 80 p.), de reprendre les critiques de plus en plus fréquentes adressées à la notion de "savoir-être", en proposant à la place la notion de "savoir-y-faire" déjà utilisée par certains auteurs, mais de façon ponctuelle ; par exemple par Guy LE BOTERF dans l'un de ses ouvrages les plus connus : De la compétence. Essai sur un attracteur étrange, Paris : Les Éditions d’Organisation, 1994, 176 p. [1e éd. 1994].
Je reprends ci-dessous les différents passages en question de cet ouvrage de 2016(g), en ajoutant (en caractères droits) quelques précisions ici nécessaires :
[Le "savoir-y-faire", ce sont] les manières de faire (attitudes, comportements, modes opératoires) pertinentes et efficaces en fonction de l’environnement (ou pour le faire évoluer) ; de cet environnement font partie les autres personnes impliquées dans l’action ou concernées par l’action, que ce soit en tant que commanditaires (si l’action a été sollicitée par d’autres), co-acteurs (si l’action est collective) ou destinataires (ceux que vise l’action). Pour « s’adresser à un auditoire », il s’agit, dans l’échelle de compétences proposée par les auteurs du CECRL pour évaluer la partie de la compétence de communication nécessaire à la réalisation de l’action langagière « s’adresser à un auditoire » (p. 50), de savoir faire preuve d’assurance (« avec assurance »), de savoir se mettre à la portée de son public (cf. « un auditoire pour qui [le sujet] n’est pas familier »), de savoir s’adapter à ses besoins (« avec souplesse […] pour répondre aux besoins de cet auditoire », ainsi que de savoir garder son calme et de savoir gérer l’agressivité (« peut gérer un questionnement difficile, voire hostile »).
L’adverbe de lieu « y », dans l’expression « savoir-y-faire », renvoie précisément à l’environnement, en l’occurrence à la situation d’action. La caractéristique de l’environnement d’une action complexe, dont le modèle est le projet ((qui est pour cette raison l'action de référence de la perspective actionnelle)), est non seulement que les différents acteurs impliqués font partie de leur environnement, mais que leur action elle-même crée progressivement son propre environnement, celui de l’ensemble des tâches qui la constituent, et qui sont tout à la fois les tâches déjà réalisées, en cours, et planifiées pour la suite : la gestion complexe de cet environnement à la fois externe et interne demande un mode d’action particulière, de « conduite de projet », que l’on appelle en entreprise la « démarche projet ». Le « savoir-y-faire » n’est donc pas seulement, comme l’écrit G. LE BOTERF (1994, cité supra) « savoir se conduire [vis-à-vis des autres] », mais aussi « savoir conduire [son action] ».
Cette conception large du "savoir-y-faire" me semble correspondre, chez l’acteur social, à l’ensemble de ce que J. Tardif appelle dans son ouvrage de 2006 (L'évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement, Montréal [Québec] : Chenelière Éducation, 2006, 363 p.), les "ressources internes" de la compétence, c'est-à-dire du "savoir-agir": les "attitudes", les "valeurs" et les "schèmes d'action" (voir son schéma de la p. 16 reproduit dans PUREN 2016g, p. 48).
Dans mon texte de 2016, je note d'ailleurs que les auteurs du CECRL, définissent par extension le savoir-être, au chapitre 5.1.3, par une longue liste de composantes telles que les attitudes, motivation, éthiques, croyances, styles cognitifs et - ce qui est le plus critiquable - les "traits de la personnalité" (pp. 84-85), mais qu'ils le limitent aux seules "attitudes" dans les contextes où il s'agit d'ajouter aux savoirs et savoir-faire la troisième "composante" de la compétence (p. 4, 5, 21 et 104 : cf. les passages correspondants cités PUREN 2016g, p. 68).
Je reprends cette conception du "savoir-y-faire" dans la définition que je propose de cette notion dans le glossaire du "Champ sémantique de l'agir en DLC" (Document 013, version d'octobre 2016, p. 8), et dans un article intitulé "Pédagogie de l'intégration et intégration didactique dans l'enseignement des langues : un exemple de conflit interdisciplinaire", à paraître dans le n° 72, avril 2018, de la revue Travaux de Didactique du Français Langue Etrangère (TDFLE). Je signale en outre dans cet article que les experts de l'enquête PISA ont une conception de cette troisième composante du savoir-agir qui est assez proche, et qui gagnerait à être précisée dans leur cadre conceptuel :
Le savoir-y-faire, c’est le savoir-faire en situation, c’est-à-dire l’équivalent pour la situation d’action de ce qu’est pour la situation de communication la composante socioculturelle de la compétence communicative. [...] La notion de « savoir-y-faire » ainsi conçue, limitée aux attitudes et comportements, c’est-à-dire aux seules manières de faire observables et évaluables tant d’un point de vue technique que d’un point de vue éthique, permettrait de faire un peu le tri et de mettre un peu de cohérence dans les diverses notions que les auteurs des Cadres d’évaluation et d’analyse des différentes enquêtes PISA ajoutent parfois aux savoirs et savoir-faire sans jamais utiliser la notion de « savoir-être », à savoir les « attitudes, intérêts, habitudes, comportements » (PISA 2009, p. 22), les « valeurs, motivations et attitudes » (PISA 2009, p. 118 et PISA 2012, p. 104 et pp. 130-131), les « attitudes » (PISA 2015, p. 19).
Deux remarques complémentaires, pour le présent billet de Blog-Notes :
1) Le "y" du savoir-y-faire, qui renvoie à l'importance de l'environnement dans une conception complexe de l'action complexe, correspond à ce qu'Edgar MORIN appelle dans son ouvrage de 1990 (Science avec conscience, Paris : Seuil, nouv. éd., 320 p.), p. 109, l'"écologie de l'action" (cf., dans mon Essai sur l'éclectisme, 1994e, la note 230 p. 125).
2) Denis CRISTOL, Directeur de l'ingénierie et des dispositifs de formation du CNFPT, Centre National de la Fonction Publique Territoriale, et Chercheur associé au CREF, Centre de recherches en éducation et formation de l'Université Paris Nanterre a publié en 2017, sur
le site Thot cursus, un article intéressant intitulé "Et si on essayait les compétences floues ?"
(création 2/04/2017, mise à jour 22/06/2017, dernière consultation 2701/2018).
L'une des idées qu'il y développe, et qui n'est pas nouvelle, c'est que dans le monde professionnel, le travail est devenu si complexe qu'il ne peut plus être réalisé de manière mécanique mais qu'il exige une adaptation constante à l'environnement, c'est-à- dire de la compétence. Comme l'écrit LE BOTERF : "Être compétent, c'est de plus en plus être capable de gérer des situations complexes et instables" (Construire les compétences individuelles et collectives, Paris : Eyrolles-Éditions d'Organisation, 1e éd. 2000, p. 53).
J'y ai noté aussi les deux idées suivantes, plus originales il me semble :
1) C’est certainement aussi parce que la part de travail invisible a pris de l’ampleur dans le monde immatériel des services que les interprétations subjectives se renforcent. Les événements, les singularités individuelles, les demandes "sur mesure" augmentent les incertitudes sur la production de prestation. [...] Les régulations à opérer pour mener à bien une tâche semblent dépendre tout autant des situations que des caractéristiques individuelles. Il faut "y mettre de sa personne" pour répondre à une variété de demandes que chaque demandeur de service souhaite à sa mesure. Le service est fait de rapports humains.
Le savoir-y-faire, c'est précisément ce "savoir y mettre de sa personne".
2) C'est parce que la description des activités humaines est vaste en particulier lorsqu’il s’agit d’évoquer les interactions qu’on peut qualifier les compétences pour y faire face de floues".
Ces compétences, qui correspondent aux "savoir-y-faire", vont en effet dépendre (a) des situations et des individus, et (b) des enjeux spécifiques suivant la perspective de l'auteur de la définition de ce savoir-agir :
Choisir l’objet d’analyse évite de mélanger une description de tâche pertinente, un ressenti subjectif ou une disposition interne pour se repérer dans l’action, un trait de caractère pour un recruteur, la construction d’un indicateur mesurable pour un évaluateur.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le noter, la composante dite socioculturelle ou sociolinguistique de la compétence de communication fait partie du "savoir-y-faire" d'usage en situation de communication. Dans l'apprentissage d'une langue-culture, font partie du "savoir-y-faire" les "stratégies socio-affectives" telles que les décrit Paul CYR dans Les stratégies d’apprentissage (Paris : CLE international, 1998 [1e éd. 1996], dans la mesure où elles "impliquent une interaction avec les autres (locuteurs natifs, enseignant ou pairs) en vue de favoriser l’appropriation de la langue cible ainsi que le contrôle ou la gestion de la dimension affective personnelle accompagnant l’apprentissage."
Pour conclure ce billet, je ne peux que reprendre l'appel à des recherches en DLC développant cette notion de savoir-y-faire tel que je lançais de manière encore très peu construite, au moyen d'une liste de quelques idées immédiates, dans mon ouvrage 2016g (p. 69) :
Cette notion de « savoir-y-faire » attend elle aussi ses chercheurs en DLC, et ils devront l’appliquer tant à l’agir d’usage qu’à l’agir d’apprentissage. Voici, en commençant par le passage ci-dessus du Cadre, les quelques idées que j’ai pour l’instant sur la question, qui ne se révèleront peut-être pas toutes pertinentes :
1) Le « savoir-y-faire » [...] sont les manières de faire (attitudes et comportements) pertinentes et efficaces vis-à-vis des autres personnes impliquées dans l’action ou concernées par
l’action, que ce soit en tant que commanditaires (si l’action a été sollicitée par d’autres), co-acteurs (si l’action est collective) ou destinataires (ceux que vise l’action).
2) Le savoir-y-faire mobilise effectivement des ressources cognitives, qui sont toutes celles nécessaires pour parvenir à ce que l’on appelle « l’intelligence de la situation » et «
l’intelligence de la tâche ».
3) Les ressources affectives sont elles aussi mobilisées dans le savoir-y-faire : elles sont en effet indispensables au choix et au maintien d’attitudes et de comportements pertinents et
efficaces.
4) Par contre, les ressources volitives n’en font pas partie, si du moins on considère que le « vouloir agir » est distinct du « savoir-agir ». [...]
(5) Le savoir-y-faire mobilise aussi des savoirs et des savoir-faire fournis par les connaissances et l’expérience concernant les cultures d’action, qui sont les cultures d’apprentissage, les
cultures d’enseignement et les cultures d’action sociale (celles de l’environnement le plus proche, comme les cultures familiales, jusqu’à celles de l’environnement le plus global, la « culture
mondialisée », en passant par les cultures professionnelles, les cultures nationales, etc.).
Christian Puren, 02/02/2018
Le "faire ensemble" plus pertinent que le "vivre ensemble" (Vincent GEISSER, sociologue)
Dans un dossier de la revue Le courrier de l'Atlas consacré au "vivre ensemble" (n° 212, janvier 2018, p. 28), Vincent GEISSER, présenté comme "politologue et sociologue, chargé de recherche au CNRS et à l'IREMAM (Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman)", a choisi de prendre dans son interview le contre-pied du thème imposé. Morceaux choisis.
[Le vivre-ensemble] est une posture intellectuelle, politique et sociétale qui prône la tolérance, l'antiracisme et l'anti-discrimination. Mais la formule est devenue un fourre-tout. [...]
Le discours du vivre-ensemble sert de plus en plus à masquer notre incapacité à agir ensemble. En France, nous sommes à la fois ceux qui dénoncent et ceux qui participent du problème. À titre personnel, la notion d'"en commun" me paraît plus pertinente, [c'est-à-dire] la défense de valeurs communes et le "faire-ensemble". À savoir, bâtir des actions et des projets communs sur les questions d'exclusion et d'égalité. Dans le contexte actuel, avec la crise des financements publics, le retrait de l'État d'un nombre de territoires, le marasme du secteur associatif et de l'éducation populaire, le faire-ensemble est en danger. On constate qu'il y a de plus en plus d'associations qui luttent contre les discriminations, mais de manière très segmentée. [...] Nous sommes incapables de penser ensemble les logiques de discriminations dans un mouvement commun.
[...] Il est plus facile de créer une petite structure qui va défendre les siens plutôt que de construire avec des gens différents, de l'"en-commun". On rejette cette complexité en lui préférant la simplicité de la segmentation: l'entre-soi social, religieux, professionnel... n'ai jamais été aussi fort.
On retrouve chez ce sociologue la même mise en avant du "commun" au lieu des "différences" et des "identités", et du "faire ensemble" au lieu du "vivre ensemble", que chez le sinologue François Jullien (cf. mon billet de Blog-Notes du 20 décembre 2016. C'est une nouvelle confirmation - s'il en était encore besoin - du fait que l'émergence de la perspective co-actionnelle / co-culturelle à côté du couple approche communicative / approche inter-culturelle, à partir des années 2000, provient d'une prise de conscience d'enjeux qui vont bien au-delà de la seule didactique des langues, mais à laquelle elle apporte sa contribution.
L'interview de Vincent Geisser était encore disponible le 17 août 2018 sur le site du Courrier de l'Atlas.
Postcripta
1) Juste avant de publier, je lis ces deux annonces pour la version en français et la version en anglais du même numéro de revue (je souligne) :
- Les Cahiers de recherche du GIRSEF - N° 110, septembre 2017- "'Faire société' dans un monde incertain. Quel rôle pour l'école ?"
- Les Cahiers de recherche du GIRSEF - N° 111, septembre 2017- "Living together in an uncertain world. What role for the school ?"
No comment...
2) Autre exemple de la confusion fréquente, au moins dans leur emploi, entre le vivre ensemble et le faire ensemble, ces deux passages extraits d'un Dossier de veille de l’IFÉ (n° 124, avril 2018, Lyon : ENS) réalisé par GIBERT Anne-Françoise intitulé "Le travail collectif enseignant, entre informel et institué" consultable et téléchargeable en ligne :
En France le modèle dominant de l’éducation valorise plutôt la performance individuelle de l’enseignant.e comme des élèves. Constatant la plus-value cognitive du travail collectif, de nombreux auteur.e.s plaident pour une école du vivre ensemble, qui éduque à la solidarité et à la coopération, pour une école apaisée, avec plus d’interactions entre les différentes parties prenantes (Durpaire & Mabilon-Bonfils, 2013), voire pour une école conviviale (Flahault, 2014).
[...]
La formation au "travailler ensemble" n’est pas encore inscrite dans la formation des enseignant.e.s, elle pourrait englober la formation à la résolution de conflits [...].
Christian PUREN, 28 mai 2018
3) Suite du florilège: Le site UGA-Editions a annoncé sur son site la parution d'un ouvrage de Bernard Vallerie, Action sociale et empowerment, PUG (Presses de l'Université de Grenoble Alpes) - UGA Editions, oct. 2018. Il y est présenté comme "un ouvrage synthétique, centré sur le développement du pouvoir d’agir, pour aider les personnes en difficulté sociale à devenir actrices de leurs propres changements [...] qui ’adresse en priorité aux intervenants sociaux et personnes qui souhaitent œuvrer dans le champ du travail social mais aussi à quiconque s’intéresse au développement du vivre ensemble." (je souligne)
Christian PUREN, 25 octobre 2018
Pour en finir avec la dichotomie théorie-pratique
À propos d'un article de Jean-Marie BARBIER, sur le site The conversation, "Pour en finir avec la dichotomie théorie-pratique" (18/10/2017, dernière consultation 12/01/2018)
Jean-Marie BARBIER, ancien professeur à la Chaire UNESCO-CNAM, est un chercheur très connu pour ses recherches et publications sur la formation professionnelle. L'épistémologie qu'il y défend s'applique à mon avis parfaitement à la didactique des langues-cultures (DLC) à partir du moment où on considère celle-ci comme une discipline d'intervention:
Le discours fondateur des disciplines a été souvent un discours de désignation en extériorité de leur objet : fait social dans le cas de la sociologie durkheimienne, énoncé dans le cas de la linguistique ouverte par la distinction énoncé/énonciation, comportement observable dans le cas de la psychologie expérimentale béhavioriste etc. Il a été aussi un discours de clôture de cet objet : un fait social peut s’expliquer par d’autres faits sociaux comme un phénomène chimique peut s’expliquer par d’autres phénomènes chimiques.
Un champ de pratiques pose, lui, obligatoirement la question du discours du sujet sur sa propre activité ; il se définit d’abord comme un champ d’intentions de transformation du réel. (je souligne)
"Voies pour la recherche en formation", Éducation et didactique vol 3, n° 3, octobre 2009, (mise en ligne 01/10/2014, dernière consultation 08/10/2014,
désormais "BARBIER 2009").
C'est logiquement, de ce fait, qu'il met l'accent dans ses travaux :
- sur les savoirs produits par l'action elle-même : c'est le thème principal de "Introduction" à un ouvrage collectif qu'il a dirigé : Savoirs théoriques et savoirs d'action (Paris : PUF, coll. "Pédagogie aujourd'hui", 1e éd. 1996, 305 p.) ; j'ai eu l'occasion, dans mon essai Théorie de la recherche en didactique des langues (2015a, pp. 11-12), d'attirer l'attention sur ces savoirs détenus par les praticiens eux-mêmes, qui légitime dans cette discipline une "approche compréhensible", ou "centration sur les acteurs", constitutive de ce j'appelle une "didactique complexe" (voir aussi 2003b, point 1, p. 2) ;
- et sur la dimension vécue de l'action : "la notion même d’action [...] peut être définie comme un ensemble d’activités dotées d’unités de sens et/ou de significations par et pour les acteurs concernés", ce qui fait que "ce que l’on appelle « la pratique » [n'est] le plus souvent que le discours que le sujet tient sur sa propre activité." (BARBIER 2009)
J.-M. BARBIER reprend et développe ses idées fondamentales de manière très synthétique (un peu trop sans doute, pour les lecteurs qui ne connaissent pas ses travaux...) dans un article récemment publié sur le site The conversation (voir références supra). Il considère que
l’opposition théorie/pratique ne produit pas d’effet de connaissance, cette dichotomie n'étant rien d'autre qu'"une construction discursive à laquelle sont associées des constructions mentales. Elle ne décrit pas, ni n'analyse des activités ; elle les qualifie." [...]
La dichotomie théorie/pratique apparaît dans des contextes qui ont pour enjeu la détermination des positions des sujets/acteurs dans l’engagement de leurs interactivités.
Elle introduit, accompagne, justifie, légitime une distribution sociale et personnelle des rôles et fonctions dans des configurations d’activités : conception, initiative, management, direction, pilotage, ou à l’inverse travail, production, réalisation, opération. [...]
Cette dichotomie s’inscrit dans un paradigme plus général fonctionnant comme une culture sociale de pensée (epistémé chez Foucault) distinguant et hiérarchisant discours/pensée/action. Ce paradigme continue d’être dominant dans les sociétés occidentales et se révèle lié à l’exercice du pouvoir dans les organisations. On peut penser que ce paradigme enferme les professionnels eux-mêmes dans ses catégories : quand ils veulent promouvoir leur « pratique » en la qualifiant, ils le font souvent avec les caractéristiques du langage de la théorie. Les « savoirs professionnels » par exemple sont traités comme des équivalents des savoirs « théoriques », et sont revêtues de qualificatifs en référence à leurs attributs sociaux, faute d’être traités comme des cultures d’activité.
L'opposition théorie-pratique fonctionne de la même manière chez les acteurs de la DLC, avec la particularité (qu'elle partage au moins, il me semble, avec les didactiques de toutes disciplines scolaires) que les "théoriciens" revendiquent leur prééminence sur les "praticiens" au titre de leur savoirs théoriques, mais que les "praticiens", à l'inverse, revendiquent leur prééminence sur les "théoriciens" au titre de leurs savoirs pratiques.
- En ce qui concerne la théorie, J.-M. BARBIER (2017) écrit très justement:
En sciences sociales la théorie est censée « éclairer » la pratique. En sciences physiques, quand la recherche s’occupe de transformation du monde, elle devient une recherche « appliquée ». Nous avons de bonnes raisons de penser que cette hiérarchie de relations causales est une croyance qui accompagne les actions et les légitime. Aucune observation ne peut être convoquée en ce sens. Pas plus que les valeurs, les savoirs ne s’appliquent au sens strict aux actions ; ils supposent autre chose.
En DLC, tout au moins, cette "autre chose" nécessaire pour que la théorie puisse avoir une incidence sur l'action d'enseignement, c'est sa transformation en modèles théoriques qui puissent se confronter, sur le terrain, aux modèles praxéologiques : c'est la thèse centrale du "système général de la recherche en DLC" que je propose dans mon essai 2015a. Il n'y pas de relation théorie-pratique possible en DLC - comme sans doute dans toutes les sciences humaines - si l'on n'intercale pas entre elles l'interface indispensable que constitue le modèle. Sur la notion de modèle, voir les auteurs que je mobilise dans les documents 014 et 015, et dans mon cours "La DLC comme domaine de recherche, la totalité du "Dossier n° 3" : "La perspective didactique 1/4 : "Modèles, théories et paradigmes".
C'est la modélisation des pratiques qui doit être l'objectif de ce type de recherche que l'on appelle "recherche-action", pour qu'il ne reste pas enfermé, comme le dénonce justement J.-M. BARBIER 2009, dans cette dichotomie simpliste :
Une idéologie assez répandue dans les milieux de la formation permanente et plus largement dans un certain nombre de milieux professionnels tend d’une part à promouvoir l’« accès » de tous les praticiens à des formes de recherche sur leurs propres pratiques, et d’autre part et dans le même temps à valoriser de fait l’activité discursive théorique, ce qui est une manière de rester enfermé dans le paradigme théorie/pratique.
Sir cette question, voir mes propres idées au chapitre 5 de mon cours de méthodologie de la recherche, point 1.5, pp. 24-30).
- En ce qui concerne la pratique, les différentes analyses que j'ai pu faire de l'usage du terme de "théorie" dans les écrits des stagiaires et enseignants débutants illustre les effets pervers de cette dichotomie simpliste : relève de la "théorie", pour eux, "tout simplement" tout ce qui n'a pas été pratiqué par eux-mêmes dans leurs propres classes. Dans mon cours intitulé « La DLC comme domaine de recherche ». Dossier 7 : « La perspective didactologique 1/2 : l'épistémologie », chap. 5 : « La relation théorie-pratique en DLC (pp. 8-11), un certain nombre de citations sont proposées, avec en annexe (p. 13) le modèle d'analyse suivant, qui intègre toutes les représentations attachées chez eux à cette dichotomie :

On comprendra que le recours à une opposition conceptuelle qui correspond en réalité à un tel nœud gordien de notions entremêlées est aussi contre-productif en formation qu'il est critiquable du point de vue épistémologique.
Dans son article de 2009, J.-M. BARBIER tire logiquement, de sa conception des disciplines qui travaillent sur des "champs de pratiques", la conclusion suivante:
Par ailleurs le développement de champs de recherche correspondant à des champs de pratiques implique probablement de la part des chercheurs qui s’engagent dans ce type d’orientation qu’ils comprennent tout l’intérêt qu’ils peuvent avoir, quel que soit le champ privilégié de leurs recherches (éducation, gestion, ergonomie, travail social, communication etc.) à constituer ensemble une communauté scientifique élargie. Qu’ils comprennent aussi, s’ils visent à terme l’intelligibilité de la singularité des actions, que leur rôle propre est peut-être moins de produire des savoirs que des outils générateurs de savoirs.
Je reprends entièrement à mon compte cette formule pour la DLC : le rôle de ses chercheurs est "moins de produire des savoirs que des outils générateurs de savoirs". C'est le sens de l'image du "couteau suisse" proposée en son temps par le didacticien suisse René RICHTERICH, et que j'ai repris à mon compte pour en faire le "favicon" de mon site (voir sa présentation sur la page "Accueil").
"Pédagogie différenciée", "apprentissage autonome" et "différenciation didactique"
Depuis la publication des outils du Programme de Coopération Européenne (PCE) LINGUA A dont j'ai assuré la direction pédagogique en 1997-2000 (Livrets d'autoformation et de formation en français,
anglais, portugais et italien accompagnant 44 exemples de séances de classe vidéoscopées, 2001l-0), ainsi que des différents articles auxquels ce travail a donné lieu (1998e, 2001d, 2001k, 2002d,
2003a), j'ai eu à trois reprises l'occasion de revenir sur cette problématique dans mon Blog-Notes :
09 septembre 2013 : "Pédagogie différenciée : un utile "pense-bête" sur le site du Café pédagogique" ;
9 février 2017 : "Différenciation de l'enseignement, différenciation de l'apprentissage" ;
17 juin 2017 : "Différenciation de l'enseignement, différenciation de l'apprentissage" (bis).
Je viens par ailleurs de publier (09 janvier 2018) en "Bibliothèque de travail", Document 068, un T.P. pour enseignants (avec ses suggestions d'interprétation), et un formulaire d'enquête pour
chercheurs et/ou formateurs (avec ses suggestions de traitement) visant faire émerger et interroger les conceptions que l'on a en tant qu'enseignant de la relation entre les processus
d'enseignement et le processus d'apprentissage. C'est en effet forcément de la conception de cette relation que va dépendre la conception que l'on se fait de la différenciation.
A l'occasion d'une prochaine intervention (17 janvier prochain 2018) dans un stage de la DAFOR de Paris de Paris (Délégation Académique de la FORmation) intitulé "Hétérogénéité et différenciation
pédagogique", j'ai eu l'occasion de réfléchir à nouveau sur la modélisation possible des différentes conceptions de la différenciation. Le titre même de cette formation illustre bien quelle est
la tradition français bien enracinée en ce qui concerne la relation enseignement-apprentissage...
1) La "pédagogie différenciée", comme son nom l'indique (le pédagogue, c'est l'enseignant) correspond à une conception de la différenciation orientée enseignement, à la différenciation de
l'enseignement. C'est l'enseignant qui prend en charge la différenciation en proposant à ses élèves, individuellement et par groupes, des dispositifs où l'apprentissage se fait sur des objectifs,
des contenus, des tâches et/ou des supports différents, et/ou avec des méthodes, des aides et/ou des guidages différents : c'est en majeure partie sur ces différents éléments possibles de
différenciation de l'enseignement que j'avais construit au départ la grille de sélection et d'analyse des séquences vidéoscopées du PCE sur la pédagogie différenciée. J'avais dû rajouter
après-coup, en "Thèmes transversaux", la rubrique "Autonomisation", tellement ce thème apparaissait clairement illustré dans de nombreux enregistrements...
2) L'"apprentissage autonome", qui est l'équivalent de la pédagogie différenciée dans les pays anglo-saxons et du nord de l'Europe, correspond à une conception de la différenciation orientée
apprentissage, à la différenciation de l'apprentissage. On considère que c'est chaque apprenant qui est le mieux à même de savoir comment il veut personnellement apprendre, et l'enseignant lui
aménage par conséquent - avec s'il le faut le guidage et l'aide nécessaires, bien entendu - des moments de travail autonome. Plusieurs séquences vidéo du PCE montrent des élèves travaillant
seuls, individuellement ou en groupe. Dans l'une d'elles, l'enseignante "visitée" se promène dans la classe en parlant tout fort à sa collègue "visiteuse" pendant que ses élèves se consacrent à
leurs activités personnelles...
3) Ce que je propose d'appeler la "différenciation didactique" - en prenant didactique dans le sens qu'a maintenant cet adjectif, qui renvoie au processus conjoint d'enseignement-apprentissage -,
c'est ce qui correspond au positionnement "intermédiaire" sur le continuum entre les deux bornes extrêmes de la centration sur l'enseignement et de la centration sur l'apprentissage : c'est la
différenciation de l'enseignement-apprentissage. Tout l'enjeu de la réflexion sur la colonne centrale du questionnaire du T.P. et de l'enquête est de faire émerger la conception que l'on a de ce
positionnement, lequel, au-delà de la conception de la différenciation, reflète donc la conception que l'on se fait de la discipline "didactique des langues-cultures" elle-même, puisque l'objet
de celle-ci est la relation complexe entre le processus d'enseignement et le processus d'apprentissage (cf. la définition proposée de la discipline au premier chapitre du cours sur "La didactique
des langues comme domaine de recherche", chap. 1.1. "Une définition de la DLC", pp. 2-4).
On se reportera sur cette question de l'interprétation de la "colonne centrale" au point 4, p. 2, du document "Conceptions de la relation enseignement-apprentissage (corrigé du T.P. et
commentaires)", disponible sur la page à l'adresse du Document 068 en Bibliothèque de travail. Les éléments de cette colonne, tels qu'ils sont décrits, intègrent les deux processus parfois dans
un compromis entre les deux, parfois dans une alternance entre l'un et l'autre. Elle est situé, dans les tableaux, juste entre les deux processus opposées, dans un positionnement "intermédiaire",
mais les qualificatifs qui définissent cet intermédiaire, ce n'est donc ni "central", ni "neutre" (= ni l'un ni l'autre), ni "équilibré", ni "idéal", mais "médiateur", dans le sens qu'a ce terme
en sociologie, c'est-à-dire qui prend en compte à parts égales les besoins et les demandes de chacune des parties, paradoxalement de manière à la fois empathique et distanciée. Autrement dit, la
réflexion didactique, par définition - celle de la discipline correspondante, qui se veut complexe -, intègre dans son objet les processus d'enseignement et d'apprentissage en les considérant à
la fois comme opposés et complémentaires.
Le T.P. et l'enquête visent à faire émerger des conceptions, et non représentations de la relation enseignement-apprentissage. Cette distinction est essentielle, et le choix du concept de
"conception" s'explique par la définition de la didactique des langues-cultures comme discipline d'intervention, c'est-à-dire d'action. Sur cette question, voir le Document 045 en Bibliothèque de
travail "Composantes sémantiques du concept de 'conception' [de l'action]", et mon billet de blog en date du 04 mai 2011 qui critique l'usage aussi généralisé qu'abusif du concept de
"représentation" dans les travaux de beaucoup de didacticiens de langues-cultures.
La mise en oeuvre de l'interdisciplinarité entre langues : éveil aux langues, didactique intégrée et intercompréhension
"L'expresso" du Café pédagogique en date du 14 décembre 2017 a publié un article de Françoise Leclaire intitulé "Apprendre des langues pour comprendre".
Extrait du début de l'article :
Et si les langues nous aidaient à comprendre ? Lire c’est comprendre. Et principalement comprendre ce que le texte ne dit pas ou dit « entre les lignes ». Or c’est justement là que les performances des petits écoliers français aux épreuves PIRLS ont particulièrement chutées. Nous souhaitons montrer que ce n’est pas une fatalité et qu’il existe des mises en œuvre pédagogiques simples qui permettraient non seulement d’améliorer les compétences en compréhension ((sous-entendu: en langue maternelle)) mais également d’améliorer les compétences en langues vivantes enseignées. Recette miracle ? Que nenni !
Posons d’abord quelques certitudes grâce aux chercheurs ayant travaillé sur la question de la compréhension.
- La différence entre « bons » et « mauvais » compreneurs est corrélée à :
- La capacité à contrôler leur compréhension,
- La capacité à utiliser les marques référentielles. (Yuill et Oakhill 1991, Ehrlich et Rémond 1997 )
Nous avons mené en 2010 une expérimentation dans 3 classes de cycle 3 (Echantillon) comparées à 3 autre classes équivalentes (Témoin). Les trois classes du groupe échantillon ont participé pendant une année à des séances hebdomadaires d’éveil aux langues et d’intercompréhension.
La question L’éveil aux langues est une approche méthodologique initiée par Eric Hawkins en Angleterre dans les années 60 pour répondre au défi de l’échec en langue(s) des enfants immigrés. Cette approche développe des attitudes de tolérance et d’ouverture à la diversité linguistique et culturelle, des aptitudes susceptibles de faciliter l’apprentissage d’une langue étrangère. Concrètement, il s’agit d’une approche comparative des langues où l’on réfléchit sur les langues, leurs similitudes et différences, à partir de matériaux sonores ou écrits. L’intercompréhension s’appuie sur l’exploitation des ressemblances et transparences entre les langues.
Suite une présentation des résultats très positifs des tests effectués dans ces classes, qui montre une bien meilleure capacité des élèves ayant subi l'expérimentation à réaliser des inférences, capacité confirmée par leurs déclarations au cours d'entretiens d'explicitation.
Bien sûr que les langues aident à comprendre, puisqu'il faut comprendre pour les apprendre... L'apprentissage des langues étrangères est effectivement une occasion naturelle de transférer une capacité aussi générale que celle de l'inférence (étymologique, grammaticale et contextuelle) depuis la langue maternelle - où elle a dû être travaillée initialement - aux langues étrangères, et de continuer à s'y entraîner. Il en est de même de la capacité à "contrôler sa compréhension" (ou capacité d'"autorégulation"), avec le recours aux même types de tâches métacognitives. Le problème est différent en ce qui concerne le vocabulaire: les élèves disposent en langue maternelle d'une capacité de "reconnaissance phonologique" bien supérieure à celle qu'ils ont au départ en langue étrangère, parce qu'ils peuvent reconnaître, au décodage, la forme orale de tous les mots qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne.
L'approche "éveil aux langues" est effectivement très intéressante au cycle 3, et déjà au cycle 2 (vous auriez pu citer aussi les travaux très élaborés, matériels didactiques compris, du Français Michel Candelier et de ses équipes). Mais au cycle 4, le relais peut avantageusement être pris, me semble-t-il, par la "didactique intégrée", qui implique une collaboration entre le professeur de français langue maternelle, de la langue commencée en cycle 2 et de celle commencée en classe de 5e, dans un travail sur les stratégies d'enseignement-apprentissage. Quant à l'intercompréhension, elle a été surtout expérimentée (avec succès) à l'université, et elle pourrait fournir le relais idéal en second cycle. (Sur ces différents dispositifs, cf. aussi les "méthodologies plurilingues" dans mon schéma général "Les enjeux actuels d’une éducation langagière et culturelle à une société multilingue et multiculturelle").
L'éveil aux langues, jusqu'à présent, a été conçu dans une perspective de sensibilisation, et cela me paraît raisonnable: on ne peut pas "sensibiliser" pendant des années (c'est le problème structurel auquel s'est historiquement heurtée l'approche interculturelle dans l'enseignement scolaire des langues étrangères, et qu'elle n'a pu résoudre). Après la sensibilisation jusqu'en fin de cycle 3, la didactique intégrée, en collège, et l'intercompréhension, en lycée, permettraient d'aller progressivement vers la mise en œuvre du même principe (l'interdisciplinarité entre langues), globalement de la sensibilisation à l'apprentissage puis à l'usage. Dans les classes européennes, les passages devraient être plus précoces, en cohérence avec la relation entre les objectifs d'apprentissage et les objectifs d'usage.
L'intérêt didactique de ces différents dispositifs n'est plus à démontrer. La seule question qui se pose - mais elle est redoutable -, est de savoir comment réunir les conditions de leur généralisation ou du moins de leur diffusion partout où ils seraient considérés comme utiles. Mais c'est là un problème général et permanent dans l'enseignement scolaire, et pas seulement dans l'enseignement des langues, comme on peut le voir à propos de l'usage pédagogique des "nouvelles technologies" (cf. par ex. mon article 2016d, "La didactique des langues-cultures face aux innovations technologiques : des comptes rendus d’expérimen-tation aux recherches sur les usages ordinaires des innovations".
Différenciation de l'enseignement, différenciation de l'apprentissage (bis)
Le diaporama intitulé "La différenciation pédagogique, comment faire?" d'une formation officielle (Atelier
encadré Cycles 2 & 3, Circonscription de Grenoble, 2011-2012) offre un bon exemple de "pédagogie différenciée" dans le sens étymologique de l'expression, c'est-à-dire d'un différenciation
conçue comme étant principalement à la charge du pédagogue, de l'enseignant.
La diapositive n° 21 est de ce point de vue très représentative:
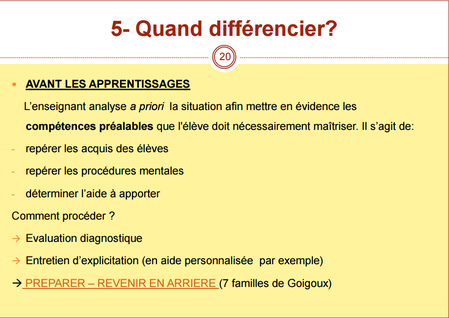
Je me contenterai d'interroger ici l'une des activités de préparation de la différenciation par l'enseignant: "repérer les procédures mentales", citée ici sans autre précision par la suite.
1) S'agit-il des procédures mentales générales, ou de celles que chacun des élèves tend à privilégier en fonction de ce qu'on appelle son "profil cognitif"? Ce n'est pas du tout la même
chose...
Si c'est bien la 2e hypothèse qui est la bonne, comme je le pense étant donné l'idée exprimée dans la première phrase, de multiples questions se posent:
2) Quel modèle de procédures mentales propose-t-on avec des outils opérationnels pour les recueillir?
3) Est-il vraiment raisonnable de penser que l'enseignant puisse repérer les procédures mentales de chacun des élèves?
4) Ces procédures sont-elles stables ? Beaucoup d'études tendent à montrer qu'au contraire elles peuvent varier fortement chez le même élève selon le type de tâches (Klauss Vögel en parle après
d'autres dans son ouvrage L'interlangue, la langue de l'enseignant, Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 1995).
4) Le risque est bien connu d'effectuer ainsi un "étiquetage" des élèves auquel on adapterait ensuite dans la mesure du possible les activités qui leur seraient proposées. Mais enseigner à
apprendre implique plutôt de former les élèves à une différenciation de leurs stratégies d'apprentissage, si l'on part du postulat que plus on dispose de manières d'apprendre, et mieux on
apprend.
On en revient ainsi à la question de l'approche de la diversité/hétérogénéité des élèves, qui doit se faire d'abord et avant en termes de différenciation de l'apprentissage, et non, comme il est
de tradition dans la pédagogie française, de différenciation de l'enseignement. J'ai abordé déjà cette même question (le 9 janvier 2017) dans un autre billet de blog
A l'heure où le "pédagogisme" est dénoncé par le propre ministre de l’Éducation nationale française et où semble se préparer une régression dans la prise en compte des recherches et propositions
pédagogiques en France, il est désormais important, pour les pédagogues, de ne plus prêter aussi facilement le flanc aux critiques, en passant de manière rigoureuse tous leurs textes au tamis de
la faisabilité effective. La pédagogie ne peut se passer d'idéaux, mais le pire service que les pédagogues puissent leur rendre est de faire des propositions irréalistes.
Mettre en oeuvre la pédagogie de projet dans un contexte interdisciplinaire au collège
Je viens de publier dans la rubrique "Mes travaux" le diaporama sonorisé suivant:
2017c. "Mettre en œuvre la pédagogie de projet dans un contexte interdisciplinaire au collège. Approche historiques, problématiques actuelles".
Ce diaporama sonorisé reprend une présentation faite par visio-conférence le 21 mars 2017 à des collègues de disciplines différentes impliqués dans la mise en œuvre des EPI, Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (cycle 4 du collègue, classes de 5e-4e-3e, élèves de 12 à 15 ans). Ces EPI impliquent officiellement la mise en œuvre de la pédagogie de projet. Les trois thèmes successivement abordés sont les suivants : (1) Caractéristiques essentielles de la pédagogie de projet à partir de trois de ses représentants les plus connus (John DEWEY, Ovide DECROLY et Célestin FREINET). (2) Deux caractéristiques de l'environnement actuel qui expliquent pourquoi le projet a été introduit officiellement dans l'enseignement public français (non seulement avec les EPI en cycle 4, mais aussi avec les TPE, travaux personnels encadrés, dans les trois classes suivantes, 2d-1e-terminale, les dernières de l'enseignement scolaire) : il s'agit du "paradigme de l'action" et du "paradigme de complexité". (3) Deux problématiques majeures concernant la mise en œuvre de la pédagogie de projet dans l'enseignement scolaire : la relation autonomie-hétéronomie et l'évaluation.
"Les quatre pièges de l'innovation"
"Le titre de ce billet est entre guillemets, parce qu'il reprend celui d'un article de Philippe WATRELOT, président depuis septembre 2016 du "Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative" (CNIRÉ), publié hier le 28 mars 2017 sur le site The Conversation. L'auteur y annonce la publication prochaine par le CNIRE d'un rapport public sur le thème de l'innovation.
Dans cet article, Philippe WATRELOT commence par présenter ce qu'il appelle "les quatre pièges de l'innovation":
1. L'innovation solitaire et rebelle
2. L'innovation apanage du privé ?
3. L'innovation : discours managérial ?
4. L'injonction à l'innovation.
On lira ces critiques, que je partage très largement. Tout au plus ferais-je noter, à propos du premier point, qu'il aurait fallu faire la différence entre les idées elles-mêmes et leur émergence, d'une part, et d'autre part leur diffusion dans les pratiques ordinaires des enseignants. L'exemple d'un Célestin Freinet, par exemple, montre bien que "l'innovation solitaire et rebelle" fournit parfois l'environnement nécessaire à l'émergence de nouvelles idées, tout autant que ces nouvelles idées, en raison de l'hostilité de l'institution, provoquent récursivement la solitude et la rébellion.
La conclusion à laquelle aboutit l'auteur, à la suite de quatre années d'observation par le CNIRE, est intéressante, parce qu'elle montre une prise de position, dans ce domaine, en faveur d'une orientation processus aux dépens d'une orientation produit (celle de l'idéologie des "bonnes pratiques", qu'il critique par ailleurs justement):
Nous en ressortons avec la conviction que ce qui importe c’est autant la démarche de recherche que l’innovation en elle-même. Plutôt que de parler d’"enseignants
innovants", il nous semble plus pertinent de parler d’enseignants ou de praticiens dans une démarche de recherche.
"Innover" n’est pas un but en soi mais une démarche au service de valeurs. On devrait, nous semble-t-il, parler plutôt de droit à l’expérimentation. Expérimenter, chercher ensemble,
s’évaluer, plutôt qu’à tout prix innover… (je souligne)
L'idée ainsi exprimée (cf. en particulier les passages soulignés) aurait mérité, il me semble, d'être prolongée logiquement jusqu'à la remise en cause de la place et du statut du concept d'"innovation" chez les chercheurs et responsables éducatifs. L'auteur continue à parler, dans ces lignes et dans les lignes précédentes, d'une "démarche d'innovation", alors qu'il aurait dû ressentir en définitive cette expression comme un véritable oxymore : l'innovation en elle-même ne peut être une démarche, puisqu'elle vise la production de nouvelles pratiques. La démarche de projet, pour prendre un exemple parallèle, n'est pas plus "une démarche de production" que la démarche de recherche n'est une "démarche d'innovation". Dans les deux cas, le produit (la production, l'innovation) n'est pas le processus (le projet, la recherche), même si le premier est le support et le ressort du second.
Je suis par ailleurs persuadé que le changement durable passe moins par l'innovation que par la restauration, l'adaptation et la combinaison, dans une perspective de gestion de la complexité, de toutes les options pédagogiques et didactiques anciennes mais encore pertinentes, qui sont d'une richesse largement inexploitée, parce qu'elles sont oubliées ou ignorées. L'analyse historique montre ainsi à quel point Célestin Freinet s'inscrit dans la tradition ancienne mais toujours pertinente de la "pédagogie active", dont l'un des premiers représentants, John Dewey (1859-1952), avait par ailleurs - lui et plus encore les enseignants qui avaient mis en œuvre ses idées - élaboré dès la fin du XIXe siècle le premier modèle fonctionnel de la pédagogie de projet (cf. l'excellent article de HOUGARDY A., HUBERT S. & PETIT C., "Pédagogie du projet ?", juin 2001).
Ma critique vaut tout particulièrement pour les innovations technologiques, qui constituent le plus souvent ce qu'il faut bien appeler une fuite en avant. Ce dont la grande majorité des enseignants ont d'abord besoin, c'est du râtelier de l'artisan et non d'un laboratoire encombré d'outils high-tech, ne serait-ce que parce qu'il leur faut déjà pouvoir gérer efficacement et confortablement leur quotidien pour pouvoir assumer les risques inhérents à l'innovation technologique.
Sur la notion de changement durable et la critique de l'idéologie de l'innovation technologique, on pourra lire ou relire en particulier mes textes suivants:
Articles, conférences ou diaporamas
- 2017b. "Culture numérique et culture universitaire en filière langues, littératures et cultures étrangères (LLCE) : quelle stratégie durable ?" (voir en part. le chap. "Les sept piliers du changement durable")
- 2016d. "La didactique des langues-cultures face aux innovations technologiques : des comptes rendus d’expérimentation aux recherches sur les
usages ordinaires des innovations"
- 2009e. "Nouvelle perspective actionnelle et (nouvelles) technologies éducatives : quelles convergences... et quelles divergences ? "
- 2009b. "Variations sur la perspective de l'agir social en didactique des langues-cultures étrangères", Chap. 7. "Agir avec les Nouvelles
Technologies Éducatives"
- 2006f. "De l’approche communicative à la perspective actionnelle. À propos de l’évolution parallèle des modèles d’innovation et de conception
en didactique des langues-cultures et en management d’entreprise"
- 2006a. "Comment harmoniser le système d’évaluation français avec le Cadre Européen Commun de Référence ?" (Diapo 28, point 4)
- 1990c. "Continuités, ruptures et circularités dans l'évolution de la didactique des langues étrangères en France" (voir déjà la présentation)
Billets de blog
- 17 février 2015. "Technologies numériques et innovation durable"
- 23 décembre 2014. "La "classe inversée" à
l'université comme moyen d'y amorcer le changement pédagogique"
- 06 décembre 2013. "Le débat français sur PISA 2012 exige
un "toilettage conceptuel" (J.-Y. Rochex)" (point 4)
Ce n'est que récemment (en 2015-2016) que j'ai progressivement pris conscience de la nécessité d'opposer clairement la notion d'"innovation" (correspondant à des productions locales et ponctuelles) à la notion de "changement" (correspondant à un processus général et permanent). Dans mon article "Culture numérique et culture universitaire en filière langues, littératures et cultures étrangères (LLCE) : quelle stratégie durable ?", rédigé en 2015 mais publié seulement en 2017 dans un ouvrage collectif (et en avril 2018 sur mon site : 2017b), j'ai d'ailleurs demandé de remplacer "innovation" par "changement" trop tardivement pour que les coordonnatrices de l'ouvrage puissent en tenir compte...
Publication d'un article sur l'"innovation durable" dans la pédagogie universitaire
Dans un billet de mon Blog-Notes en date du 21 septembre 2014 ( "Un exemple de dispositif de formation collaborative à la culture de la recherche en didactique des langues-cultures"), j'annonçais la publication prochaine d'un article intitulé "Culture universitaire et culture numérique: faire converger pour innover" dans un ouvrage collectif intitulé Dispositifs numériques pour l’enseignement des langues, littératures et civilisations étrangères à paraître en 2015.
La publication a pris du retard, mais l'ouvrage vient de paraître avec mon article, dont le titre a été entre-temps modifié et la taille augmentée (à 29 pages) en réponse à l'élargissement de sa thématique :
– « Culture numérique et culture universitaire en filière langues, littératures et cultures étrangères (LLCE) : quelle stratégie durable ?, pp. 21-49 in : ROUISSI Soufiane, PORTES Lidwine & STULIC Ana (dir.), Dispositifs numériques pour l'enseignement à l'université. Le recours au numérique pour enseigner les langues, les littératures et civilisations étrangères, Paris : L’Harmattan, 2017, 204 p.
En voici le sommaire, auquel j'ai ajouté entre parenthèses deux sous-titres qui améliorent la compréhension de sa structure:
(Cadre conceptuel)
- "L'innovation durable"
- "Culture"
- "Culture numérique"
(Contexte actuel)
- Une "nouvelle culture didactique"
- Une "nouvelle culture générale"
- La "culture universitaire" actuelle en filière LLCE
- La valorisation de la spécialisation
2. Partir de la culture numérique des étudiants
3. Définir le périmètre de l'innovation
4. Prendre en compte chez les enseignants les niveaux d'investissement différents
5. Rechercher les gisements d'économie d'investissement
6. Mettre en oeuvre la démarche de projet
7. Placer l'évaluation des étudiants au coeur du dispositif
En guise de brève conclusion prospective
Cette conclusion est la suivante:
Pour la filière LLCE, la stratégie d’innovation durable, avec le recours systématique aux technologies numériques qu’elle implique désormais, ne sont pas un luxe qui pourrait être réservé aux universités jouant la carte de l’excellence ou aux enseignants passionnés de technologies nouvelles : c’est la condition à laquelle cette filière en tant que telle pourra continuer à défendre dans le monde actuel les valeurs humanistes dont elle se réclame depuis sa création.
Cela exige que ses enseignants ne se cantonnent pas dans une attitude défensive, de rejet des évolutions et de réaction face aux menaces, mais qu’ils adoptent, comme le veut d’ailleurs la démarche de projet et la perspective actionnelle, une attitude proactive qui leur permette de devancer activement les évolutions à venir, de manière à peser sur elles quand il est encore temps. S’ils ne veulent pas finalement se voir imposer des solutions radicales inacceptables, il faut qu’ils intègrent dès à présent, dans leur stratégie collective d’innovation durable, des réflexions et des propositions sur deux éléments qui constituent en l’état deux énormes verrous culturels : l’absence d’évaluation des enseignants et les actuels concours de recrutement d’enseignants du secondaire.
Je pourrais envoyer un "tiré-à-part" de cet article sous forme de fichier pdf à quelques collègues enseignant en France en filière LLCE qui m'en feraient la demande à mon adresse professionnelle.
La problématique de l'autonomie en milieu scolaire, "entre émancipation et normalisation"
Le titre de ce billet s'inspire du titre d'un numéro de revue intitulé "L'autonomie de l'élève : émancipation ou normalisation ?". Un des articles m'a particulièrement intéressé :
FURLER Héloïse, "Les pratiques du gouvernement de soi à l'école : les dispositifs pédagogiques de l'autonomie et leurs contradictions", Recherches en Education n° 20, octobre 2014, "L'autonomie de l'élève : émancipation ou normalisation ?", Revue de l'université de Nantes, UFR Lettres et langage, pp. 76-86. Lien direct de téléchargement de l'ensemble du numéro.
Dans ce compte rendu de recherche, l'auteure "problématise" en effet constamment, à partir d'une analyse ethnographique (observations de classes enfantines et primaires, entretiens d'enseignants, d'élèves et de parents), la question de l'autonomie des élèves. Parce que l'autonomie est à la fois l'objectif et le moyen, cette question se trouve prise dans une contradiction fondamentale : on forme les élèves à l'autonomie en leur demandant d'être autonomes... ce qu'ils ne sont justement pas (et les plus faibles le sont en général moins que les autres).
Cette contradiction est bien connue, mais l'intérêt de la recherche présentée est qu'elle va plus loin en étudiant finement "les pratiques [des enseignants] qui accompagnent l'injonction à l'autonomie dans le cadre scolaire".
L'auteure dégage en particulier quatre formes d'engagement exigé des élèves ("intellectuel", "instrumental", "moral" et "expressif"), ainsi que les grandes stratégies mises en œuvre par les enseignants pour gérer cette contradiction : ce sont l'"investissement" (l'enseignant se surinvestit professionnellement dans sa classe et son établissement), la "coercition" (l'enseignant maintient paradoxalement un haut degré de directivité), la "distanciation" (l'enseignant reporte ses difficultés dans l'autonomisation des élèves sur la responsabilité des élèves eux-mêmes, des parents et des intervenants extérieurs à l'école), enfin l'"orientation des pratiques parentales" (l'enseignant tente de mettre les parents au service de ses intentions pédagogiques).
Les tout derniers mots de la conclusion de l'article attirent à nouveau l'attention sur un risque déjà bien repéré par les chercheurs :
Le danger réside dans le fait que les dispositifs pédagogiques de l'autonomie, parce qu'ils les considèrent comme allant de soi, tendent à écarter la question des conditions sociales qui rendent possible l'engagement de l'élève et favorisent sa réussite scolaire. En ignorant ces conditions, on court le risque de voir s’aggraver les difficultés scolaires de ceux qui ne possèdent pas les ressources pour « apprendre de manière autonome » au sein des dispositifs, et s’accroître les inégalités sociales de réussite scolaire dès l’école élémentaire. (p. 85)
Cet article me semble venir s'ajouter avec profit aux considérations que j'ai développées depuis quelques années sur la complexité de la problématique de l'autonomie en milieu scolaire. Il est extrêmement simpliste du point de vue de l'analyse pédagogique de conclure qu'il faut exiger de l'enseignant qu'il parvienne à une progression constante dans le processus d'autonomisation de ses élèves : cela peut être contreproductif du point de vue didactique, injuste socialement (pour les élèves) et culpabilisant pour l'enseignant (qui forcément ne peut pas y parvenir). C'est pourtant une telle exigence qui se dégageait globalement des premiers travaux en FLE sur l'autonomie, dans les années 80-90, et à ma connaissance ces travaux n'ont pas fait depuis l'objet d'un réexamen collectif de la part des didacticiens de cette discipline.
On pourra voir ou revoir sur mon site, à propos de cette problématique de l'autonomie des apprenants, les documents suivants :
- 1996b. "Problématique de l'autonomie et explication de textes dans la tradition hispanique : du questionnement comme méthode d'enseignement au
questionnement comme méthode d'apprentissage".
- 2000c. "Du guidage à l’autonomie dans la lecture des textes littéraires en classe de langue".
- 2010f. "L'autonomie dans la nouvelle perspective actionnelle : une problématique à reconsidérer".
- 2014d. "Contrôle vs. autonomie, contrôle et autonomie : deux dynamiques à la fois antagonistes et complémentaires".
- 2015d. "Approche actionnelle et autonomie : nouveaux enjeux dans l'enseignement et l'apprentissage des langues" (conférence vidéoscopée,
1h05).
On notera à leurs seuls titres que dans mes deux premiers articles, de 1996 et 2000, j'étais moi aussi influencé par l'idée que l'autonomie se réduisait à l'"autonomisation", c'est-à-dire à une progression que l'enseignant devait assurer constamment vers plus d'autonomie de l'apprenant, et ce alors même que j'avais déjà développé dès 1995 une critique de l'idéologie de la "centration sur l'apprenant" (1995a).
Entre ces deux articles et ceux des années 2000-2001, j'ai complexifié ma conception de la relation entre le processus d'enseignement et le processus d'apprentissage : je renvoie sur ce point au document "Un « méta-modèle » complexe : typologie des différentes relations logiques possibles entre deux bornes opposées" (document 022): les différents modes de relation que j'y présente doivent aussi s'appliquer, comme je le montre dans mon article 2014d, aux deux bornes opposées que sont l'hétéronomie et l'autonomie. De même que la "pédagogie différenciée" ne peut se mettre en œuvre sans articuler sur des modes différenciés la différenciation de l'enseignement et la différenciation de l'apprentissage (cf. mon précédent billet du 9 février 2017), la gestion de la problématique de l'autonomie ne peut se faire sans modulations différenciées des degrés de liberté de l'apprenant et des degrés de directivité de l'enseignant. Dans un environnement d'enseignement-apprentissage collectif, et d'enseignement-apprentissage d'un objet aussi normé lui-même qu'une langue, l'émancipation et la normalisation (si on veut bien retirer à ce dernier concept ses connotations historiques très négatives...) sont clairement deux processus à la fois antagonistes et complémentaires.
Différenciation de l'enseignement, différenciation de l'apprentissage
Laurent VILLEMONTEIX, professeur-formateur académique, a publié sur le site de l'Académie de Paris un dossier intitulé "Mettre en œuvre la différenciation pédagogique en lettres". Il s'agit de français langue maternelle, mais qui peut inspirer un travail en pédagogie différenciée sur la littérature avec des élèves avancés en langue étrangère. Il y propose :
a) un "dossier complet" au format pdf, avec :
- les postulats et principes de la pédagogie différenciée, ses modes de mise en œuvre, ses "obstacles et écueils" ;
- un exemple concret de différenciation en classe de 3e, sous la forme de 4 scénarios pédagogiques appliqués à une même nouvelle littéraire ;
- 10 fiches techniques d'"outils" (plan de travail, tutorat entre pairs, atelier, groupes de besoin, etc.) ;
- un lexique (bien trop succinct) et une bibliographie classique, où l'on retrouve en autres les grandes références des spécialistes en sciences de l'éducation qui on écrit sur la question : Astolfi, Gillig (dir.), Legrand, Meirieu, Perrenoud et Przesmycki ;
b) un "tableau des différents dispositifs de différenciation".
Ce tableau reprend une typologie des domaines de différenciation déjà utilisée dans le dossier: contenus, processus d'apprentissage, structuration du travail en classe, productions des
élèves. Cette typologie pose problème. Par exemple, le domaine "productions des élèves" recoupe celui de la "structuration du travail en classe" ("Donner le choix des supports, des
outils, selon les activités, mais aussi moduler le format ou le type de travail au sein d’une même activité..."), alors qu'il me semblerait plus logique de considérer les productions des
élèves comme un élément particulier d'un domaine plus général, celui des "tâches" (lesquelles peuvent comprendre également la recherche de la documentation, la prise de notes, etc.).
Autre exemple : les éléments de la rubrique "pratiques", en "suggestions de pratiques", auraient dû bénéficier d'un classement interne qui y mette un minimum d'ordre : on trouve ainsi, en
"matériel didactique", aussi bien "exploiter l'interdisciplinarité des notions et des concepts" et "offrir des occasions de travailler en équipe", que "aérer le texte" et "grossir le format des
caractères".
J'avais moi-même proposé dans les "Livrets de formation à l'autoformation à l'intervention en pédagogie différenciée en classe de langue" une typologie différente des domaines de différenciation (objectifs, contenus, supports, dispositifs, aides et guidages, tâches, méthodes) que je ne reprendrais pas actuellement à l'identique, le concept de "dispositif", tel que je le conçois actuellement, incluant les supports ainsi que les aides et guidages (cf. «Le champ sémantique de l'"environnement" en didactique des langues-cultures», Document 030) : il est constitué de l'ensemble des éléments construits par l'enseignant pour opérer cette "structuration du travail" dont parle Laurent VILLEMONTEIX.
J'ai signalé dans un billet de blog en date du 9 septembre 2013 la publication sur le site du Café pédagogique d'un "pense-bête" de Sylvain GRANSERRE sur la mise en œuvre de la différenciation pédagogique avec des élèves de primaire. Il repérait pour sa part comme domaines de différenciation le temps, la difficulté, les outils, la quantité de travail, les aides, l'autonomie et l'organisation.
Son petit texte de "conseils" me semble, à la relecture, toujours aussi bien conçu, parce que ses propositions sont à la fois simples, réalistes et pourtant porteuses de changement : il s'agit fondamentalement de donner plus d'aide et de guidage à ceux qui ont le plus de besoins, tout en permettant aux meilleurs de prendre tout ce qu'ils sont en mesure de prendre eux-mêmes. Il faut, écrit-il, "inverser l’idée qu’on se fait du travail collectif en classe : non pas une tâche que ne finissent jamais les derniers, mais un travail que tout le monde réalise, la différenciation intervenant pour ceux qui ont réussi le plus vite au travers d’activités en autonomie." Pour le dire avec mes concepts : la différenciation de l'enseignement intervient pour le travail obligatoire, la différenciation de l'apprentissage pour les activités supplémentaires optatives.
La nécessité d'articuler constamment ces deux différenciations, sous cette forme ou sous une autre, m'était clairement apparue au cours d'un programme de coopération européenne que j'avais dirigé sur la différenciation pédagogique. On pourra se reporter, parmi l'une des productions auxquelles a donné lieu ce programme, à l'article que j'avais écrit à l'époque en collaboration avec Paola Bertocchini, et dont le titre annonçait déjà cette idée des deux différenciations : "Entre ‘pédagogie différenciée’ et ‘apprentissage autonome’" (2001k).
Si elles n'intègrent pas l'idée de "différenciation de l'apprentissage", c'est-à-dire si elles ne se basent que sur la différenciation de l'enseignement, les mises en œuvre de la "pédagogie différenciée" (l'expression elle-même est uniquement orientée enseignement : le "pédagogue", c'est l'enseignant...) échappent difficilement à deux écueils opposés :
- construire de véritables "usines à gaz" méthodologiques certes innovantes, mais qu'un enseignant n'aura jamais le temps ni l'énergie de reproduire constamment dans ses pratiques quotidiennes, même en n'utilisant que des fiches toutes faites préparées par d'autres enseignants : c'est la réserve que j'ai pour ma part vis-à-vis de l'ensemble des quatre scénarios de Laurent VILLEMONTEIX, même s'ils sont très bien conçus du point de vue... de l'enseignement ;
- ou à l'inverse reprendre des pratiques d'enseignement traditionnelles qui vont se révéler d'autant plus limitées qu'on va devoir les "répartir" simplement entre les groupes d'élèves : c'est la critique que j'adresserais, par exemple, aux propositions faites l'année dernière par Serge Vercher dans le dossier qu'il publie sur un autre site académique. Voir, dans le diaporama de ce dossier, la diapositive n° 21, qui est une "fiche d'aide à l'expression écrite" différenciée selon les niveaux A2-, A2+ et B1 du CECRL (diapositive n° 21/26) : le décalage est réellement impressionnant, dans ce document, entre les techniques proposées là, aussi limitées qu'habituelles en didactique scolaire de l'espagnol en France, et les considérations théoriques très complexes sur les différentes formes de mémoire, d'intelligence et de profils cognitifs présentées dans les diapositives précédentes.
C'est sur cette articulation entre différenciation de l'enseignement et différenciation de l'apprentissage qu'il faut souhaiter voir se multiplier, dans la recherche en didactique des langues-cultures des prochaines années, la publication de comptes rendus et bilans non pas de lourdes expérimentations, mais d'expériences réalistes, plus susceptibles que d'inciter de nombreux enseignants à un changement durable au sein de leurs pratiques ordinaires : sur cette idée, et tous ces concepts, on pourra se reporter à mon article 2016d, où ils sont utilisés pour une réflexion sur la relation entre les innovations technologiques et l'innovation didactique : ils sont tout aussi indispensables, à mon avis, pour penser la relation entre l'innovation didactique et les innovations pédagogiques, telles que la pédagogie différenciée ou la pédagogie inversée.
L'Éducation aux Médias et à l’Information (EMI), finalité naturelle de la perspective actionnelle en enseignement scolaire
L'UNESCO a publié il y a quelques années un document intéressant pour la mise en œuvre de la perspective actionnelle en contexte scolaire : Éducation aux médias et à l’information. Programme de formation pour les enseignants, UNESCO, 2012, 207 pages dont un glossaire final de 12 pages (dernière consultation 25/01/2017).
Le concept ici proposé d'"Éducation aux Médias et à l'Information, EMI", regroupe celui d'"éducation aux médias" et celui de la "maîtrise de l'information" présenté dans un ouvrage publié également par l'UNESCO en 2008 (FOREST WOODY HORTON, Jr., Introduction à la maîtrise de l’information, Paris : UNESCO, 2008, 112 p., ).
J'ai à plusieurs prises déjà fait référence à cet ouvrage de 2008 dans mes travaux, parce que la "maîtrise de l'information" correspond à la "compétence informationnelle" qui vient prendre, dans la perspective actionnelle, la place qu'occupait la "compétence communicative" dans l'approche communicative (voir mon article 2009c). Le concept d'"Éducation aux Médias et à l'Information" a l'intérêt de relier la compétence informationnelle au projet de formation citoyenne, celle d'"acteur social", qui est la finalité de la perspective actionnelle lorsqu'elle est mise en œuvre en milieu scolaire.
Les objectifs de formation des enseignants à "l'évaluation des médias et de l’information", présentés p. 31 dans document de l'UNESCO de 2012, valent aussi comme objectifs de formation des élèves en perspective actionnelle :
La résolution de problèmes et la pensée critique sont au cœur de l’apprentissage dans toutes les disciplines scolaires et dans la vie quotidienne. Les problèmes deviennent des occasions pour une évaluation critique des textes médiatiques et des informations provenant de sources diverses.
L’objectif ici est de développer la capacité des enseignants à évaluer les sources et les informations sur la base notamment des fonctions de service public normalement attribuées aux médias publics, bibliothèques, archives et autres diffuseurs d’information.
Un autre objectif est de faire connaître aux enseignants les actions qui peuvent être entreprises lorsque ces institutions s’écartent des rôles attendus. Les enseignants devraient être en mesure d’examiner et de comprendre comment les contenus médiatiques et autres informations sont produits, comment l’information diffusée par ces institutions peut être évaluée, et comment les médias et l’information peuvent être utilisés à des fins diverses. En outre, les enseignants devraient être capables d’explorer la question de la représentation dans différents médias et institutions d’information ainsi que la manière dont les médias locaux et mondiaux traitent la diversité et le pluralisme.
Enfin, les enseignants doivent développer la capacité d’évaluer comment les étudiants interprètent les messages médiatiques et les informations provenant de sources diverses. (p. 31)
Et les "compétences EMI" que les enseignants doivent posséder sont aussi celles qu'ils doivent fixer comme objectifs d'enseignement (voir leur présentation pp. 34-39):
1. Comprendre le rôle des médias et de l’information dans la démocratie
2. Comprendre le contenu des médias et ses utilisations
3. Accéder à l’information de façon efficace et efficiente
4. Évaluer l’information et les sources d’information de manière
critique
5. Utiliser les formats de médias traditionnels et nouveaux
6. Situer le contexte socioculturel du contenu des médias
Cet ouvrage de 2012 de l'UNESCO propose ensuite une série d'approches pédagogiques que les enseignants peuvent utiliser pour l'Éducation aux Médias et à l'Information de leurs élèves (voir leur présentation pp. 40-43) :
I. L'approche "problématique-recherche"
II L'apprentissage par problèmes (APP)
III. L'enquête scientifique
IV. L'étude de cas
V. L'apprentissage coopératif [incluant "l'apprentissage par projet"]
VI. L'analyse textuelle
VII. L'analyse contextuelle
VIII. Les réécritures
IX. Les simulations
X. La production
L'ouvrage présente enfin les 11 "modules" de formation des enseignants à l'EMI, et leurs différentes "unités" avec leurs contenus :
Module 1 : La citoyenneté, la liberté d’expression et d’information, l’accès a l’information, le débat démocratique et l’apprentissage tout au long de la vie
Module 2 : Comprendre les informations, la déontologie des médias et l’éthique de l’information
Module 3 : La représentation dans les médias et l’information
Module 4 : Les langages dans les médias et l’information
Module 5 : La publicité
Module 6 : Les médias nouveaux et traditionnels
Module 7 : Les opportunités et les défis d’internet
Module 8 : La maîtrise de l’information et les compétences documentaires
Module 9 : La communication, l’EMI et l’apprentissage – Un module de synthèse
Module 10 : Le public
Module 11 : Les médias, la technologie et le village planétaire
À propos de l’ouvrage de François JULLIEN : Il n'y a pas d'identité culturelle (2016)
Le journal Libération a publié dans son édition du samedi 1er et dimanche 2 octobre derniers, pp. 20-21, l'interview du philosophe et sinologue français bien connu, François JULLIEN, à propos de son dernier livre, Il n'y a pas d'identité culturelle (Éd. de l’Herne, 2016).
Le titre donné à l'interview par la journaliste (« Une culture n’a pas d’identité car elle ne cesse de se transformer ») est très réducteur par rapport aux propos qu'elle-même rapporte, mais ces propos sont intéressants parce qu'ils rejoignent les idées d'un Jacques DEMORGON ou encore d'un Francis DUBET, qui mettent en évidence l'insuffisance des concepts d'interculturel et d'interculturalité pour penser les enjeux de la vie commune, de la citoyenneté et du travail collectif dans une société multilingue et multiculturelle : voir les références au premier auteur dans mon article 2001j, et au second dans le Post-scriptum sur la page de téléchargement de ce même article.
Dans la suite de ce billet, je signale par la lettre « a », les idées rapportées de François JULLIEN, et par la lettre « b » celles qu'elles me suggèrent pour la didactique des langues-cultures.
1a. Pour F. Jullien, il n'existe pas d' « identité culturelle » objective, mais seulement « le processus d'identification par lequel un individu se constitue en sujet ».
1b. Il s’agit là d’une critique décisive du « culturalisme » dans lequel est tombée l’approche interculturelle, du moins dans ses premières versions. La « rencontre interculturelle » de l'approche communicative-interculturelle – dont le modèle a été le voyage touristique, voir mon article 2014a) –, n'est pas, comme l'écrivait déjà Martine ABDALLAH-PRETCEILLE en 1986, la rencontre entre deux cultures, mais entre deux sujets qui ont construit plus ou moins librement et consciemment une identité culturelle complexe (voir mon article 1998f, chap. 2.2.3, pp. 16-18). On retrouve là l’idée d' « homme pluriel » de Bernard LAHIRE (titre de son ouvrage de 1988), qui apparaît aussi dans le « pluralisme motivationnel » que constate Florence PASSY dans sa recherche sur l'altruisme politique et l'engagement protestataire (voir mon billet de blog en date du 17 avril 2012).
2a. F. Jullien poursuit : « D’autre part, identité va de pair avec "différence". Or, la différence sert seulement à ranger ; et l’on prétend identifier ainsi les caractéristiques de chaque culture. [...] il n’y a pas de différences culturelles, il y a ce que j’appelle des écarts. [...] Dans la différence, une fois la distinction faite, chacun des termes s’en retourne de son côté. L’écart permet, en revanche, aux deux termes de rester en regard. Et cette tension est féconde. Chacun y reste dépendant l’un de l’autre pour se connaître et ne peut se replier sur ce qui serait son identité. […] Parce qu’il [l'écart] ouvre une distance, fait apparaître de l’entre, où se produit du commun. Du commun qui n’est pas le semblable – cette distinction est essentielle. […] La consistance d’une société tient à la fois à sa capacité d’écarts et de commun partagé : d’écarts au travers desquels du commun peut se promouvoir et se partager. »
2b. Cette critique des différences trouve chez moi un écho. Cela fait des années – je l'ai écrit dans un article rédigé l'année de publication du CECRL et publié en 2002 – que je défends l'idée que « lorsqu'il s'agit non plus seulement de "vivre ensemble" (coexister ou cohabiter), mais de "faire ensemble" (co-agir), nous ne pouvons plus nous contenter d'assumer nos différences : il nous faut impérativement créer ensemble des ressemblances » (2002b, p. 8). Par ailleurs, dans un article récent (2015f), j'ai écrit : « Dans les sociétés qui cultivent le pluralisme culturel, la démocratie doit forcément être pluraliste, et dans une démocratie pluraliste, ont toute légitimité à défendre leurs idées ceux qui réclament un droit personnel à "l’indifférence aux différences" ».
Par contre, le concept de « commun », qu'utilise F. Jullien, me semble plus juste que celui de « ressemblance », que j'ai constamment utilisé depuis cet article de 2002, et qui correspond à celui de « semblable », que F. Jullien critique à juste titre : le concept de « ressemblance », tout autant que celui de « différence », postule en effet l'existence d' « identités » qui seraient objectivables.
3a. F. Jullien propose logiquement d'abandonner ce concept d' « identité », et de le remplacer par celui de « ressources » : « Les ressources ne sont pas une notion idéologique : elles ne se "prêchent" pas, contrairement aux valeurs. Défendre des "valeurs françaises" s’inscrit dans un rapport de force[s], alors que les ressources sont à la disposition de chacun. » À la question de la journaliste, « Comment éviter que le commun se fissure ? », il répond : « Il faut pour cela activer nos ressources culturelles, c’est en ce sens que j’entends "défendre". Il faut se demander quelles sont les ressources que l’on peut exploiter aujourd’hui, à partir desquelles du commun peut se produire. J’aimerais un grand débat sur ce sujet en France. La culture française, est-ce La Fontaine ou Rimbaud ? C’est autant l’un que l’autre, c’est l’écart entre les deux. C’est cette tension entre les deux qui est féconde et fait ressource. »
3b. L'idée de « ressources culturelles » est parfaitement en accord avec la logique de la perspective actionnelle : dans chaque séquence ou unité didactique, les élèves sont invités à rechercher et acquérir les ressources langagières et culturelles nécessaires pour la réalisation de leur projet commun.
Par contre, contrairement à F. Jullien, je ne vois pas pourquoi il faudrait abandonner les valeurs universelles : elles peuvent certes être exploitées au profit de certains (elles l'ont été par exemple au service du colonialisme européen) ; mais elles ont été aussi revendiquées, et le sont encore, par des militants de la cause démocratique dans le monde entier.
Je ne vois pas davantage pourquoi l'idée de « valeurs françaises » devrait être abandonnée en raison des manipulations et instrumentalisations auxquelles elle a été et est encore soumise : parmi ces « valeurs françaises », je place pour ma part cette ouverture d'esprit qui permet aux Français de considérer que leur culture, c'est tout autant La Fontaine que Rimbaud, et cette « tension » entre les deux dont parle F. Jullien… Dans mon article 2015f déjà cité supra, je terminais ainsi le passage cité supra en 2b : « [dans une démocratie pluraliste, ont toute légitimité à défendre leurs idées ceux qui réclament…] un droit collectif au rejet de différences qu’ils considèrent comme contraires aux valeurs fondant le lien social, qu’elles soient universelles ou locales : dans une société pluraliste, le principe fondamental n’est pas le respect des différences, mais le respect des différends. »
Je ne vois pas enfin comment il serait possible de ne pas s’inscrire concrètement dans un rapport de forces. « Que dire – me fait remarquer mon collègue Michel MOREL à la lecture de ce billet –, quand les valeurs locales fondant le lien social sont contraires aux valeurs universelles, et que certains veulent faire valoir ces dernières en prenant le risque de rompre le lien social ? » À l’inverse, peut-on ajouter, que dire quand les valeurs universelles fondant le lien social sont contraires aux valeurs locales (i.e. de certains communautés), et que certains veulent faire valoir ces dernières en prenant le risque de rompre le lien social ? Je considère, si du moins ce sont tous des citoyens du même pays, qu'ils doivent faire savoir ce différend en disant qu'ils n'acceptent pas cette différence... Ils ont le droit de le dire – c'est le principe du « dissensus démocratique » –, mais c'est bien le rapport de forces existant, celui qui dans leur pays a créé les lois et qui les y fait éventuellement évoluer, qui va décider du résultat, à savoir quelles valeurs parviendront finalement à s'imposer contre les autres.
4a. F. Jullien dit d'ailleurs, plus loin dans cet entretien : « Je ne renonce donc pas à l’exigence d’universel, au sens prescriptif, au sens fort, y compris dans le champ politique. Mais en même temps, je pense que cet universel n’est jamais satisfait […]. Il est un idéal qui, parce qu’il n’est jamais satisfait, ne cesse de faire progresser et déploie plus loin le commun. »
4b. Cet « universel prescriptif » ne peut se passer de valeurs universelles, pour la poursuite desquelles les « ressources culturelles », comme l’indique le concept même choisi par J. Jullien, ne peuvent être que des moyens, et non des fins en elles-mêmes ; et le champ politique ne peut fonctionner, en démocratie, sans le jeu des rapports de forces.
5a. F. Jullien poursuit : « Il ne faut donc pas renoncer à cette exigence d’universel en se contentant, comme on le fait aujourd’hui, d’invoquer la tolérance. La tolérance relève souvent de la résignation et du compromis : on supporte l’autre. Or ce n’est pas ainsi que l’on produira un commun actif, intensif, qui puisse conférer de l’élan à nos sociétés. »
5b. Je ne peux que partager à nouveau les idées de F. Jullien, que ce soit lorsqu’il critique une tolérance trop exclusivement mise en avant dans l'approche interculturelle, ou lorsqu’il promeut ce « commun actif, intensif, qui puisse conférer de l’élan à nos sociétés » : c'est ce qu'on appelle, je crois, un « projet de société », à l’image de celui qui, dans la perspective actionnelle, réunit tous les élèves pour un « faire ensemble », tant dans la société classe que dans la société extérieure.
Christian Puren, 19 décembre 2016
"La fin du mythe de l'individu acteur de son apprentissage"
Dans la dernière lettre du site Thot Cursus (http://cursus.edu/) est publié cet article (non signé, donc sans doute de la rédaction du site) qui rappelle un effet déjà bien connu des dispositifs d'apprentissage autonome proposés sans préparation et accompagnement, à savoir qu'ils ne profitent qu'aux apprenants les meilleurs, parce que ce sont les plus autonomes, et qu'ils pénalisent les autres. L'intérêt de cet article est qu'il utilise efficacement, pour développer cette idée, le modèle de la compétence proposé par Guy LE BOTERF : pouvoir, vouloir et savoir agir - en l'occurrence, donc : pouvoir, vouloir et savoir apprendre.
A l'occasion de la lecture de cet article, on pourra aussi:
- - (re) lire mes remarques sur ce modèle de Le Boterf dans ma dernière publication : 2016g, chap. 3.2.2, pp. 46-47);
- - et (re)voir mon "méta-modèle" des relations entre les processus d'enseignement et d'apprentissage : dans l'espace entre les deux extrêmes, le "curseur" (qui détermine le niveau de directivité ou d'autonomie) doit être positionné en fonction des besoins de chaque apprenant.
Une plateforme gratuite d'analyse collaborative de documents
La dernière lettre d'information du site cursus.edu présente hypothes.is, qui "propose une plate-forme ouverte, gratuite, sans but lucratif et neutre pour faciliter l'annotation critique associée aux nouvelles, blogues, articles scientifiques, livres, lois et autres documents circulant dans Internet, et ce de manière transparente et communautaire. Personne n'a la propriété du système, il est collectif et le standard utilisé est ouvert."
Cet outil me semble a priori très intéressant pour le travail à distance de groupes d'étudiants - dans le cadre de formations institutionnelles, ou de groupes de travail auto-organisés - sur des articles ou des documents de travail.
L'utilisation parallèle d'un logiciel d'"aspiration" de site (tel que Httrack, logiciel gratuit et libre) devrait permettre de conserver et mettre à jour régulièrement une copie offline des travaux.
Une langue étrangère parlée en famille peut-elle être considérée comme un "facteur de risque" à l’école, voire un "déterminant" de l'échec scolaire des élèves
On peut lire ceci dans un rapport PISA récemment publié :
De multiples facteurs de risque à l’œuvre simultanément
Les analyses montrent que l’obtention de mauvais résultats scolaires à l’âge de 15 ans ne résulte pas de l’action d’un facteur de risque isolé, mais plutôt de la combinaison et de
l’accumulation de différents obstacles et désavantages entravant le parcours des élèves tout au long de leur vie.
Qui sont les élèves les plus susceptibles d’être peu performants en mathématiques ? En moyenne, dans les pays de l’OCDE, une fille issue d’un milieu socio-économique défavorisé, vivant dans
une famille monoparentale en zone rurale, issue de l’immigration, parlant en famille une autre langue que la langue d’enseignement, n’ayant pas été préscolarisée, ayant déjà
redoublé une classe et suivant une filière professionnelle a une probabilité de 83 % d’être peu performante.
Si ces facteurs contextuels peuvent affecter l’ensemble des élèves, parmi les moins performants, la combinaison des facteurs de risque est plus préjudiciable aux élèves issus d’un milieu
défavorisé qu’à leurs pairs favorisés. (pp. 5-6)
PISA. Les élèves en difficulté. Pourquoi décrochent-ils
et comment les aider à réussir ? OCDE, 2016, 47 p.
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-Les-eleves-en-difficulte.pdf,
Je souligne le passage de la citation: les auteurs de ce rapport passent abusivement, en ce qui concerne ce facteur linguistique, de ce qui est une corrélation (il se trouve que dans ces familles
présentant telles et telles caractéristiques, on parle aussi très souvent une langue étrangère en famille) à sa qualification en tant que facteur de risque au même titre que les autres. Or il en
est de ce facteur comme de l'autre qui lui est directement lié, "issu de l'immigration" : on peut faire l'hypothèse, sur la base de multiples cas attestés, que si les autres facteurs sont
inversés (milieu socio-culturel favorisé, une bonne scolarisation antérieure des parents dans leur langue maternelle, famille bi-parentale en zone urbaine), les facteurs "autre culture familiale"
et "autre langue parlée en famille" agissent non pas comme "des obstacles et désavantages", mais à l’inverse comme des facilitateurs et des avantages ; et ceci contrairement aux autres facteurs,
dont on voit mal comment leurs effets pourraient eux aussi s'inverser.
Ces deux facteurs de l'origine immigrée et de la langue étrangère parlée en famille ne peuvent donc pas être considérés en soi comme des facteurs de risque, comme ce passage le laisse
malheureusement penser. Il ne suffit pas d'écrire que "la combinaison des facteurs de risque est plus préjudiciable aux élèves issus d’un milieu défavorisé qu’à leurs pairs favorisés", parce que
cela revient à postuler que les facteurs "autre culture familiale" et "autre langue parlée en famille" sont des facteurs négatifs que le facteur "milieu favorisé" peut seulement atténuer. Un
postulat, en recherche scientifique, correspond dans le langage courant à ce que l'on appelle un a priori, et celui-ci ressemble fort à un préjugé négatif…
On trouvait déjà la même confusion ou du moins la même ambigüité dans un rapport des inspections générales de septembre 1997 intitulé Les déterminants de la réussite scolaire en zone
d'éducation prioritaire (signé par Catherine Moisan et Jacky Simon), qui énumérait ainsi ces déterminants : "l'aggravation du chômage", "la grande pauvreté", "le degré d'intégration
(et notamment la langue parlée en famille)", "l'instabilité de la population scolaire", "l'enclavement des quartiers" (je souligne).
Les auteurs de ces deux rapports passent donc d'un constat de corrélations observables entre des caractéristiques hétérogènes, à une interprétation en termes de cohérence d'ensemble
scientifiquement biaisée, puisque font défaut les résultats statistiques de recherches contradictoires faites à partir de l'hypothèse présentée plus haut, à savoir celle d'un effet positif
produit par les facteurs "autre culture familiale" et "autre langue parlée en famille" lorsque les autres facteurs sont favorables. Ces autres recherches ont peut-être déjà été faites (merci aux
lecteurs de ce billet, dans ce cas, d’en donner les références sur le forum qui lui est attaché), mais elles n’ont apparemment pas eu droit à autant de publicité dans les médias…
Ces autres recherches sont d'autant plus nécessaires qu'on voit bien dans ces deux rapports comment les résultats qu’ils affichent sont aisément instrumentalisables à des fins de stigmatisation
sociale. Pour des rapports qui, comme l'annonce le titre de celui de septembre 1997, veulent « lutt[er] contre les exclusions », c'est pour le moins paradoxal.
La compréhension écrite en approche interculturelle
J'ai reçu ce jour d'une étudiante la question suivante :
"Quel est l'impact de la compréhension des textes sur l'enseignement apprentissage du FLE dans une perspective interculturelle ?
Ma réponse peut éventuellement intéresser d'autres étudiants, d'où ce billet de blog:
____________________
Je ne suis pas sûr que vous ayez bien formulé la question:
1) Si vous demandez bien ce que peut apporter la compréhension des textes à la perspective interculturelle, je vous renvoie à mon article 2011j, "Modèle complexe de la compétence culturelle (composantes historiques trans-, méta-, inter-, pluri-, co-culturelles) : exemples de validation et d’application
actuelles, chap. 3.1.6.2, "Critique 2", pp. 14-17, en particulier les deux stratégies proposées par Albane CAIN et Geneviève ZARATE.
Et, en bas de cette même page, la reproduction du dossier du manuel suivant: BERTOCCHINI Paola, COSTANZO Edvige, DUMAZ Michel, Spécial
France, éd. Eurelle Edizioni, 1994. Dans cette unité de manuel de civilisation, analysez les types de documents proposés, et le traitement didactique effectué sur ces documents (quels types
de questions et/ou de consignes).
2) Mais je me demande si la question que vous vouliez poser n'est pas, à l'inverse : "Quel est l'impact de la perspective interculturelle sur la compréhension des textes ?" Dans ce cas, les deux
lectures que je vous propose sont les mêmes que dans le premier paragraphe du 1) ci-dessus: on va demander aux élèves de chercher dans les textes les informations opposées aux représentions
interculturelles qu'ils ont sur un aspect de la culture étrangère (A. Cain), ou de repérer les représentations interculturelles des personnages (G. Zarate).
Notez que l'on est dans les deux cas dans une "logique documentaire" qui est la "logique documentation". Sur les cinq logiques documentaires disponibles, je vous renvoie à mon article 2012j, "Traitement didactique des documents authentiques et spécificités des textes littéraires : du modèle historique des tâches scolaires aux cinq
logiques documentaires actuelles"
Les leçons du succès d'un article en gestion d’entreprise pour les jeunes chercheurs en DLC
Le site "The Conversation" publie aujourd'hui 29 avril 2016 l'interview de la co-auteure d'un article à succès en gestion d'entreprise, Emmanuelle Reynaud, "Shareholders, stakeholders et stratégie" (2001), republié en 2015 dans la même Revue Française de Gestion. Elle y est interrogée sur les raisons de ce succès, et ses explications me semblent directement susceptibles d’intéresser les jeunes chercheurs en didactique des langues-cultures (DLC) qui souhaitent légitimement, eux aussi, se faire connaître et reconnaître par des publications marquantes.
Ci-dessous deux extraits, dont j'ai pris la liberté de transposer les idées avec des notes de bas de pages, et, de manière plus osée je le reconnais, avec des remarques entre crochets à l’intérieur même du texte (exemple à ne pas suivre dans un mémoire ou une thèse !...).
1. […] les raisons principales de cette réussite résident probablement dans le fait :
– qu’il explique, comme nous l’avons dit, de façon simple les fondements de modèles économico financiers [modèles didactiques[1]] jusqu’alors essentiellement modélisés ;
– qu’il suggère qu’une autre approche est possible :
(a) En montrant qu’il y a eu d’autres périodes avec d’autres modèles,
(b) en montrant que si au niveau d’un groupe on peut ne regarder que les seuls actionnaires, au niveau d’une filiale il est fondamental de tenir compte des différentes parties prenantes (avec le cas Danone Evian) [en variant et en croisant les perspectives des différents acteurs de la DLC : apprenants, enseignants, formateurs, auteurs et éditeurs de matériels didactiques, responsables éducatifs et pédagogiques, didacticiens, pédagogues,…],
(c) en décrivant théoriquement un modèle alternatif.
2. Il est important de défendre une thèse[2] pour qu’un article ait un fort impact. Bien sûr, l’impact sera d’autant plus important que cette thèse fera écho chez les lecteurs.
Les praticiens [les enseignants] sont davantage intéressés par la pertinence des questions soulevées que par la rigueur méthodologique[3]. Les articles développant des idées nouvelles ou les analyses de la littérature résumant un sujet porteur seront davantage lues et utilisées que les études empiriques sur un sujet ultra-précis, ne concernant, de fait, que peu de monde.
Dans notre cas, la mise en perspective des modèles alternatifs, notamment selon les deux niveaux (groupe/filiale) est apparue éclairante aux yeux du lectorat professionnel. [Les articles de recherche en DLC qui auront le plus d'impact sont ceux qui « éclaireront » des questions et préoccupations des enseignants.]
Ceci étant dit, il est difficile de donner une recette : qu’un article soit lu ou au contraire boudé reste une surprise, même pour les auteurs. Aussi, autant suivre ses envies et ses convictions, car à défaut d’être lu le chercheur prendra plaisir à travailler et là réside sûrement sinon la clé du succès du moins celle de la satisfaction professionnelle.[4]
Christian Puren
[1] Sur les modèles en DLC et leur importance, cf. le Dossier n° 3, "La perspective didactique 1/4: Modèles, théories et paradigmes" de mon cours en ligne "La DLC comme domaine de recherche", et mon essai Théorie générale de la recherche en DLC.
[2] Dans le sens 1, "logique", une "thèse" est une proposition qui va être développée et étayée par des hypothèses que l'on va chercher à valider, et des questions de recherche auxquelles on va tenter de donner des réponses. Exemple: "Le travail de groupe favorise la qualité des productions des apprenants", "La pédagogie de projet permet de mobiliser des apprenants démotivés", "La pédagogie de l'intégration a produit des effets négatifs dans l'enseignement des langues-cultures en Afrique", etc. Dans le sens 2, "formel", il s'agit du travail de recherche présenté en soutenance. Cf. "Glossaire des mots-clés de la recherche en Didactique des langues-cultures", pp. 20-21. Dans ce compte rendu d’interview d’ Emmanuelle Reynaud, "thèse" est bien sûr utilisé dans le sens logique.
[3] Bien évidemment, il ne s’agit pas ici, de ma part, de relativiser l’importance de la rigueur méthodologique dans une recherche universitaire – mémoire ou thèse –, ni même dans un article de recherche publié pour d'autres chercheurs de son domaine. Mais si l’on cherche à obtenir de nombreux lecteurs en DLC - et, en même temps, ne pas être utile uniquement pour sa carrière... -, il faut publier des articles qui ne soient pas des copier-coller de chapitres de thèses, mais des réécritures destinées aux enseignants, en y prenant en compte tout ce qui cela implique.
[4] On retrouve là un peu la même idée (celle de l’intérêt personnel du chercheur) que celle énoncée en toute fin d’un article (lui aussi écrit par une spécialiste en gestion d’entreprise…) encourageant les étudiants à faire des recherches dans cette spécialité : "Si une recherche doctorale ne change pas le monde, elle change, à coup sûr le doctorant qui la conduit. Et ce processus est sans prix." J’ai commenté ce texte, intitulé "Faire ou ne pas faire une thèse en didactique des langues-cultures ?" dans un billet de blog en date du 11 juin 2013.
À propos de la "classe inversée" dans l'enseignement secondaire des langues
Ordre chronologique des contributions
Pour des raisons techniques, les différentes contributions à ce blog n'apparaissent pas sur cette page, de haut en bas, dans leur ordre chronologique de publication. L'ordre chronologique est le suivant :
1. "À propos de la classe inversée dans l'enseignement scolaire des langues" : contribution initiale de Christian PUREN.
2. "Addendum en date du 17 février 2016": contribution de Christian PUREN.
3. "La dernière trouvaille" : contribution de Michel MOREL.
4. "Héloïse" : contribution d'Héloïse DUFOUR en tant que Présidente de l'association "Inversons la classe !" (réaction à la contribution de Michel MOREL).
5. "Christian Puren" : réaction de Christian PUREN à la contribution d'Héloïse DUFOUR.
6. "Second addendum en date du 3 avril 2016" : contribution de Christian PUREN.
7. "Mohamed Souali" : contribution de Mohammed SOUALI, EMFE langue, EEFE Tunisie.
8. "La 'classe inversée' dans l'enseignement des langues, une innovation 'réactionnaire'" : contribution de Christian PUREN.
9. "Constat : la 'flipped classroom' ne convient pas à tout le monde (compte-rendu d'une interview de Vincent FAILLET sur le site nouvvousils.fr en date du 7 avril 2017), contribution de Christian PUREN.
10. "La pédagogie inversée : une pédagogie archaïque" : compte-rendu par Christian PUREN d'un article avec ce titre publié le 22 juin 2017 par deux professeurs de Sciences économiques et sociales dans la revue en ligne Skhole.fr.
11. "Références de deux contributions [Héloïse DUFOUR et Daniel THERRIEN] sur le site de Thot Cursus, avec citations, et commentaires personnels": contribution de Christian PUREN en date du 27 septembre 2017.
12. "Innovation et réaction en didactique des langues-cultures : la carte et le territoire": contribution de Christian PUREN en date du 18 février 2018.
13. "Classes inversées et MOOC, révolution copernicienne dans l’enseignement… vraiment ?": extrait commenté de cet article de Charles HADJI sur le site theconversation.com.
14. "Référence d'une nouvelle contribution": Paul Devin, "Les leurres de la classe inversée" (13 février 2016).
J'ai pu renommer les contributions que j'ai moi-même ajoutées à cette page (qu'elles soient de moi ou d'un autre auteur), mais non celles qui ont été ajoutées directement au moyen de la fonction "Écrire commentaire" : ce sont les contributions n° 4, 5 et 7, que l'on trouvera tout en bas de la présente page.
Je m'en excuse auprès des contributeurs et des lecteurs.
Christian PUREN
P.S. Les lecteurs pourront aussi consulter mon billet de blog intitulé "La 'classe inversée' à l'université comme moyen d'y amorcer le changement pédagogique", publié le 23 décembre 2014, et qui a aussi donné lieu à un échange.
Remarque : Les commentaires sur cette page sont modérés a priori, mais seulement pour éviter les interventions qui n'ont rien à voir avec la thématique en question, ou, pire, les spams.
Pour tout autre sujet que la classe inversée (et il y en a bien d'autres!...), le lien "Me contacter" est disponible en permanence dans la barre de navigation du site, ou mon adresse contact@christianpuren.com. Les messages envoyés de l'une et l'autre manière me parviennent directement, et ne sont pas visibles sur le site.
Merci de votre compréhension.
Christian Puren
2. Addendum en date du 17 février 2016
Je viens de lire, dans un article de Delphine Dauvergne, "Portrait d'université. Rouen attrape la fibre numérique", publié il y deux jours sur le site educpros.fr, le passage suivant:
3. "La dernière trouvaille". Contribution de Michel Morel au débat sur "la classe inversée"
Michel Morel, didacticien des langues-cultures bien connu, en particulier des membres de l'APLV, des lecteurs des Langues modernes et des italianistes de l'enseignement scolaire français, souhaitait réagir à ce billet sur "la classe inversée", mais son commentaire dépassait la taille imposée de 500 caractères. Je lui ai donc proposé de le publier moi-même en tant qu'ajout au texte du billet, comme l'Addendum ci-dessus, tout en lui conservant sa forme originelle.
L'espace des "commentaires" - voire s'il le faut, comme ici, celui du billet lui-même - sont disponibles pour les collègues souhaitant participer à ce débat. Ce débat dépasse, comme Michel Morel et moi le rappelons, le cas de la "classe inversée", parce que celle-ci interroge, comme chaque innovation ou perspective d'innovation (c'est aussi actuellement le cas des neurosciences et de la "neuroéducation"), la conception que nous nous faisons du progrès dans notre discipline. J'ai écrit il y a bientôt 20 ans dans Les Langues modernes (n° 2/1997, pp. 8-14) un texte qui me semble toujours d'actualité, "Que reste-t-il de l'idée de progrès en didactique des langues ?" (republié sur le site de l'APLV et sur mon site)... Il est lui aussi ouvert au débat.
Christian Puren
-----------------------------------
Cher Christian,
Merci de suivre l'actualité et de mettre généreusement à notre disposition tes analyses, tes articles et tes cours.
Ainsi, après les îlots bonifiés, les Mooc, FLOT ou COM… voici donc la dernière trouvaille : "la classe inversée".
Ce qui est stupéfiant et irritant à la fois, c'est, comme tu l'as dit souvent, cette reprise des mêmes réflexes à chaque "nouvelle" technologie, démarche ou approche : on affirme avoir enfin trouvé LA solution à tous les problèmes pédagogiques et l'on essaie de convaincre le plus grand nombre de l'adopter – de quelle façon ! –, voire de l'imposer, en cherchant, parfois en les trouvant, des soutiens institutionnels, en renvoyant naturellement au musée de la ringardise tout ce qui a précédé.
En septembre 2015, pour répondre à une collègue qui demandait sur un forum de professeurs d'italien en quoi consistait cette "classe inversée", avaient été signalés un certain nombre de liens. J’avais suivi ces liens, et d'autres. Je répète et complète ici les quelques remarques que j'avais faites.
Cette « pédagogie », à laquelle on a sûrement raison de s’intéresser, n'est pas vraiment nouvelle. D'abord, l'expression "classe inversée" remonte aux années 20 et la "pédagogie inversée" a commencé à être mise en œuvre aux États-Unis il y a une dizaine d'années, à l'université puis aux autres niveaux d'enseignement. Ensuite, parce que ses fondements théoriques ne sont pas nouveaux, comme tu l'as montré. Mais ce qui serait nouveau, c’est sa mise en œuvre systématique et exclusive dans le secondaire (voire dans le primaire ?), contre laquelle, d’ailleurs, une collègue, agrégée d'espagnol, chargée de missions d’inspections » [sic], met en garde sur le site de l’académie de Poitiers : "il faut donc faire 'mieux' avec les mêmes moyens et éviter tout caractère systématique de l’approche."
Ensuite, j’ai été frappé par la grande confusion et les contradictions des présentations de cette « pédagogie ». Cette collègue chargée de mission, par exemple, dit des choses étonnantes et contradictoires (je souligne) :
Externaliser, c’est élargir l’espace de travail, faire que la maison, le CDI ou la salle de permanence deviennent une annexe de la salle de classe, dédiée à la recherche, à la réflexion, à la construction des savoirs et à l’exposition à la langue. La salle de classe sera alors le lieu des apprentissages, de la production orale, de la confrontation des idées et également de l’exposition à la langue.
À comparer avec ce qu’elle disait plus haut : "Ainsi l’espace et le temps se trouvent modifiés : les apprentissages sortent de la salle de classe". L’ensemble de l’article est d’une grande confusion, au point qu’on a du mal à comprendre sa démarche.
Je n’ai pas trouvé plus clair l’article intitulé "La pédagogie inversée : 'faire passer la théorie hors classe et pratiquer en cours'", où l'on trouve cette définition : "la pédagogie inversée consiste à faire passer les contenus les plus théoriques hors classe pour que les moments de cours servent à vérifier l’acquisition des connaissances théoriques à travers la pratique." Alors le cours ne servirait-il plus qu'à évaluer ? Non, tout de même pas ; l'auteur précise plus loin : "La classe doit permettre aux apprenants de mettre en pratique ce qu’ils apprennent." Que fait le professeur ? On comprend qu'il évalue, mais pour le reste, on ne sait pas, il n'est même pas dit qu'il met en ligne ses cours : "Les technologies nous permettent d’avoir facilement accès à tout type de documents et le professeur n’est plus le seul détenteur des savoirs de la langue-cible." Heureusement, l'auteur déclare ne pas être « un pur expert de la question » et qu'il se « contente d’en parler" [sic]. Il ne craint pas lui non plus d'écrire des choses étonnantes, en alignant les poncifs et les sottises comme on enfile les perles :
Dans notre monde en changement, où nous sommes ici aujourd’hui et demain à l’autre bout de la planète, nous devons être capables de faire de l’apprentissage des langues un véritable outil, je dirais presque une arme, pour relever les nouveaux défis qui se présentent à nous.
Globalement, après avoir exploré un peu tous les sites indiqués, j’ai eu un peu l’impression d’avoir lu tout et son contraire, mais souvent les mêmes postulats : "les apprenants ne peuvent plus continuer à apprendre comme il y a 20 ans" (site cité ci-dessus) , ou bien, sur cet autre site, "ces technologies sont excellentes pour attiser l’intérêt des jeunes", ou ce qui finit par le devenir à force de ne pas être démontré : "C’est en délaissant la transmission passive du savoir en frontal, et en laissant à chacun, en dehors de la classe, le temps qui lui est nécessaire pour préparer la prise de parole que nous développerons leur motivation, leur autonomie et leur sens critique. Nous formerons ainsi des citoyens non pas à la 'tête bien pleine' mais à la 'tête bien faite'" (ici) ; ou bien encore ici : "Pour les enseignants, externaliser la partie magistrale du cours permet d’éviter le côté lassant et répétitif de l’enseignement. Les interactions avec les élèves permettent un cours beaucoup plus vivant et personnalisé."
Mais j'ai aussi été frappé par les appels aux allures de slogans, voire d’injonctions :
- "Rejoignez la révolution de la classe inversée."
- "Inversons la Classe !" [sic]
- La pédagogie inversée : bouleversons nos manières d’enseigner ! »
"Inversons la Classe !" est également le nom d’une association. Sur la page d’accueil de son site, on lit cette chose stupéfiante : "Le modèle de la classe inversée est particulièrement propice à l'utilisation du numérique…" Allez, pendant qu’on y est, inversons aussi moyens et objectifs ! On me dira que ça tombe bien : il faudra bien les utiliser ces tablettes achetées pour les collégiens à coups de centaines de millions (un milliard d’euros sur 3 ans, nous dit Le Monde) !
À ce propos, je conseille de lire la conclusion de l’étude de l’OCDE et à examiner le tableau qui l'accompagne :
L'exposition des élèves aux nouvelles technologies à l'école varie sensiblement entre les pays. Toutefois, l'utilisation des TIC ne semble pas être un facteur déterminant pour expliquer la variation de la performance des élèves en maths, en compréhension de l'écrit et en sciences. La plupart des pays ayant consenti d'importants investissements dans les TIC dans l'éducation n'ont pas enregistré d'amélioration notable des résultats de leurs élèves au cours des 10 dernières années.
J'invite aussi à lire cet article édifiant de VousNousIls.fr : "Pas d’ordi à l’école pour les enfants des cadres de Google ou d’eBay" et celui-ci : "Les enfants de la Silicon Valley pionniers malgré eux". Je n'affirmerais pas que ces parents ont raison, ni qu'ils ont tort, mais cela incite à réfléchir, non ?
Le galimatias employé pour convaincre (convertir ?) le futur adepte (prosélyte ?) est souvent du niveau de "Vu à la télé", "Tout le monde en parle", "Pourquoi pas vous ?", avec l'habituel recours aux témoignages enthousiastes (y compris sur les sites institutionnels, par exemple celui-ci), où l’on fait pourtant, comme ici, des bilans qui ne sont guère convaincants :
Au final, cette expérience d’une année de classe inversée fut extrêmement enrichissante, un professeur ravi, des élèves qui paraissent convaincus et en progrès. L’année prochaine sera une année d’améliorations, de corrections mais surtout pas de retour en arrière.
Ainsi, le ressenti du professeur, ou ses impressions tiennent lieu d'évaluation, comme dans la conclusion de cette interview publiée sur le Café pédagogique : "J'ai l'impression que la classe inversée est plus efficace."
Un article signalé sur le site du CNDP, plutôt clair par ailleurs, dit ceci :
La classe inversée exerce un attrait indéniable sur les enseignants qui souhaitent diversifier leurs approches pédagogiques et tenter de nouvelles expériences avec leurs élèves. Il semble cependant nécessaire de bien comprendre en quoi cette approche offre des bénéfices réels, alors que peu de recherches scientifiques ont démontré son efficacité à l’aide de données probantes…
Comprenne qui pourra ! Et si des recherches scientifiques ont "démontré" l'efficacité de cette approche, même si elles sont peu nombreuses, nous dit-on, pourquoi ne les cite-t-on pas ?
Encore une fois, on affirme sans rien démontrer, sans véritable expérimentation. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire, sur le site de l'APLV ou dans Les Langues modernes ("L'évaluation en langues au baccalauréat", "Entretien avec un IA-IPR", 1/2015, p. 67), que je ne connais pas d'expérimentation valable dans l'Éducation nationale et d'expliquer pourquoi.
En réponse à ceux qui veulent "bouleverser", "révolutionner", je rappelle ton article, Christian, intitulé "La perspective actionnelle, dernière mode officielle avant la prochaine ?", qui peut concerner toutes les modes, y compris celle de la "pédagogie inversée".
Je copie-colle le début de la partie 3 :
3) Une conception erronée de l'évolution des méthodes d'enseignement
Cette conception est fondée sur deux éléments reliés entre eux. Ce sont :
– l'idéologie scientiste du progrès continu, qui fait considérer ce qui est nouveau comme étant de ce fait même et en soi meilleur que ce qui est ancien ;
– et le paradigme d'optimisation-substitution : on recherche le meilleur dans l'absolu, de sorte que si l'on est persuadé d'avoir trouvé quelque chose de mieux (et ça l'est lorsque c'est
nouveau...), on considère que cela doit forcément remplacer ce qui se faisait auparavant.
Et pour terminer tout à fait, sur une note humoristique à la manière du Canard enchaîné, je colle une noix d'honneur à cette affirmation tirée d'un article déjà cité : "Les élèves étant en activité permanente, si le volume sonore est plus élevé du fait du travail en groupes, ils sont beaucoup moins susceptibles de perturber le déroulement de la classe."
Amitiés, Michel
6. Second addendum en date du 3 avril 2016
Sur cette question de la classe inversée, on lira aussi avec profit le compte rendu d’une expérimentation récente, signalé dans l’Expresso du Café pédagogique en date du 22 mars 2016 :
NIZET Isabelle, MEYER Forian, « Inverser la classe : effets sur la formation de futurs enseignants
», Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur (RIPES), 32-1, 2016.
Cet article rend compte d’une expérimentation de classe inversée réalisée avec 56 étudiants en formation initiale d’enseignants du secondaire de disciplines différentes, inscrits dans un cours de
formation à l’évaluation des apprentissages à l’Université de Sherbrooke (Canada). Les contenus théoriques avaient été introduits dans 19 capsules vidéo « présentant des diapositives animées et
commentées par la formatrice et structurées en documents de type Prezi ».
Je n’entre pas ici dans le détail des cadres théoriques, modèles et hypothèses mobilisés pour cette expérimentation, ni dans la présentation du protocole de recherche, ni dans la discussion (elle
aussi très technique) des résultats obtenus par enquête auprès des étudiants et par entretiens avec l’enseignante confrontée à 20 séquences vidéo filmées dans ses cours avec ces étudiants. Je me
limiterai ici à relever les quelques points qui me semblent directement intéressants par rapport aux échanges sur la présente page de blog.
1) Parce que les étudiants ont été confrontés en auto-apprentissage aux contenus de connaissance (fournis par les capsules vidéo), ils ressentent un fort besoin, au début des cours, de faire
valider par l’enseignante leurs connaissances acquises, alors que celle-ci pensait que les séquences de cours allaient pouvoir commencer immédiatement par le réinvestissement de ces
connaissances. Même les forums de discussion organisés entre étudiants n’ont pu jouer leur rôle prévu de (co-)validation : pour les étudiants, seule compte en définitive la validation de
l’enseignant(e).
2) Pour la même raison (l’auto-apprentissage préalable des contenus de connaissance), les différences de niveaux entre les étudiants ont un fort impact sur les acquisitions des uns et des autres
à partir des capsules vidéo.
3) En conséquence, écrivent les auteurs de l’article,
il nous semble nécessaire de mieux planifier [en classe] des activités permettant de vérifier et d’améliorer la compréhension des connaissances de manière différenciée. À cet égard, les différences de rythme entre les étudiants et l’hétérogénéité des niveaux de compréhension sont aussi plus clairement mises en lumière dans un dispositif de classe inversée, et cela crée clairement une demande plus intense de différenciation pédagogique.
La toute fin de la conclusion de ce compte rendu porte elle aussi sur le constat de la même forte exigence de différenciation pédagogique :
Enfin, si ce dispositif de classe inversée nous a certainement permis de résoudre le problème initial d'accompagnement des apprentissages procéduraux, la gestion de classe semble donc devenir
un nouveau problème, généré par l'approche inversée, et nous ne voyons pas d'autre solution que de planifier une gestion qui soit - en alternance - centralisée et décentralisée à partir d'un plan
d'apprentissage commun dont les objectifs pourraient être atteints par les étudiants de manière différenciée dans le temps, voire dans l'espace. Reste à savoir comment ce projet s'inscrirait dans
un cadre institutionnel.
Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement dans l'enseignement secondaire français des langues vivantes étrangères, avec des élèves dont tous les constats soulignent depuis longtemps la
très grande hétérogénéité. La mise en place du dispositif de la classe inversée, qui consiste dans la scénarisation et la médiatisation pédagogiques des contenus à transmettre avant les séquences
de classe, demande certes des compétences réelles, mais ce sont des compétences de type "technico-organisationnel" dont la mise en œuvre ne dépend que des enseignants : c'est d'ailleurs sans
doute l'une des raisons de l'intérêt que ce dispositif suscite chez certains d’entre eux. Les reconfigurations pédagogique et didactique globales que ce dispositif de la classe inversée impose en
aval, par contre, avec donc en particulier la mise en œuvre d'une forte différenciation de l'enseignement et des apprentissages, pose des problèmes autrement plus amples et difficiles parce
qu'elles demandent l'implication non plus seulement des enseignants et des élèves, mais aussi des équipes d'enseignants et des établissements en tant que tels : elle ne peut se faire
correctement, se généraliser parmi les enseignants et se maintenir dans la durée, en effet, sans une certaine flexibilité dans la gestion des groupes, des horaires et des salles, du matériel, et,
last but not least, de l'évaluation...
Tout cela est bien connu depuis longtemps, et je ne peux que renvoyer les lecteurs à un article que j'ai publié en 2003, intitulé "Contre la
'pédagogie' différenciée", où, à la suite d’un Programme de Coopération Européenne (PCE) sur la pédagogie différenciée réalisé sur une durée de trois ans (1998-2000) par l’APLV et dix autres
associations européennes, je critique l'expression française consacrée, parce que le mot "pédagogie" y laisse penser que la différenciation serait de la seule responsabilité du "pédagogue",
c'est-à-dire de l'enseignant.
Ce PCE avait abouti à la production d’un produit d’auto-formation/formation à "l’intervention en pédagogie différenciée dans les classes de langues" toujours disponible en plusieurs langues
sur le site de l’APLV et sur mon site.
Christian Puren
P.S. Les "innovations", décidément, se succèdent actuellement dans l’Éducation nationale française à un rythme soutenu : sous le titre "Classes inversées en langues et SVT au collège de Retiers (35)" un autre Expresso du Café pédagogique a publié il y quelques jours l'interview de trois enseignants (de SVT, d'anglais et d'espagnol) qui se sont lancés non dans la "classe inversée", comme le dit le titre de l'Expresso, mais dans la "classe accompagnée". Ils présentent ainsi le nouveau dispositif:
L'idée directrice est de fournir aux élèves toutes les ressources nécessaires pour réaliser la tâche finale. Ils effectuent ces activités en groupe ou en individuel (au choix) à leur rythme. Les activités terminées sont supervisées par l’enseignant après chaque séance, ce qui permet un suivi d'une séance à l'autre.
(...) Concrètement lorsque les élèves arrivent en classe nous commençons par les rituels de la date et de l'appel puis chacun se met au travail en fonction de ce qu'il veut travailler ce jour-là (finir l'activité du cours précédent ou en commencer une nouvelle qu'il choisit lui-même parmi l'offre). Ils ont à leur disposition des dictionnaires, des MP3 (sur lesquels sont enregistrés les documents de CO), des ordinateurs et des dictaphones (pour enregistrer leurs entraînements à l'expression orale).
Les élèves font les activités demandées : elles leur permettent de compléter des fiches-outils de vocabulaire et de conjugaison et de manipuler les différentes compétences écrites et orales (compréhensions écrite et orale / expressions écrite et orale en interactivité ou en continu). A la maison ils doivent revoir ce qu'ils ont fait en classe et mémoriser ce qui ne l'aurait pas été pendant l'heure de cours.
(...) Le travail à la maison est l'aboutissement, et non le préalable, du travail effectué en classe, notamment en fin de séquence pour réaliser la tâche finale et l'évaluation.
Je souligne: il s'agit effectivement, comme le suggère l'enseignant interviewé, du dispositif exactement inverse de celui de la "classe... inversée".
Ce qui est commun aux deux dispositifs, celui de la "classe inversée" et celui de la "classe accompagnée" - et c'est en définitive la seule chose importante - c'est la nécessaire reconfiguration globale de la pédagogie et de la didactique qu'ils vont normalement provoquer, avec des effets positifs, mais fatalement aussi (voir le passage que je souligne ci-dessous) l'apparition de problèmes nouveaux :
(...) le simple fait de travailler les fiches en autonomie plutôt que d'avancer de façon linéaire en classe entière n'est finalement pas révolutionnaire dans la façon de préparer ses cours, mais cela change vraiment la donne pendant l'heure de cours et le rôle de chacun est chamboulé par rapport aux schémas habituels. J'en suis moi-même encore au stade de l'expérimentation et chaque séance me fait réfléchir aux ajustements à apporter à la façon de mettre en place cette pédagogie, mais elle laisse une liberté intéressante aux élèves et les remet vraiment au cœur de leurs apprentissages. Par contre, il faudra veiller à adapter le cadre de cette liberté et de cette autonomie car selon les classes le travail peut être fait plus ou moins sérieusement et ne pas être productif.
Ce qui peut produire des effets positifs sur l'enseignement-apprentissage, ce sont les reconfigurations pédagogique et didactique, et non la classe inversée en elle-même, ou la classe "accompagnée", inverse de la classe inversée, ou tout autre modification technique et organisationnelle : en d'autres termes, ce que l'on doit viser, ce n'est pas l'"innovation", qui n'est qu'un moyen, mais le "changement", qui est l'objectif: les deux concepts sont trop généralement confondus. Les innovations techniques et organisationnelles ne sont jamais, dans le meilleur des cas, que des "catalyseurs de changement", comme ont pu l'être jadis l'enseignement mutuel ou plus récemment le travail de groupe. Ce ne sont, comme je l'ai écrit dans mon précédent addendum, que des occasions de "relancer les interrogations et expérimentations pédagogiques et didactiques sur les réponses, forcément plurielles et complexes, à apporter aux questions que pose l'enseignement-apprentissage".
J'écrivais aussi que ce n'était déjà pas si mal. Mais d'une part, il ne faudrait pas prendre ces innovations, ou les faire passer, pour ce qu'elles ne sont pas et ne peuvent pas donner, sous peine de préparer de nouvelles désillusions. Pour filer la métaphore, l'effet que produit un catalyseur chimique dépend de la nature de la solution dans laquelle il est plongé: l'innovation, c'est le catalyseur introduit dans l'éprouvette, le changement, c'est par exemple le précipité qui se formera alors entre les produits en présence dans l'éprouvette. Les "produits" en présence dans l'"éprouvette" de l'enseignant, ce qui constituera la nature du changement qu'il pourra opérer, ce sont tous ses acquis de formation et d'expérience pédagogiques et didactiques.
D'autre part, il faudrait enfin se décider, en France, à innover dans la manière de concevoir et réaliser le changement, ce qui impliquerait d'en finir avec les innovations ponctuelles qui se succèdent dans le temps en se remplaçant l'une l'autre, et qui ne donnent lieu, le plus souvent, qu'à des expérimentations individuelles isolées évaluées elles aussi - quand elles le sont - de manière individuelle et subjective (et sur ce point, les enquêtes de satisfaction des élèves n'apportent rien de plus). Il faudrait enfin lancer des expérimentations collectives à grande échelle avec protocole unique et groupes-témoins, évaluées sur le critère principal de l'amélioration effective des acquisitions langagières de tous les élèves et particulièrement des plus faibles, et comparant les avantages et inconvénients respectifs des effets des différentes "innovations" disponibles en faisant varier les paramètres: âges et niveaux des élèves, nombre d'années d'apprentissage, niveaux de formation des enseignants, types de filières, caractéristiques de l'établissement, etc. Il me semble que ce dont la plupart des enseignants ont besoin, en effet, ce n'est pas de la dernière innovation dont on ne sait encore exactement ni ce qu'elle va donner et à quelles conditions, ni ce qu'elle va provoquer par ailleurs, mais d'une vision la plus globale possible des différents "catalyseurs de changement" disponibles, avec pour chacun d'eux les implications en termes de travail de la part de l'enseignant, les avantages et inconvénients, ainsi que la relation entre les conditions et degrés de réussite.
8. La "classe inversée" dans l’enseignement des langues, une innovation « réactionnaire »
Par Christian Puren, 1er mai 2016
Version du 7 mai 2016
L'opération d'inversion que réalise la « classe inversée » n'est pas une idée nouvelle dans l'histoire de la didactique des langues. La première a eu lieu dans les années 1900, dans le cadre de la rupture entre la méthodologie traditionnelle « grammaire-traduction » et la méthodologie directe, et elle s’est opérée dans le sens inverse de celui que la « classe inversée » propose actuellement.
L'un des grands méthodologues directs, le germaniste Adrien GODART, la présente ainsi très clairement dans une conférence de
1902[1] :
La lecture directe supprime en effet la préparation à domicile. Comment [l'élève] pourrait-il préparer, puisque c’est oralement, par transmission orale, qu’il doit acquérir le sens des mots nouveaux et découvrir la signification des phrases ? Maintenir la préparation selon l’ancienne formule serait le condamner à l’usage du dictionnaire français comme moyen d’acquisition. La préparation, telle que l’entendait la méthode grammaticale, disparaît donc. Ce n’est plus l’élève qui prépare, c’est le professeur. [...]
Par bonheur, ce travail est remplacé par un autre exercice, infiniment plus utile que l’opération mécanique qui consistait à transporter des fragments de dictionnaire dans un cahier de préparation, sans se demander, sauf pour les élèves les plus actifs, si le sens choisi s’accordait avec le contexte et sans se préoccuper de la signification de la phrase. À l’ancienne préparation nous substituons l’assimilation du texte. L’élève ne prépare plus, mais il est tenu de relire, à l’étude ou à la maison, le texte expliqué et de le fixer dans sa mémoire. Nous aboutissons ainsi à un déplacement de la préparation qui, au lieu de précéder, comme autrefois, la lecture en classe, la refait et la fixe. (p. 7)
La « classe inversée » actuelle revient donc au dispositif de la méthodologie traditionnelle, dans laquelle l'élève préparait seul les thèmes et versions demandés par l'enseignant. Ces traductions des élèves étaient ensuite corrigées collectivement en classe – à partir de la fameuse consigne de l’enseignant : « Lisez-traduisez » –, avant que l'enseignant ne présente et illustre les nouveaux points de grammaire que les élèves seraient censés appliquer[2] dans leur prochain devoir. Dans la classe traditionnelle comme dans la « classe inversée », donc, les élèves préparent seuls la classe suivante à partir d'une préparation préalable de l'enseignant, et ils arrivent en principe en classe avec les problèmes qu’ils ont rencontrés et les solutions qu’ils ont trouvées, ainsi qu’avec toutes les questions qu’ils se posent encore.
Les contextes pédagogique, didactique et technologique ne sont plus du tout les mêmes, bien entendu, et je ne veux absolument pas suggérer ici que la « classe inversée » opérerait dans l'enseignement-apprentissage des langues un retour à la méthodologie traditionnelle ! Je veux seulement revenir sur ce qui me paraît en cette affaire l'idée essentielle, que j'ai déjà développée plus haut sur cette page de blog et son forum, à savoir que l’intérêt éventuel du dispositif de la « classe inversée » ne réside pas du tout dans le dispositif lui-même (à savoir l'inversion du lieu et du moment du premier travail de l’élève, qui ne se fait plus en classe au moment du cours, mais avant le cours et hors de la classe) : ce dispositif n’est même pas nouveau. Il réside dans l'occasion qu'il offre de restructurer et repenser intelligemment l'ensemble des pratiques d'enseignement-apprentissage. Et cela, ce n'est pas l'inversion de la classe qui permet de le faire, mais une bonne formation pédagogique et didactique actualisée… et préalable.
Il ne faudrait pas en effet opérer avec la « classe inversée » une autre inversion, qui me paraîtrait très dommageable, et qui consisterait pour un enseignant à commencer par la modification du dispositif avant même d'avoir les moyens et d'avoir réfléchi aux manières de la gérer efficacement et dans la durée. C'est pourtant ce que peut suggérer l'expression injonctive, que je considère comme très malheureuse, « Inversons la classe ! ». Faire l’inversion d'abord, et voir ensuite que faire avec ce qu’elle produit, cela serait comme opérer en agriculture une autre inversion technique assurément tout aussi radicale et originale, mais qui de toute évidence ne peut pas donner de bons résultats sur le terrain – en l'occurrence le champ de labour – : celle qui consiste mettre la charrue avant les bœufs.
L’enseignant qui prépare chez lui ses enregistrements vidéo de « classe inversée » doit s’efforcer, pour qu’elles
soient efficaces, de devancer les besoins et les difficultés de ses élèves, c’est-à-dire de se représenter mentalement ceux-ci comme s’ils étaient présents devant lui : la transmission du
cours en présentiel est en quelque sorte, comme le disent les informaticiens, « encapsulée » dans les… capsules vidéo. Au cours de cet
enregistrement, l’enseignant est donc dans une situation pédagogique plus « traditionnelle » encore que dans la classe traditionnelle elle-même – dans laquelle les élèves étaient
au moins devant lui lorsqu’il les préparait à la traduction à venir –, puisqu’il n’y a à ce moment-là aucune interaction effective entre lui et ses élèves : il doit imaginer les
interactions qu’il y aurait eu en présentiel, ce qui demande assurément de sa part non seulement une solide formation initiale, mais une longue expérience de l’enseignement et une bonne
connaissance de ses élèves. Ce ne serait certainement pas un progrès dans la réflexion pédagogique et didactique, en effet, mais à l’inverse (autre inversion…) une régression, que de penser que
la transmission peut se faire tout aussi aisément et efficacement sans qu’il y ait dans le même temps interaction entre l’enseignant et ses élèves ; et interaction entre les élèves eux-mêmes,
comme me le suggère mon collègue Michel MOREL, qui me signale très justement, dans un courriel personnel, deux autres problèmes générés par la mise en œuvre de la "classe inversée", qu'il est
indispensable de prendre en compte :
a) "Le professeur, à moins de passer ses nuits à faire ses préparations, ne pourra pas différencier le contenu de ses capsules en fonction du niveau de ses élèves, alors qu’il peut moduler ses interventions en présentiel."
b) "Si l’on prend pour référence la perspective actionnelle, la classe inversée me semble en rupture avec le principe de l’acquisition collective des outils qui vont permettre aux élèves d’agir collectivement."
J'ajouterai à ces deux remarques de Michel MOREL que par rapport à la démarche attendue en perspective actionnelle, la "classe inversée" opère une autre inversion elle aussi objectivement "réactionnaire" : au lieu que ce soient, comme il est logique aussi bien en perspective actionnelle qu'en pédagogie de projet, les apprenants qui recherchent eux-mêmes les informations en fonction des ressources nécessaires à leur action, celles-ci leur sont données d'emblée, ce qui va impliquer de la part de l'enseignant de prédéterminer plus étroitement l'action des apprenants, aux dépens de leur marge d'autonomie. Par ailleurs, des opérations fondamentales de la "gestion de l'information" à laquelle on doit désormais former les apprenants en tant qu'acteurs sociaux, à savoir la recherche, l'évaluation, la sélection, la hiérarchisation et la mise en forme de l'information, vont revenir en "classe inversée", comme c'était auparavant le cas en pédagogie traditionnelle, à la charge de l'enseignant.
On se rend compte, je l’espère, de la prudence que l’on devrait avoir dans la mise en œuvre de la "classe inversée", et tout particulièrement dans l’enseignement des langues :
a) parce qu'elle remet en cause le dispositif historique de la méthodologie directe en place depuis plus d’un siècle, alors même que le paradigme direct – on apprend à parler, lire et écrire la langue cible principalement en parlant, lisant et écrivant « directement » dans cette langue, c’est-à-dire sans partir de/ou revenir à la langue source – y est en vigueur depuis plus d’un siècle, et qu’il y est resté jusqu’à nos jours ;
b) parce qu'elle est incompatible sur plusieurs aspects avec la mise en œuvre de la perspective actionnelle et de la pédagogie
de projet.
Pour revenir en conclusion au titre de ce billet : la « classe inversée » est « réactionnaire » dans le sens étymologique du terme, puisqu’elle part d’une réaction contre le cours magistral ; il ne faudrait pas qu’elle produise dans l’enseignement des langues, dans l’autre sens bien connu du terme, des effets objectivement réactionnaires...
Christian Puren, M’Sila, 1er mai 2016
[1] En raison de l'importance historique de cette conférence, où l'auteur propose déjà toutes les caractéristiques de la "méthodologie active", qui restera officiellement en vigueur en France jusqu'à l'arrivée de la méthodologie audiovisuelle dans les années 60 (et il y a peu de temps encore dans l'enseignement de l'espagnol, jusqu'à l'arrivée de la perspective actionnelle), j'ai reproduit la totalité de cet article sur mon site : GODART Adrien, "La lecture directe, Conférence pédagogique du 27 novembre 1902 à Nancy", Revue de l'Enseignement des Langues Vivantes, n° 11, janvier 1903, pp. 471-486.
[2] « … censés appliquer… » : voir en effet la critique d’Adrien Godart dans la première phrase du second paragraphe de l’extrait cité plus haut, que me confirment mes souvenirs d’ancien potache de latin et de grec : il n’était pas rare de trouver ainsi dans le dictionnaire latin-français de référence à l’époque, le Gaffiot, déjà traduits "en bon français", plus de la moitié des vers d’un poème de Virgile donné en devoir par l’enseignant…
9. Constat : la "flipped classroom" ne convient pas à tout le monde
Dans la newletter du site vousnousils.fr en date du vendredi 7 avril 2017 est publié le compte-rendu d'une expérimentation conçue par un professeur, Vincent FAILLET, qui, avec le
concours de deux collègues de physique-chimie en classe de Première S, a testé l'effet réel de la classe inversée sur les résultats des élèves pendant une première moitié de l'année, en le
comparant aux résultats obtenus par les mêmes élèves, avec les mêmes enseignants, pendant la seconde moitié de l'année.
Le constat est annoncé dès le sous-titre de l'interview de cet enseignant par le site nousvousils.fr, que j'ai retenu pour le titre du présent billet de blog. Et c'est, "d'une façon très flagrante, que le rendement est nettement meilleur pour les élèves en difficulté, et nettement moins bon pour les bons élèves."
Ce constat peut surprendre, mais l'interprétation qu'en fait Vincent FAILLET est convaincante:
Ce qui se passe, c'est que ces "bons élèves" sont "bons" parce qu'ils ont été sélectionnés par le système traditionnel, centré sur les cours magistraux. (...) ils ont une capacité d'écoute, d'interaction avec l'enseignant (si je n'ai pas compris, je lève la main, j'ose demander)... et ce sont des élèves qui, étonnamment, ne travaillent pas chez eux. Ils n’en ont pas besoin, car ils comprennent tout en cours. (...)
A l’inverse, pour les élèves en difficulté, la classe inversée se révèle être un outil performant de remédiation, permettant de redonner confiance à certains élèves du lycée dépassés par un système trop souvent transmissif, et pas assez permissif.
Elle est convaincante dans le cadre de cette expérimentation, du moins telle qu'elle est présentée, et pour la discipline enseignée (physique-chimie). Il serait assurément intéressant de faire le même type d'expérimentation en langues, parce que mon hypothèse personnelle de départ est l'inverse du constat tiré par Vincent FAILLET : un premier contact avec les documents sans l'aide et le guidage en temps réel de l'enseignant défavoriserait les élèves les plus faibles, la "classe inversée", en langues, favorisant ceux qui ont déjà le meilleur niveau et le plus haut niveau d'autonomie et de motivation.
Mais c'est là pour l'instant "seulement" une hypothèse, qui demanderait à être validée... ou invalidée, par des expérimentations rigoureuses : il serait temps que les promoteurs de la classe inversée en langues s'y mettent.
Vincent FAILLET conclut ainsi, au-delà du bilan de son expérimentation :
Il n'y a pas de méthode miracle. Et le risque, en faisant de la classe inversée un dogme, est d'éluder et de passer sous silence les (autres) expérimentations et innovations de nombreux enseignants. (...) Il est possible de faire de la pédagogie active sans inverser le cours. L'utilité de la classe inversée dépend de la matière, de l'enseignant, de la classe, des élèves...
On pouvait prévoir ces conclusions avant même cette expérimentation, mais il est toujours bon de retrouver et de rappeler la logique fondamentalement contextuelle de la perspective didactique : la seule réponse à une question méthodologique (Faut-il faire comme ceci? Faut-il ne pas faire cela", etc.) est : "Ca dépend"...
Je présente cette idée dans mon cours "La didactique des langues comme domaine de recherche", Dossier n° 4 : La perspective didactique 2/4 : objectifs et environnements. Voir en particulier le chap. 2.2., "Didactique des langues-cultures et logique environnemen-taliste"(pp. 9-14), avec des liens vers plusieurs textes où je la développe.
Christian Puren, 7 avril 2017
10. "La pédagogie inversée : une pédagogie archaïque"
La revue en ligne Skhole.fr a publi" une long article de Alain BEITONE et Margaux OSENDA, deux professeurs de SES (Sciences Économiques et Sociales), où ils argumentent l'affirmation posée
clairement dans le titre de l'article : "La pédagogie inversée : une pédagogie archaïque".
Dans toute la première partie "1. Qu’est-ce que la pédagogie inversée ?", les auteurs développent les critiques que l'on peut faire de la pédagogie inversée du point de vue... pédagogique. Ces
critiques valent donc tout aussi bien pour l'application de la pédagogie inversée à l'enseignement-apprentissage des langues. On les lira avec d'autant plus d'intérêt qu'elles sont systématiques,
détaillées... et à mon avis convaincantes.
Dans la seconde partie ("II. Pédagogie inversée : l'exemple des SES"), la critique de la pédagogie inversée se fait du point de vue de la didactique de cette spécialité, et on y retrouve les
grands concepts de la didactique des mathématiques, inspirés de l'épistémologie de Bachelard, tels que la "situation problème", le "conflit socio-cognitif" et l'"obstacle épistémologique". Ces
concepts n'ont pas de pertinence pour la didactique des langues-cultures, et j'ai déjà eu l'occasion de critiquer, en m'appuyant sur d'autres épistémologues, l'épistémologie elle-même de
Bachelard (voir par exemple, au chapitre 5 de mon cours sur la méthodologie de la recherche,
les pages 29-31).
D'un point de vue spécifique à la didactique des langues-cultures, la perspective critique à l'encontre de la pédagogie inversée me semble celle que j'ai développée dans mon billet du 1er mai 2016, que l'on trouvera plus haut sur la présente page : la pédagogie inversée nous fait revenir sur la décision historique prise par les méthodologues directs du début du XXe siècle, qui considéraient que la seule manière d'"obliger" les élèves à prendre contact "directement" avec la langue étrangère (c'est-à-dire sans s'appuyer systématiquement sur le dictionnaire et la grammaire, comme ils le faisaient - comme nous le faisions, encore à mon époque... - en étude ou à la maison) était d'organiser ce premier contact en classe.
Mon billet du 1er mai s'intitulait « La "classe inversée" dans l’enseignement des langues, une innovation "réactionnaire" » : on voit que si la perspective critique est différente d'une didactique à l'autre, le constat est le même...
Christian Puren, 23 juin 2017
11. Références de deux contributions sur le site de Thot Cursus, en date du 27 septembre 2017, avec citations, et commentaires personnels
La livraison du 27 septembre 2017 de la Lettre d'information de Thot Cursus (http://cursus.edu/) propose deux contributions concernant la classe inversée. L'une est le texte d'une interview d'Héloïse Dufour, Présidente d'"¡Inversons la classe!" (sic : le logo accompagnant l'interview est présenté ainsi, avec deux points d'exclamation dont le premier inversé, à l'espagnole): elle est bien sûr positive, même si la tonalité est défensive. L'autre est un billet de Daniel Therrien, dont le titre, "La valeur de la classe inversée", ne laisse pas présager qu'il s'agit d'une critique. Citations choisies, avec mes commentaires personnels.
1. DUFOUR Héloïse, "Le procès de la classe inversée : retour sur une performance pédagogique. Interview d'Heloise Dufour présidente d'Inversons La Classe"
Je renvoie à la lecture de ce court texte. Deux extraits simplement, avec mes commentaires:
1.1 "Je comprends tout à fait qu’entendre qu’on sorte le nouveau mantra pédagogique, ce soit lassant. Je pense que l’on travaille contre cela. Nous faisons en sorte qu’il y ait des débats, des réflexions sur comment, en tant qu’enseignant, on peut faire évoluer sa pratique. La preuve est, que lors de nos évènements, on travaille sur des sujets concrets et fondamentaux. Comment faire travailler les élèves en groupe ? Comment on modifie l’évaluation du travail des élèves ? Comment on accompagne au mieux les élèves et comment on différencie ? Il me semble que c’est le cœur de la pédagogie. Je ne crois pas que ces questionnements-là puissent être lassants."
Non, ces questionnements ne sont sûrement pas lassants. Le problème est que les poser à partir de la seule inversion de la classe ne peut avoir que des effets réducteurs. Ils doivent l'être, en bonne pédagogie comme tout en bonne didactique, à partir des problématiques générales, et non à partir d'un procédé particulier, quel qu'il soit. Rajouter un second point d'exclamation à "Inversons la classe!" renforce un volontarisme focalisé sur un point particulier, ce qui est à mes yeux symptomatique d'une posture que je considère comme fondamentalement erronée eu égard à la complexité du processus d'enseignement-apprentissage et des multiples paramètres qui l'influencent.
1.2 "Le plus important est de rester dans l’échange. [...] Il se trouve que c’est assez compliqué à mettre en place. On essaye d’inviter régulièrement nos détracteurs mais c’est compliqué de les faire venir. Je comprends que cela les positionne dans une situation délicate."
Je trouve cette déclaration très surprenante, et j'espère qu'elle est faite en toute bonne foi. Pour ma part, j'ai toujours accepté toutes les invitations, sauf empêchement matériel. Mais je n'en ai jamais reçu de l'association d' "(¡)Inversons la classe!", alors même que sa Présidente me connaît et connaît mes positions, puisqu'elle est intervenue sur cette page d'échanges consacrée à cette question sur mon site. Et je rassure à l'avance Héloïse Dufour : je ne me sentirai aucunement dans une situation délicate, du moins si elle accepte que je présente mes réserves et mes critiques sur l'idée d'une "entrée en innovation" par l'inversion de la classe dans le domaine que je connais, celui de l'enseignement scolaire français des langues vivantes étrangères au primaire et au secondaire. Dans ce domaine, j'ai la prétention de penser que contrairement à sa prétention à elle, la gêne elle aussi sera inversée : ce sera celle des collègues qui me feront face.
2. THERRIEN Daniel, "La valeur de la classe inversée"
Là aussi, deux extraits, qui me semblent résumer assez bien le billet.
2.1 "Aussi, un ensemble d’habiletés intellectuelles est nécessaire pour atteindre un certain niveau de compétences en écriture, lecture, et en fonction de pouvoir réaliser certaines opérations comme le raisonnement et la mémorisation. Appréhender un problème mathématique, décortiquer un texte et en saisir les idées principales, retenir des contenus théoriques sont des habiletés qui ne peuvent pas être confiés à la simple volonté des apprenants.
Prétendre que les apprenants peuvent exercer ces habiletés intellectuelles de façon efficace hors de la classe sans supervision relève de l’utopie. En poursuivant sur cette lancée, c’est à l’épreuve de la compétence que doit se mesurer l’inversion de la classe."
2.2 "Il faut s’étonner davantage de la popularité du modèle que de l’application réelle du modèle de classe inversée. Quoique séduisante, l’idée de mener la classe en prenant pour acquis que nos élèves ont bien appris ce qu’ils devaient apprendre ne tient pas la route. Les enseignants d’expérience l’ont bien compris, et les données de recherche sur la validité du modèle sont peu nombreuses ou manquantes.
Ces deux passages se terminent par le même appel à des évaluations rigoureuses des effets de l'inversion pédagogique. Il serait temps que les promoteurs de ce procédé le prenne en compte, pour pouvoir ensuite légitimement parler, comme dans le titre (un peu complaisant...) de l'interview d'Héloïse Dufour, de "performance pédagogique".
Christian PUREN, 27 septembre 2017
12. Innovation et réaction en didactique des langues-cultures : la carte et le territoire
À propos de : A. COUGHLIN, « "Classe accompagnée : mes élèves prennent un maximum de décisions" » (interview), site vousnousils.fr, 16 février 2018
Je conseille vivement la lecture de cet interview d'un professeur d'anglais, qui dans ses débuts avait essayé des pédagogies alternatives, mais les avaient abandonnées:
J’ai regardé ce qui se faisait en matière de pédagogie nouvelle. Mais je me suis rendu compte que, de Freinet à Montessori, la plupart sont difficiles à transposer dans une classe lambda de l’Education nationale, soumise à des contraintes horaires et matérielles.
Il passe dans un premier temps à la "classe inversée", mais, comme on dit, il "en est revenu", en constatant de ses problèmes les plus importants que dénoncent tous les didacticiens critiques, et qui est particulièrement aigu à l'heure où les enquêtes PISA montrent, l'une après l'autre, l'aggravation, en France, de la corrélation entre les résultats des élèves et leur origine socio-culturelle :
[...] en 2011, j’ai découvert la flipped classroom. J’ai appliqué sa définition stricte : donner des vidéos du contenu du cours en amont, et libérer du temps pour faire les exercices en classe. Mais dans mon collège, loin d’être favorisé, j’ai constaté que donner du travail à la maison était une illusion : pour un élève qui a la chance d’avoir des parents disponibles, pas de problème, mais pour les autres, c’était problématique. La classe inversée, dans sa définition originelle ne pouvait pas fonctionner.
Je pourrais ajouter (cf. ici-même l'idée que j'ai présentée à la fin de mon billet "La pédagogie inversée : une pédagogie archaïque"), à savoir que ce sont les enfants des classes les plus défavorisées qui ne trouveront pas des parents capables de les faire travailler en langue étrangère, et qui de ce fait auront recours le plus souvent à la méthode indirecte (i.e. à leur langue maternelle).
A. COUGHLIN pose alors le principe sur lequel il va baser toute la reconfiguration de sa pédagogie :
L’autonomie ne s’apprend pas en travaillant à la maison, avec des parents qui, souvent, ne savent pas comment aider leurs enfants. Elle ne s’apprend pas non plus en écoutant l’enseignant, mais en agissant. Il faut arrêter de tout miser sur la transmission du savoir, et permettre à l’élève d’apprendre par lui-même à gérer son temps et ses ressources, et à collaborer avec les autres.
A partir de ce principe, il va opérer en partie un "retour en arrière" :
On revient aussi aux principes d’une classe collaborative Freinet : les élèves décident eux-mêmes des choses à faire, à partir de conseils. Je ne le fais pas d’une manière aussi systématique, mais les élèves peuvent prendre un maximum de décisions. Au début, ils sont un peu décontenancés par toute cette autonomie, mais ils finissent par vite prendre le pli. Une classe accompagnée bien lancée, c’est une classe dont les élèves entrant dans la salle déplacent les tables immédiatement, et qui sont déjà au travail le temps que je me lève. Il m’est déjà arrivé d’interrompre les élèves, qui s’étaient déjà mis au travail, car je voulais revenir à une forme de cours plus classique ! [...] Le cours magistral classique existe encore parfois, mais seulement pour ceux qui en ont besoin, dans un coin de la salle.
On retrouve là démarche éclectisme d'Adrien PINLOCHE, qui avait écrit en 1908 un article intitulé "Réaction et progrès" (sous-entendu : le progrès passe par la réaction ; cf. mon Essai sur l'éclectisme de 1994, note 116 p. 64), et qui l'année suivante critiquait ainsi l'innovation de l'époque, la méthodologie directe :
Il n'y a pas et il ne peut y avoir en pédagogie de système absolu. Ce qu'il y a donc à faire si l'on veut avancer, c'est de chercher de bonne foi, expérimentalement et non théoriquement, ce que peut donner chaque procédé suivant les indications du moment et le terrain, au fur et à mesure de l'évolution psychologique de l'élève, puis de ne pas hésiter à reconnaître le moment où il cesse d'être utile et peut même commencer à devenir nuisible. Et alors, au lieu de se priver obstinément des bienfaits de l'un ou l'autre de ces procédés, n'est-il pas tout indiqué, au contraire, de les combiner en vue du maximum possible de rendement ? Les procédés de la méthod[ologie] directe ne sauraient échapper à cette loi. Ils ont, comme tous les autres, leur valeur relative et leurs indications utiles, et par conséquent aussi leur limite d'efficacité. (Des limites de la méthode directe, Paris, Belin 1909, 16 p.)
La "réaction" de A. COUGHLIN est cependant est très différente tout autant de celle d'A. PINLOCHE que de celle qu'opère la classe inversée en classe de langue, d'une part parce que c'est un retour à tout un "patrimoine progressiste" de la pédagogie générale, d'autre part parce que ce retour se fait de manière consciente et raisonnée, enfin parce qu'il s'agit à la fois de revenir en arrière et d'aller plus loin, exactement comme le dit l'expression "reculer pour mieux sauter" :
Ma classe accompagnée est transitoire : elle s’utilise dans un certain contexte, avec des élèves qui ont peu d’autonomie, et que l’on veut rendre justement
autonomes. Elle est ainsi pertinente au collège, mais à un certain moment, il est possible de s’en passer et d’aller au-delà.
Une fois l’objectif d’autonomie atteint, il est possible de passer à d’autres formes de pédagogie, comme la classe mutuelle de Vincent Faillet ou la classe
renversée de Jean-Charles Cailliez – quand les élèves construisent les cours qu’ils doivent apprendre, et apprennent ainsi en enseignant eux-mêmes.
Les besoins d'orientations sûres, simples et définitives sont constamment très forts dans un métier aussi difficile que celui d'enseignant, et les espoirs insensés que certains mettent actuellement dans les seules neurosciences en sont un nouvel exemple désolant. Contrairement au choix de telle ou telle voie à sens unique dont on sait déjà, d'expérience historique, qu'elle se révèlera finalement, comme toutes les autres, être sans issue, la stratégie complexe et dynamique d'A. COUGHLIN est la seule adéquate : elle ne montre pas une direction à prendre sur une carte - la carte conceptuelle de la didactique des langues-cultures - : elle consiste à occuper tout le territoire.
Christian Puren, 18 février 2018
13. "Classes inversées et MOOC, révolution copernicienne dans l’enseignement… vraiment ?"
Un article de Charles Hadji sur le site theconversation.com, 1er novembre 2017
Sur le site theconversation.com, Charles Hadji, ancien Professeur des Universités en Sciences de l'Éducation à l'Université Grenoble Alpes, reconnaît, comme le font la plupart des pédagogues et didacticiens, la force potentiellement "disruptive" de la mise en place de la pédagogie inversée : Elle introduit en effet un changement majeur dans l'organisation du double travail d'enseignement et d'apprentissage". Mais comme eux, aussi, et comme je l'ai fait moi-même, il pointe le danger qu'elle représente lorsqu'elle est appliquée dans l'enseignement scolaire sous la forme actuelle, celle d'une première prise de contact des élèves avec les contenus hors de la classe :
C’est en classe qu’il faut inverser la classe. La véritable révolution copernicienne s’accomplira quand l’inversion entre les deux temps de travail s’effectuera au sein même de l’école, dans une rythmicité féconde. Il faut réintroduire à l’école le temps d’appropriation personnelle d’un contenu, qui relève de la mission de l’école. Il faut articuler en son sein même les deux temps d’acquisition et de consolidation. [...] L'école [...] doit prendre en charge tout ce qu’il y a d’essentiel dans le travail d’apprentissage des enfants et des adolescents, sous peine de les abandonner aux forces du marché, dont l’effet le plus sûr est le développement et l’aggravation des inégalités.
14. "Référence d'une nouvelle contribution critique"
Je conseille la lecture d'un autre bon article critique sur la classe inversée, dans une perspective plus politique et idéologique que celui référence plus haut (contribution n° 10) :
Paul DEVIN, "Les leurres de la classe inversée. Doutes et regards critiques sur les fantasmes d'une prétendue révolution pédagogique", Le blog de Paul Devin, Site de Médiapart, (publié le 13 février 2016, dernière consultation 1er octobre 2018). Paul DEVIN est syndicaliste FSU, inspecteur de l'Éducation nationale, secrétaire général du SNPI-FSU, syndicat des inspecteurs (IEN et IA-IPR).
Je remercie Michel Morel de m'avoir signalé ce texte.
Christian Puren, 1er octobre 2018
Ci-dessous, de haut en bas, les contributions n° 4, 5 et 7
La formation des enseignants à/dans une perspective actionnelle (suite)
Mon billet intitulé "La formation des enseignants à/dans une perspective actionnelle" du 16 mai 2013 a donné lieu récemment à deux remarques de lecteurs, qui convergeaient précisément sur la question de l'organisation d'une telle formation.
Je copie-colle ci-dessous la réponse que je fais sur cette page à ces deux collègues:
--------------------
A ma connaissance, il n'existe pas de "guide de formation des enseignants à la mise en œuvre de la perspective actionnelle" (elle est sans doute trop récente). Mais on peut par contre
d'ores et déjà en dessiner les grandes lignes.
Une partie de cette formation sera, comme toute formation, de type "transmissif", elle se fera en partie par une information des stagiaires, en partie par une recherche d'information par les
stagiaires, sur la perspective actionnelle. Il y a je pense trois grandes problématiques à prendre en compte:
- la perspective actionnelle en tant que réactivation/adaptation de la grande tradition des "méthodes actives" et autres "pédagogies nouvelles";
- la perspective actionnelle en tant que se situant en opposition et en même temps en complémentarité avec l'approche communicative (cf. par ex. "Mes travaux", document 2014a) ;
- plus globalement, la place de la perspective actionnelle parmi les différentes configurations didactiques actuellement disponibles (cf. par ex. "Mes travaux", document 052).
La partie pratique pourra consister:
- d'abord en activités de "reconnaissance", principalement par l'analyse des manuels actuels, pour analyser en quoi ils relèvent de quelles configurations; il y a dans "mes travaux" plusieurs
analyses comparatives de manuels (sans oublier l'analyse de la grille de Bertoletti ("Mes travaux", document 2011a) et ma propre grille
d'analyse comparée ("Bibliothèque de travail", document 050).
- ensuite en activités d'"application", qui pourra consister (l'ordre me paraît celui d'une progression logique) :
1) à modifier des unités didactiques de manuels de manière à y augmenter le degré de prise en compte de la perspective actionnelle, par exemple en transformation la tâche finale communicative en
mini-projet, et en réorganisant l'ensemble de l'unité en conséquence (il s'agit, en quelque sorte, de faire de la "manipulation génétique" en passant des gènes de l'approche communicative à ceux
de la perspective actionnelle) : je donne un exemple de ce type d'exercice d'application (avec corrigé) au document 2016a ;
2) à concevoir entièrement des séquences complètes en perspective actionnelle;
3) à concevoir des projets de longue durée amenant à prévoir la mise en œuvre des configurations didactiques disponibles en tant que "matrices méthodologiques" différentes, à des moments
différents du projet: cf. "Bibliothèque de travail", document 053).
Bref, une formation à la perspective actionnelle ne peut se concevoir uniquement comme une formation à cette seule perspective, mais à la gestion de la pluralité des matrices méthodologiques
disponibles.
-------------------------------------
J'ajouterai ici que toute formation à la perspective actionnelle, du moins d'une certaine durée, devrait se faire en homologie avec les principes de cette perspective : l'homologie entre les modes de formation et des contenus est un principe de base de toute formation efficace, parce qu'elle est un principe de cohérence. Dans la mise d'une formation a la perspective actionnelle, on devrait donc y retrouver les caractéristiques correspondant à ses différents "gènes". C'est ce que j'avais voulu marquer dans le titre de mon billet du 16 mai 2013, "La formation des enseignants à/dans une perspective actionnelle"
A propos du traitement des données documentaires dans la recherche en DLC
Un étudiant m'a posé tout récemment, via mon site, une question à laquelle j'ai déjà eu à répondre à plusieurs reprises par le passé. D'où l'idée de mettre les contenus de ma réponse dans ce
billet de blog, avec, sur la page de téléchargement du chapitre 5 de mon cours "Méthodologie de la recherche en DLC" consacré aux méthodes de recherche, un renvoi vers ce billet.
La question de cet étudiant était la suivante:
J'ai choisi de suivre votre méthodologie de traitement des données, mais il y a beaucoup de questions qui m'intriguent. Notamment quand on travaille sur un corpus assez varié (discours, manuel scolaire, vidéos, questionnaires ..), je me demande quelle analyse pour quel type de données ?
"Ma" méthodologie de traitement des données, c'est sans doute, pour cet étudiant, celle que j'expose au chapitre 5 de mon cours de méthodologie de la recherche, chapitre intitulé "Mettre en œuvre ses méthodes de recherche", et plus précisément dans les deux sous-chapitres suivants:
- 2.1.2 L’analyse documentaire
- 2.5.2.1 La méthode qualitative
Pour ma part, j'utilise sur tous les documents supports de mes recherches, produits par d'autres pour par moi moi-même (articles de didacticiens, programmes officiels, manuels, notes
d'observations de classe, réponses à des questionnaires d'enquête, entretiens, etc.) la seule et même "méthode qualitative" telle qu'elle est décrite par Huberman et Miles au sous-chapitre 2.5.2
de ce chapitre 5). A quoi cela correspond-il concrètement ? :
Avec bien en tête (ou mieux : sous les yeux) les hypothèses et questions de recherche que l'on a préalablement élaborées dans sa "problématique de recherche", on lit et relit chacun de ces
documents le crayon à la main (ou le clavier sous les doigts...) pour repérer et noter tous les passages qui nous semblent avoir rapport avec nos hypothèses et questions de recherche: on note
seulement l'idée, ou on copie la citation exacte si elle nous paraît très illustrative, mais dans tous les cas on prend bien soin de référencer le document : ce sont toutes ces notes qui
constitueront nos "données" personnelles (cf. ci-dessous), que nous allons ensuite regrouper, réorganiser, lire et relire pour qu'émergent progressivement nos analyses). Il est utile d'ajouter
aussitôt à chaque note un petit commentaire, même en style télégraphique, pour expliquer pourquoi elle nous a paru intéressante: il est fréquent, sinon, de se demander, dès le lendemain, pourquoi
diable on a noté telle idée ou copié telle citation...
On lit et on relit ensuite ces notes, reclassées préalablement avec d'autres venant de la lecture d'autres documents, par thématiques plus ou moins larges, pour voir ce qui en "ressort": c'est là
que nous effectuons l'opération de "condensation" définie Huberman et Miles (voir mon chap. 2.5.2.1: ces auteurs regroupent sous cette appellation la "sélection, centration, simplification,
abstraction et transformation" des données recueillies). Il faut le faire à plusieurs reprises, espacées de quelques semaines: le travail intellectuel demande certes de la concentration, mais en
même temps de la durée et de la répétition. Un chercheur à qui ses étudiants demandaient ce qu'il fallait faire quand on était bloqué dans une recherche avait répondu : "laisser infuser
davantage". On voit la métaphore: c'est celle du sachet de thé ou de tisane qu'on laisse tremper dans l'eau chaude, pour qu'elle y diffuse lentement son parfum. Rien ne sert de le presser
aussitôt dans l'eau: il faut déjà qu'il s'en imbibe, avant, à l'inverse, d'y diffuser son parfum... L'eau chaude, ce sont nos notes; l'imprégnation (ce qui correspond à "s'imbiber", ce sont nos
lectures relectures de ces notes (pour accélérer le processus, on réorganise différemment ces notes, comme on agite le sachet...), la diffusion, ce sont nos analyses de ces notes, qui vont leur
donner un sens qu'elles n'avaient jamais eu ensemble (voir à ce propos le dernier paragraphe de ce billet).
Pour être capable de repérer ce qui nous intéresse, de trouver des données qui nous apparaissent comme intéressantes, il est indispensable d'avoir préalablement défini ses questions de
recherche et ses hypothèses, c'est-à-dire sa problématique de recherche (cf. Chap. 4: "Élaborer sa
problématique de recherche"). Si on n'a pas encore élaboré cette problématique, autrement dit si on ne sait pas ce que l'on veut chercher, forcément, on n'aura rien à trouver dans ces
documents, rien à noter...
Si l'on ne voit rien à noter dans un document, par exemple un article, c'est peut-être parce qu'il n'est pas du tout pertinent par rapport à notre thématique de recherche, mais ça peut être aussi
parce qu'on n'a pas encore clairement élaboré sa propre problématique.
Si on lit un article dont le titre a un étroit rapport avec sa problématique, en particulier où se trouvent plusieurs de ses "concepts clés spécifiques" (cf. le sous-chapitre 2.2. du chapitre 5 de "Méthodologie de la recherche") et qu'on n'y voit rien d'intéressant, c'est soit que
l'auteur est très mauvais (mais il ne vaut mieux pas partir sur cette hypothèse, surtout s'il s'agit d'un auteur connu, ou du moins si l'article a été publié dans une revue à comité de
lecture...), soit, plus vraisemblablement, que sa propre problématique est mal élaborée, ou pas encore assez "mûre"... Sur tous ces articles portant sur sa thématique de recherche, il peut être
efficace de faire une recherche automatique de chacun des mot-clés de toute recherche, ses "concepts génériques", et plus encore sur chacun des
"mots-clés spécifiques", ceux propres à sa thématique de recherche.
Au bout d'un certain moment de va-et-vient entre lectures, notes et relectures des notes (il faut avoir constamment ses hypothèses et questions de recherche sous les yeux, parce qu'on a tendance
à les oublier rapidement), on se rend compte qu'aucune idée nouvelle ne nous apparaît dans les documents, qu'on a déjà rencontré toutes ces idées : on dit alors que sa recherche est "saturée",
c'est-à-dire qu'il n'y a plus grand d'espoir de trouver autre chose (en tout cas à partir de la problématique telle qu'elle a été pour l'instant élaborée). On peut alors reprendre les résultats
de la recherche pour les mettre en forme par écrit, ou les articuler avec d'autres résultats obtenus par ailleurs avant cette mise en forme.
Comme je l'ai écrit dans le sous-chapitre 1.2. du chapitre 4 de "Méthodologie de la recherche", une recherche est un "processus",
c'est-à-dire qu'il y a de la récursivité entre ses différentes activités: le travail sur les données peut nous amener à enrichir voire modifier sa problématique de recherche (la recherche est un
processus, c'est-à-dire qu'il y a ce type de récursivité). Mais de même qu'il faut savoir arrêter ses lectures et analyses (décider que la recherche est suffisamment "saturée"), il faut savoir
aussi "arrêter" sa problématique, dans le sens où on fixe définitivement ses hypothèses et questions de recherche.
Les idées très intéressantes que l'on trouvera à côté de sa problématique, on pourra toujours les noter, pour voir celles qu'il serait possible de "recycler" en toute fin de conclusion générale,
lorsqu'il s'agira d'ouvrir sa recherche vers des prolongements possibles.
Une recherche active, c'est une recherche où on ne contente pas de lire tous ses documents supports. On prend des notes, on relit ces notes de temps en temps, et, grâce à l'informatique, on les
copie (il vaut mieux laisser toujours les originaux dans le même document initial de sa prise de notes, pour être sûr de retrouver les références), on les colle avec d'autres, on réorganise à
plusieurs reprises ces nouveaux ensembles de notes jusqu'à ce qu'une logique de progression argumentative apparaisse. Pour prendre une métaphore culinaire : c'est de cette "cuisine" personnelle
que la recette d'un "plat" original (votre recherche personnelle) pourra émerger, même si tous ses ingrédients sont déjà bien connus séparément, ou dans d'autres recettes...
Christian Puren
A propos des "bonnes pratiques"
On lira avec intérêt le billet qu'Olivier REY, de l'Institut français de l’Éducation (IFE, Lyon) a consacré aux
"bonnes pratiques" en éducation:
Je l'ai trouvé un peu trop compréhensif vis-à-vis de ce concept, sur lequel j'ai eu moi aussi à plusieurs reprises à écrire. On peut privilégier, comme le fait Olivier REY avec ses
connaissances et compétences habituelles, une analyse "théorique" de ce concept, pour lequel on peut alors trouver effectivement quelques arguments favorables. Mais si l'on privilégie, comme je
le fais, une analyse pragmatique, on ne peut que dénoncer ses graves conséquences au niveau de la conception de la formation et de l'évaluation des enseignants.
J'ai laissé un commentaire en ce sens sur le site de l'auteur, avec les références d'un texte officiel, et de l'un de mes articles.
Comme Olivier REY le rappelle justement dans son billet, l'expression originale en anglais est "best practices" ("les meilleures pratiques" !!): cette expression renvoie
donc au paradigme d'optimisation-substitution que je considère comme complètement dépassé en didactique des langues-cultures, et que j'ai très souvent dénoncé dans mes textes. Voir en particulier
le point 2 "L’approche environnementaliste (la contextualisation)" du manifeste où j'expose ma conception de la discipline, "Pour une didactique
comparée des langues-cultures".
Remarques personnelles sur le projet des nouveaux programmes de langues pour les cycles 2, 3 et 4 (sept. 2015)
Le Conseil Supérieur des Programmes vient de publier le Projet de programmes pour les cycles 2-3-4. J’avais été sollicité en tant qu'« expert » pour donner mon avis sur sa rédaction. Cet avis a
été rendu public, comme celui des autres « experts » sollicités, et je l’ai reproduit alors ici-même, sur mon site (« Contribution
personnelle à la réflexion sur le socle commun et le projet de programme pour le cycle 3 (novembre 2014) ».)
Voici le texte que je viens de faire parvenir à Anne Vibert, IGEN Groupe Lettres, qui m’avait contacté en octobre 2014 pour que je lui donne mon avis sur les futurs programmes du cycle 3.
L'Association (française) des Professeurs de Langues Vivantes a par ailleurs publié, en date du 28 septembre 2015, une "Réaction de l’APLV au projet de programmes pour les cycles 2, 3 et 4".
Accès à des textes marquants de l'histoire du FLE
Sur le site du CIEP ont commencé à être publiés, dans une rubrique "Mémoire(s) du BELC", d'anciens articles, dont certains
ont marqué l'histoire de la didactique du FLE. C'est le cas des deux suivants de Francis DEBYSER, réunis dans le même livret :
1) "La mort du manuel et le déclin de l'illusion méthodologique", pp. 1-10.
2) "Simulation et réalité dans l'enseignement des langues", pp. 11-30
BELC, Bureau pour l'Enseignement de la Langue et de la Civilisation françaises à l'étranger, "Nouvelles orientations en didactique du Français langue étrangère", n° 5, 30/04/1974, 30 p.
Ces articles peuvent être imprimés (éventuellement dans un fichier pdf, ce qui équivaut à un téléchargement).
On y trouve aussi un ouvrage très connu:
CARE Jean-Marc, DEBYSER Francis, Simulations globales, CIEP, 1995, 170 p.
Il peut lui aussi être imprimé, mais seulement par blocs de 30 pages maximum, qu'il faudra ensuite réunir...
Plaidoyer en faveur de la réforme du collège
Un texte signé du président et de l'un des co-présidents de l'APLV, publié le 20 avril dernier sur le site de l'APLV, a été annoncé sur le site du Café pédagogique sous le titre "L'APLV contre la réforme du collège". J'explique dans mon texte pourquoi, en tant que Président d'honneur de l'APLV, je considère qu'elle est nécessaire et salutaire, quelles que soient les inquiétudes, réserves et même critiques qu'elle peut légitimement susciter, parce qu'elle s'attaque enfin aux maux d'un système scolaire qui est le plus inégalitaire de tous les pays développés.
Suite à la publication officielle ce 20 mai
des textes de la réforme
Le ministère a publié ce jour même au Journal Officiel le décret et l'arrêté portant organisation du collège :
-
Décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au
collège
-
Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes
de collège
Même si l'Arrêté avait été rendu public le 14 avril dernier, la publication de ces textes le lendemain de
la grande manifestation contre la réforme fait qu'elle sera forcément interprétée et dénoncée par les partis politiques, les syndicats et les associations opposés à cette réforme comme un
"passage en force". C'est là un mauvais service rendu à ceux qui, même s'ils étaient critiques vis-à-vis de certains éléments de la réforme, étaient prêts comme moi à la soutenir au nom des
grands principes qu'elle affichait, en lui reconnaissant le grand mérite de chercher à s'attaquer enfin sérieusement au dysfonctionnement global du système scolaire français. Dans le concert des
protestations médiatiques, notre voix devient encore plus inaudible, et nos arguments moins écoutés.
Quoi qu'il en soit, l'APLV me semble avoir manqué en cette affaire l'occasion d'apporter des propositions constructives à la diversification des langues et à la lutte contre les inégalités
et les échecs. Je ne vois pas en quoi l'avancement pour tous les élèves du début de l'apprentissage de la LV2 de la 4e à la 5e peut contribuer en quoi que ce soit à ces deux objectifs
prioritaires. Les heures que cette modification va coûter auraient été mieux utilisées à mettre systématiquement en place les classes bilangues de type "LV1 autre que l'anglais au primaire +
anglais LV2 à partir de la 6e", ainsi qu'à développer les sections SELO en collège et assurer leur suivi en lycée pour les mêmes élèves. On ne pourra pas vraiment lutter contre les inégalités
scolaires sans mettre en place une discrimination positive qui ne se limite pas aux individus (heures de soutien), mais s'applique aussi à l'organisation même des enseignements.
Restent les éléments de la réforme qui peuvent être mis dès à présent au service de ces deux objectifs prioritaires, en particulier la marge de manœuvre offerte aux équipes pédagogiques dans la
mise en œuvre des "enseignements complémentaires" (accompagnement personnalisé pour chaque élève en 6e, accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires dans les classes
suivantes), du travail en groupes à effectifs réduits et des interventions conjointes de plusieurs enseignants, autant de dispositifs prévus dans l'Arrêté du 14 avril 2015. J'espère que les
enseignants de langue sauront dépasser leurs légitimes frustrations pour s'emparer collectivement, avec les enseignants des autres disciplines, de ces leviers disponibles au service des élèves.
Christian Puren, 20 mai 2015
"Réformer la réforme de la formation des enseignants... une urgence !"
Le Groupe Reconstruire la Formation Des Enseignants (G.R.F.D.E.) regroupe plus de 230 personnes impliquées à titres divers dans la formation des enseignants (universitaires, formateurs en E.S.P.E., formateurs de
terrain du premier et second degré…) fait depuis plusieurs années des propositions d'amélioration de cette formation (j'en fais partie, et j'ai participé régulièrement à ses travaux).
Ce groupe a publié le 11 mai dernier un document interpellant le Gouvernement sur la nécessité et l'urgence d'une réforme radicale du dispositif actuel de formation initiale des enseignants.
Ce document me paraît particulièrement important en ce moment, où une nouvelle réforme du collège (socle commun et programmes) est en cours de consultation. Car quelle que soit la qualité finale
de cette réforme, elle ne sera d'aucun effet si la formation des enseignants ne l'accompagne pas, et pour cela, des "textes d'accompagnement" ne suffiront pas. Si la formation tant initiale que
continuée des enseignants reste dans la situation qui est la sienne actuellement -on peut sans exagérer la qualifier de "sinistrée"-, l'échec de la réforme à venir est malheureusement
assuré.
Texte à télécharger ci-dessous.
Faut-il conserver l’enseignement des langues vivantes en primaire ? : une question à l’ordre du jour en France dans les années 1880
La toute première tentative institutionnelle d’enseignement des langues vivantes à l’école primaire en France date de 1880, une instruction officielle généralisant cet enseignement dans les « classes élémentaires des lycées » de 9e, 8e et 7e (actuelles classes de CE2, CM1 et CM2) à raison de 4 heures par semaine. Dans un article publié en 1888, un enseignant, jusque-là favorable à cet enseignement, explique pour quelles raisons il "fai(t) amende honorable et passe dans le camp opposé avec armes et bagages". En 1890, l'administration scolaire se rangera à l'avis des opposants, de plus en plus nombreux, et supprimera cet enseignement. Extraits commentés de son article.
Faire-part de naissance (site personnel de Maria-Alice Médioni)
C'est avec grand plaisir que j'annonce la mise en ligne du site personnel de Maria-Alice Médioni.
Militante de longue date du GFEN (Groupe Français d’Éducation Nouvelle) et plus particulièrement de son Secteur langues, cette collègue, par ailleurs enseignante de terrain, a participé très activement depuis la fin des années 80 à la réflexion sur la pédagogie des langues dans la ligne des grandes orientations historiques de ce mouvement pédagogique. En tant qu'hispaniste, elle a été pendant longtemps - et elle reste encore - l'un des trop rares spécialistes à publier régulièrement sur l'enseignement-apprentissage scolaire en France d'un langue qui a suscité jusqu'à présent peu de vocations de pédagogues ou didacticiens, à savoir l'espagnol (elle est hispaniste de formation initiale).
Son site présente à mes yeux deux intérêts majeurs:
1) Il propose comme le mien, en accès libre, le texte intégral de tous les articles et autres travaux qu'elle a publiés au cours de sa carrière et dont elle a les droits.
2) Ces textes fournissent des développements particulièrement utiles pour l'étayage théorique et la mise en œuvre pratique de la perspective actionnelle. Maria-Alice Médioni m'avait d'ailleurs aimablement autorisé à republier sur mon site, en Bibliothèque de travail, un article initialement publié dans Les Langues modernes qui illustre de manière convaincante cette convergence entre les orientations du GFEN et les dernières évolutions de la didactique des langues : "L’enseignement-apprentissage des langues : un agir ensemble qui s’affirme" (document 051 en Bibliothèque de travail).
Elle avait cosigné, avec un autre collègue et moi-même, un texte commun publié lui aussi sur mon site (article 2013d): elle s'était chargée de la rédaction initiale du chapitre 5 "La nécessaire complexité des tâches, et ses implications concrètes", qui montre bien l'intérêt des orientations du GFEN pour la perspective actionnelle.
Je ne peux que recommander à mes lecteurs de visiter régulièrement ce site, que j'ajoute à la liste de mes sites préférés, et je lui souhaite une longue vie !
Christian Puren
Technologies numériques et innovation durable
Je signale sur le site du Café pédagogique un
intéressant billet en date du 13 février 2005 de Bruno DEVAUCHELLE, le spécialiste ès technologies numériques de l'association, intitulé "Une place pour l'usage ordinaire du numérique ?". Il offre en effet une parfaite illustration
du regard différent que l'on peut avoir sur la question de l'innovation dans l'enseignement scolaire lorsqu'on se situe dans la perspective de ce que j'appelle la "didactique complexe". Parce
qu'elle a comme visée l'"innovation durable", c'est-à-dire généralisée et pérenne - ce que l'auteur appelle l'"évolution du plus grand nombre" -, cette didactique complexe part de l'observation
compréhensive de ce qui se passe réellement dans le quotidien des classes, de la "pratique ordinaire mais réaliste".
Dans son billet, Bruno CHAUVELLE critique le fait que "l'on survalorise les expérimentations/ innovations par rapport aux pratiques ordinaires"
:
Même les chercheurs du domaine s'y laissent attirer (il y a des budgets à la clef...), prompts qu'ils sont parfois à se jeter sur les dernières nouveautés pour en faire un article (même s'il
est de piètre qualité) qui fera la une de la presse et qui valorisera son auteur. Certains "spécialistes" mêmes ont fait de cette manière de faire une façon de vivre, surfant de modes en modes,
de nouveautés en nouveautés.
Et, un peu plus bas:
Les passionnés [des technologiques numériques] sont l'arbre qui cache la forêt. On les montre, on les met en avant (tant qu'ils ne dérangent pas trop l'institution) et on oublie de parler de l'ensemble des acteurs de l'enseignement qui eux sont beaucoup moins enclins à développer ces pratiques.
Le passage où Bruno CHAUVELLE énumère ses "constats récurrents" concernant l'environnement quotidien des enseignants illustre parfaitement ce que j’appelais, dans un article de 2009 intitulé
"Nouvelle perspective actionnelle et (nouvelles) technologies éducatives : quelles convergences... et quelles divergences ? " (2009e), les "facteurs de divergence" à l’œuvre dans le domaine des technologies numériques appliquées à l'enseignement scolaire en France :
- le ratio équipements/élèves met en évidence qu'accéder aux machines reste toujours un goulet d'étranglement pour les usages ordinaires. Réservation de salle, programmation en amont des
activités, etc., sont des contraintes qui, par rapport à l'ordinaire de la classe, freinent les activités.
- Les infrastructures (réseau, matériel) et la maintenance se révèlent souvent en deçà des attentes ou du confort d'utilisation souhaité par ces utilisateurs "ordinaires".
- Le niveau de compétence des enseignants reste en décalage assez fort avec les technologies (et leurs exigences de maîtrise technique) mises à disposition, ce qui freine nombre
d'usages.
- Le temps à consacrer à la maîtrise des technologies (formation et surtout autoformation) implique un investissement volontaire fort que les plus passionnés font sans problème mais que la
plupart trouvent trop contraignant en regard des fonctionnements du système scolaire et de leur activité quotidienne.
- La pression des programmes et des examens ainsi que des modalités d'évaluation des apprentissages n'a toujours pas pris en compte les dimensions nouvelles introduites par les moyens
numériques qui, souvent, demandent du temps... que ce soit dans la classe (mise en route de l'activité) ou en dehors (préparation, organisation).
L'auteur rappelle à juste titre que ce que la masse des enseignants s'efforcent en permanence de faire, parce qu'ils savent que c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait enseignement... et apprentissage, c'est simplement (si l'on peut dire...) de "mettre les élèves en activité" ; et que pour cela ce n'est pas d'innovations technologiques lourdes et sophistiquées dont ils ont besoin - les logiciels de traitement de texte, de présentation, d'écriture de livres ou de contenus numériques multimédias suffisent à son avis -, mais d'un environnement où leur administration a réduit au maximum les facteurs de divergence. Les enseignants, qui sont suffisamment motivés pour mettre d'eux-mêmes en œuvre les convergences, seront alors parfaitement capables de le faire quotidiennement dans leurs classes, sans promotions institutionnelles de "bonnes pratiques" labellisées et autres injonctions officielles à l'innovation technologique.
Publication des "contributions des experts sollicités par les groupes chargés de l'élaboration des projets de programmes" (oct.-nov. 2014)
Le site du Ministère de l’Éducation nationale française vient de publier les "contributions des experts sollicités par les groupes chargés de l'élaboration des projets de programmes. Que doit-on
enseigner en langues vivantes?" (fichier
html en ligne).
Ces programmes, comme ceux des deux autres cycles, doivent être cohérents avec le "socle commun de connaissances, de compétences et de cultures", dont le projet a été publié le 8 juin 2014
(fichier pdf en ligne).
Ces programmes doivent aussi respecter la "Charte relative à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des programmes d'enseignement ainsi qu'aux modalités d'évaluation des élèves dans
l'enseignement scolaire" publiée le 3 avril 20124 (fichier html en ligne).
Trois enseignants-formateurs avaient été sollicités pour les langues vivantes, dont moi-même. Les trois textes correspondants sont les suivants (avec liens de téléchargement à la date de ce jour)
:
HERMÈS Delphine (coord.), Contribution collective de l'ESPE d’Amiens (Université de Picardie) : Expertise sur l’enseignement et l’apprentissage des langues vivantes Cycles 3 et 4,
novembre 2014, 32 p. Téléchargement.
KERVRAN Martine, Contribution aux travaux des groupes d’élaboration des projets de programmes C 2, C3 et C4 : domaine des langues, octobre 2014, 11 p. Téléchargement.
PUREN Christian, Contribution à la réflexion sur le socle commun et le projet de programme pour le cycle 3, octobre 2014, 6 p. Téléchargement.
Ces contributions devant être rendues publiques, j'avais publié la mienne dès le 28 octobre 2014 sur mon site: "Contribution
personnelle à la réflexion sur le socle commun et le projet de programme pour le cycle 3".
La "classe inversée" à l'université comme moyen d'y amorcer le changement pédagogique
A propos d'un article de Sophie BLITMAN sur le site EDUCPROS.fr, "La classe inversée, un véritable bouleversement pédagogique ?"
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/la-classe-inversee-une-veritable-revolution-pedagogique.html
(publié le 12/12/2014, dernière consultation le 21/12/2014)
Le site EducPros.fr a publié récemment un article intéressant de Sophie BLITMAN sur la mise en œuvre à l'université de la "classe inversée", dite aussi "pédagogie inversée". Cette pédagogie
consiste à mettre à la disposition des étudiants, avant le cours en présentiel, les contenus d'information de ce cours - sous forme par exemple de documents, de dossiers, ou encore
d'enregistrements audio ou vidéo du cours magistral du professeur - accompagnés de consignes d'activités, de manière à ce que les étudiants travaillent à l'avance ces contenus. Le cours en
présentiel peut ainsi porter immédiatement sur la mise en commun des activités préalables ainsi que sur les questions et demandes des étudiants, et déboucher sur des discussions, des activités
d'élargissement ou d'approfondissement, etc. Le professeur est de ce fait beaucoup plus disponible, dans ce type de classe, pour des fonctions d'appui au travail autonome des étudiants : conseil,
aide et guidage, tant du point de vue des contenus que des modes et méthodes d'apprentissage.
Cet article de Sophie BLITMAN (avec les citations auxquelles elle fait appel) est intéressant non pas tant pour la présentation de ce type de pédagogie, désormais bien connu, mais pour plusieurs
autres raisons :
1. Il relève une explication très crédible de l'engouement que cette pédagogie suscite actuellement, à savoir, selon Marcel Lebrun (dans une interview vidéo dont le lien est indiqué), qu'elle se
situe "au point de rencontre de plusieurs éléments qu'elle fédère : l'approche compétences, les méthodes actives et le numérique". En d'autres termes, cet attrait s'explique par ce que j'ai
appelé, dans un texte de 2009, un phénomène de "convergence" (cf. : "Nouvelle perspective actionnelle et (nouvelles) technologies éducatives: quelles convergences... et quelles divergences ?,
www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2009e/).
2. Il pointe le fait que, contrairement à ses détracteurs, cette pédagogie n'enlève pas au professeur la fonction de transmission de connaissances ; mais, comme le dit Jean-Charles Cailliez, il
ne s'agit plus désormais pour lui de transmettre du "savoir brut". Cette expression mériterait qu'on en approfondisse la signification : outre un "savoir-faire pratique" correspondant (une
capacité à mobiliser et combiner ces savoirs en tant que ressources pour répondre à des questions ou résoudre des problèmes : ce que l'on appelle classiquement une "compétence"), on y trouverait
certainement le "savoir-faire théorique" que permet un niveau de maîtrise personnelle de ces connaissances par les étudiants, c'est-à-dire une capacité à manier (sélectionner, relier,
hiérarchiser, synthétiser ou au contraire développer, illustrer, approfondir, etc.) et présenter ces savoirs eux-mêmes et pour eux-mêmes de différentes manières. C'est ce "savoir-faire
théorique", cette "maîtrise" qui est travaillée - trop implicitement et trop globalement, sans doute - dans les "exposés" des étudiants qui suivent traditionnellement la première partie
"magistrale" des cours universitaires, purement transmissive et à la seule charge de l'enseignant.
3. Il pointe aussi le fait qu'à partir du moment où la transmission des "produits" (les connaissances) est assurée en amont du cours, celui-ci peut se concentrer sur les processus
d'apprentissage. J.-C Cailliez déclare ainsi : "Il peut m'arriver de noter un étudiant non pas sur sa connaissance d'un mécanisme mais sur sa capacité à aller chercher une information, ou bien à
expliquer pourquoi tel schéma est meilleur que tel autre". Il faudra assurément, pour que ce type de pédagogie se généralise, réfléchir sur des modes de prise en compte des processus
d'apprentissage qui ne soient pas seulement ponctuels, mais systématiques, ce qui impliquera qu'ils soient explicités et les critères d'évaluation négociés avec les étudiants.
4. On y retrouve les grandes orientations croisées de toute pédagogie moderne, qui est centrée sur le développement des processus d'autonomisation, de responsabilisation et de personnalisation
des apprentissages : ce sont déjà les principes défendus depuis longtemps par les pédagogues. Il manque par contre dans ce texte l'idée d'une articulation entre la dimension individuelle et la
dimension collective des apprentissages, ainsi que celle d'une nécessaire réflexion sur leurs modes d'articulation : l'auteure de l'article met en avant le "travail personnel" des étudiants
et leur "suivi individualisé", alors que la dimension collective n'apparaît qu'implicitement et au détour de citations (celles dont je fais état dans le point 5 ci-dessous).
5. Il montre que la classe inversée peut servir d'amorce pour des modifications plus radicales de la pédagogie universitaire, pouvant aboutir à ce que l'une des personnes citées appelle joliment
la "classe renversée", depuis la recherche systématique de "liens entre la classe et la société" (ce qui implique que le groupe d'étudiants se mette collectivement en projet) jusqu'à la
construction collective de toute l'architecture du cours et de son contenu par les étudiants eux-mêmes (Marcel Lebrun). Je pense que ces développements de la classe inversée amèneront forcément
les enseignants d'université à revisiter et recombiner à leur manière les différents grands types de pédagogie qui sont apparus dans l'enseignement scolaire au cours du siècle dernier comme
autant de "greffes" nécessaires pour faire vivre la dite "pédagogie active" : la pédagogie de groupe, la pédagogie de projet, la pédagogie du contrat et la pédagogie différenciée.
6. Il cite enfin des enseignants qui se situent clairement dans le paradigme d'"adéquation-addition" que je défends pour ma part depuis longtemps en didactique des langues cultures (cf. par
exemple, dans la rubrique "Mes travaux", mes articles 2006g, 2008g, 2001g, 2013j): "Il n'est pas question de renoncer aux cours académiques classiques." "(...) l'efficacité d'une pédagogie
réside, notamment, dans sa variété." "(...) l'innovation pédagogique, ce n'est pas tout réinventer, mais voir comment on articule de nouvelles façons de travailler avec de plus anciennes." "Les
classes inversées permettent d'aller doucement dans l'évolution. On est pas obligé de faire ça les 14 semaines de cours." "[La pédagogie inversée] n'est pas une méthode révolutionnaire, c'est une
méthode évolutionnaire." (Marcel Lebrun).
L'ensemble de ces considérations constitue à mon avis un argumentaire assez convaincant en faveur de mise en œuvre de la "classe inversée" dans les universités : cette mise en œuvre peut
parfaitement se limiter au départ chez un enseignant à une modification technique très simple et très limitée du dispositif d'enseignement universitaire le plus représentatif de la "tradition" :
elle pourra ne porter, comme le suggère Marcel Lebrun, que sur une seule heure de son cours magistral sur les 14 heures du semestre : pour cette seule heure-là, les contenus auront été transmis
préalablement aux étudiants et travaillés individuellement par eux à partir de quelques consignes d'activité. En fonction de l'évaluation, avec les étudiants, de l'ensemble de la séquence
(travail préalable + heure de cours), le professeur pourra décider de répéter l'opération, en la modifiant éventuellement, puis lui "greffer" à volonté, de manière souple et progressive, d'autres
éléments pédagogiques plus ou moins importants (préparations et exposés par groupes, débats organisés sous différentes formes, insertion de projets avec des objectifs de publication, etc.). Pour
reprendre une autre métaphore que j'utilise depuis longtemps, et que j'avais empruntée au jeu de Lego avec ses pièces à emboîter les unes dans les autres (1) : sur la nouvelle "pièce" pédagogique
que constitue la classe inversée (et cette première pièce peut être de taille très réduite, comme on vient de le voir), le professeur pourra en emboîter d'autres, pour aboutir à un assemblage
plus ou moins important dans ses dimensions et plus ou moins complexe dans sa structure.
Cette démarche d'innovation pourra paraître manquer d'ambition, mais elle est sans doute plus réaliste et plus prudente. Elle n'exclut pas qu'au sein d'un département ou d'une université, dans le
cadre d'une stratégie globale d'innovation (qui devra être d'autant plus soutenue qu'elle sera étendue dans la durée et progressive), d'autres professeurs s'engagent dans des modifications plus
rapides et radicales de leurs pratiques. La métaphore du Lego peut être reprise aussi au niveau de l'ensemble d'une filière universitaire, au sein de laquelle des pédagogies différentes
viendraient "'s'imbriquer" les unes dans les autres.
------------------------------------
(1) Cf. le chapitre 3.2.2 « La programmation par "objets méthodologiques" » de mon article intitulé « Psychopédagogie et didactique des langues. À propos d'observation formative des pratiques de
classe" (1994d) et "Configurations didactiques, constructions méthodologiques et objets didactiques en didactique des langues-cultures :
perspective historique et situation actuelle" (2012f), en particulier les pages 4-5.
A propos de : MERLE Pierre, "Faut-il en finir avec les notes ?"
Pierre MERLE, "Faut-il en finir avec les notes ?"
http://www.laviedesidees.fr/Faut-il-en-finir-avec-les-notes.html
(Note en date du 12 février 2017: le lien ci-dessus n'aboutit pas au texte en question, qui semble avoir été retiré du site)
Je recommande la lecture de ce long article de Pierre MERLE, sociologue de l'éducation, qui fait une bonne synthèse:
a) des résultats des recherches sur la notation menées depuis plusieurs dizaines d'années - qui confirment constamment ses différents biais et effets négatifs -;
b) et des solutions préconisées et appliquées dans les systèmes scolaires qui sont parvenus à faire réussir plus d’élèves en réduisant la corrélation - particulièrement forte en France - entre
origine sociale et résultats scolaires :
- Préserver l'anonymat social et scolaire de l'élève.
- Préférer une évaluation formative à une évaluation sommative.
- Intégrer l’évaluation dans le processus d’apprentissage.
- Supprimer les « comparaisons sociales forcées ».
- Fonder l'évaluation sur des compétences et connaissances standardisées.
- Construire une synergie entre les évaluations des élèves et celles des établissements.
Pour ma part, en pensant à la perspective actionnelle et à la pédagogie de projet et à leur implication en termes de prise en compte de la dimension collective, j'ai particulièrement noté le
passage suivant:
La réflexion menée sur une évaluation standardisée doit être l’occasion de ne pas réduire l’évaluation aux seuls contrôles écrits individualisés mais d’ouvrir celle-ci à des compétences souvent ignorées : projets de classe, travail en groupe, exposé oral (Archambault et Chouinard,2009). Il est paradoxal que le travail en groupe fasse peu souvent l’objet d’évaluation alors que la coopération et la capacité à travailler à plusieurs constituent une compétence nécessaire à la vie professionnelle. Il faut sortir de l’obsession scolaire du contrôle écrit individualisé alors que les compétences de chacun se construisent fréquemment dans l’interaction et la discussion. Cette variation des pratiques d’évaluation et la prise en compte du travail en commun sont nécessaires pour mieux évaluer la diversité des compétences des élèves, pour favoriser le développement de connaissances métacognitives souvent négligées, pour réduire une certaine inaptitude française à échanger avec autrui et à penser collectivement de façon constructive.
Christian Puren
Contribution personnelle à la réflexion sur le socle commun et le projet de programme pour le cycle 3 (novembre 2014)
Présentation
J'ai été sollicité par la responsable de la coordination des "travaux du groupe chargé d'élaborer le projet de nouveaux programmes pour le cycle 3" (classes de CM1, CM2 et 6e), pour rédiger entre 2 et 4 pages de contribution écrite personnelle. Je viens de la lui envoyer. Comme toutes les contributions sont destinées à être publiées, je la mets dès à présent sur mon site. On pourra aussi consulter ici la version en ligne de ma contribution sur le site officiel de l’Éducation nationale.
Ces programmes, comme ceux des deux autres cycles, doivent être cohérents avec le "socle commun de connaissances, de compétences et de cultures", dont le projet a été publié le 8 juin 2014 (fichier pdf en ligne).
Ces programmes doivent aussi respecter la "Charte relative à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des programmes d'enseignement ainsi qu'aux modalités d'évaluation des élèves dans l'enseignement scolaire" publiée le 3 avril 20124 (fichier html en ligne).
Résumé
A l'occasion de cette contribution, je salue l'évolution positive de la conception du socle et des programmes français vers l'idée de "curriculum" telle qu'elle s'est imposée depuis longtemps dans les pays anglo-saxons ; je reprends, à la justifiant à nouveau, l'exigence de la "liberté pédagogique" des enseignants ; j'introduis la distinction, qui me paraît essentielle, entre les orientations "méthodologiques" jusqu'à présent indûment intégrées aux programmes français, et les légitimes orientations "didactiques", qui peuvent faire la liaison entre le socle et les programmes ; je rappelle mon opposition aux "groupes de compétences" tels qu'ils ont été organisés dans le secondaire (cf. mon article 2010h), ainsi qu'à l'apprentissage des langues vivantes étrangères en CM1et CM2 dans les conditions actuelles (cf. mon billet de Blog-Notes en date du 1er octobre 2010), en proposant d'y organiser à la place une véritable propédeutique ; je rappelle la nécessité de mettre en cohérence les finalités et objectifs avec les modes d'évaluation (et donc d'intégrer les projets dans l'enseignement-apprentissage, et la dimension collective dans l'évaluation, ainsi que l'auto-évaluation); enfin à trois reprises au fil de ma contribution, j'attire l'attention sur l'intérêt qu'il y aurait à regrouper les réflexions sur l'enseignement du français langue source (L1) avec celui des langues vivantes cibles (L2, L3).
Projets professionnels et évaluation de la langue étrangère dans une perspective actionnelle : des questions en suspens, des problèmes à résoudre
Présentation
Le Ministère français de l’Éducation nationale vient de publier une note de service concernant les épreuves du baccalauréat technologique série Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D). Deux épreuves orales, l'une en contrôle continu et l'autre en tant qu’épreuve du baccalauréat, sont organisées également dans la langue vivante étrangère 1 sur le même projet technologique réalisé par les élèves au cours de leur année. La seconde épreuve, même si cela n’est pas précisé, se fait en simulation : son premier objectif annoncé est en effet de « convaincre le client du projet que la production présentée correspond bien aux besoins exprimés » (je souligne).
J'analyse dans ce billet de Blog-Notes les deux fiches d’évaluation correspondantes annexées à ce document officiel, qui sont intéressantes puisque nous sommes dans un cas où la langue est
utilisée à propos d’un projet, c’est-à-dire dans un cadre a priori actionnel. Ma conclusion : "la combinaison entre l’approche communicative et la perspective actionnelle ne va pas
de soi, elle demande que l’on soit au clair sur les caractéristiques et les enjeux de l’une et de l’autre."
Problématique de recherche, questions de recherche et questions rhétoriques
Billet à l'attention des étudiants en cours d'élaboration ou de rédaction de leur thèse ou de leur mémoire.
Il s’agit, à l'occasion du commentaire d'un appel à communications pour une rencontre d'enseignants de langues en Ecoles d'ingénieurs, de quelques considérations à propos des questions dites
"de recherche" à poser dans leur "problématique de recherche".
L'UNESCO, les TIC et la petite fille

Ce billet (d'humeur) commence par ces mots : "Ce billet de blog s'intitule comme une fable, en l'occurrence de celles que les parents racontent à leurs petits enfants pour les aider à s’endormir en mettant à profit leur touchante crédulité."
Il reproduit la page de garde d'un ouvrage collectif publié par l'UNESCO en 2013 (voir ci-dessus) et intitulé Transformer l'éducation: le pouvoir des politiques relatives aux TIC, pour la critiquer tant du point de vue de conception graphique que de la représentation qu'elle donne des TIC.
Il conclut par ces lignes : "On attendrait de l’UNESCO, organisation aussi prestigieuse que pluraliste, qu’elle évite d’alimenter ainsi la technolâtrie béate et la pensée unique, et, accessoirement, qu’elle commence par former ses propres graphistes avant de conseiller à tous les pays du monde de former leurs enseignants."
Pour lire ce billet, utilisez le lien "Télécharger" au haut de cette page.
L'apprentissage précoce des langues vivantes étrangères est-il efficace ?
LAMBELET Amelia, BERTHELE Raphael, Âge et apprentissage des langues à l’école. Revue de littérature, Fribourg, Institut de plurilinguisme de l’Université de Fribourg, 2014, 69 p. Téléchargeable en ligne : www.centre-plurilinguisme.ch/Web_FR_AgeLanguesEcole.pdf.
Mon texte ne constitue pas réellement un compte rendu de lecture de cet ouvrage. J’y ai simplement regroupé et organisé les quelques idées qui m’ont paru les plus immédiatement importantes pour la réflexion en didactique scolaire des langues.
Ma conclusion est la suivante :
Dans les conditions actuelles qui sont généralement les siennes en France, le temps, l’énergie et l’argent actuellement consacrés à l’apprentissage, l’enseignement et la formation pour la
généralisation de l’enseignement des langues à l’école primaire constituent un gaspillage insensé, et les moyens correspondants seraient certainement plus efficaces s’ils étaient consacrés à une
réforme réfléchie et sérieuse de leur enseignement au collège.
Un TP et son corrigé sur la problématique de l'évaluation des projets
Je viens de revoir, augmenter et corriger le TP, avec son corrigé, intitulé "Un exemple de mise en œuvre simultanée des différentes matrices méthodologiques disponibles" (Document 053, publication annoncée ici-même le 1er septembre 2014), où je proposais de croiser cette grille d'analyse, appliquée aux différentes activités d'un exemple de projet pédagogique, avec une autre grille disponible, celle des "différentes orientations de l'agir" (Document 026).
Les trois idées qui s'en dégagent (/ qui seraient à faire dégager à la suite du TP) sont à mon avis les suivantes:
a) Les critères d'évaluation des activités successives d'un projet, sans être totalement arbitraires, laissent une marge importante de libre choix.
b) Il vaut mieux, pour évaluer l'ensemble d'un projet de la manière la plus complète et précise possible, diversifier les critères d'évaluation de ces différentes activités, ce qui permettra de
n’utiliser éventuellement qu’un seul critère pour chacune des activités.
c) La conclusion qui s'impose des deux considérations ci-dessus est que les critères d'évaluation des différentes activités ainsi que les types d'évaluation (hétéro-/co- et auto-évaluation,
individuelle et collective, etc.) doivent être soigneusement discutés et négociés préalablement entre l'enseignant et les apprenants.
Ce TP et son corrigé ainsi revus me paraissent fournir une bonne base de réflexion sur la "problématique de l'évaluation des projets" telle qu'elle est présentée - propositions concrètes à
l'appui - au chapitre 19 (pp. 21-25) du dossier 2014b intitulé « La pédagogie de projet dans la mise en
œuvre de la perspective actionnelle ».
François DUBET et la validation du modèle complexe de la compétence culturelle
Je viens d'ajouter, sur la page de téléchargement de mon article "Modèle complexe de la compétence culturelle (composantes historiques trans-, méta-, inter-, pluri-, co-culturelles) : exemples de validation et d’application actuelles" (2011j), un post-scriptum où je commente une interview publiée aujourd'hui-même dans le journal Libération ("Nous avons renoncé à produire de l'égalité". Propos recueillis par Anastasia Vecrin [à propos de son livre La préférence pour l'inégalité, Paris,: Seuil, 2014, 112 p.], Libération du samedi 20-dimanche 21 septembre 2014, rubrique "Idées", pp. 22-23).
J'y présente trois idées exprimées dans cet interview qui me semblent pouvoir être mobilisées pour la "validation sociologique" de ce modèle complexe de la compétence culturelle, pour laquelle je faisais déjà appel, dans mon article, à deux autres sociologues (Claudine BERT et Jacques DEMORGON). Ce sont les idées suivantes :
- primauté de la composante transculturelle sur la composante interculturelle, la seconde ne pouvant être mise en œuvre que si la première est assurée ;
- nécessité d'une mise en œuvre en parallèle de la composante co-culturelle ;
- en conséquence, insuffisance de la seule communication si elle n'est pas au service de l'action.
Je conclus ainsi ce post-scriptum :
On peut dire que pour F. Dubet - mais je crois que c'est aussi le sens relatif de ces deux concepts en langue française -, la solidarité, c'est la fraternité dans une perspective
actionnelle. C'est là une idée à prendre en compte, me semble-t-il, par tous les enseignants de langue-culture en milieu scolaire, qui sont avant tout, comme leurs collègues de toutes
les autres disciplines, des éducateurs.
À propos du dossier de veille de l'IFE, Institut Français de l'Education, "Évaluer pour (mieux) faire apprendre" (n° 94, sept. 2014)
L'IFE, Institut Français de l'Education, vient de mettre en ligne le dernier "dossier de veille" (n° 94, septembre 2014), intitulé "Évaluer pour (mieux) faire apprendre", et réalisé par Olivier REY et Annie FEYFANT. Il s'agit d'une mise à jour d'un dossier précédemment publié en 2008.
Ce dossier est de qualité, comme tous ceux réalisés par l'équipe de veille scientifique de cet institut, et je ne peux qu'en conseiller la lecture. Il est particulièrement précieux parce qu'il se
centre sur "l’évaluation des élèves dans le contexte particulier de situations d’enseignement de type scolaire" (p. 2). Les auteurs notent justement à ce propos que "l'évaluation au quotidien
dans la classe" fait partie de celles qui sont "étonnamment mal connues et peu étudiées" (p. 2), alors même qu'on peut constater "la place centrale de cette activité dans les pratiques scolaires"
(p. 27), et il en est de même dans les demandes institutionnelles en France (cf. le "Livret de compétences" en collège, ou encore l'adossement au CECRL des objectifs et des évaluations
en langue). De manière très pertinente, les auteurs suggèrent (p. 35) que la volonté tout récemment exprimée par Conseil supérieur des programmes, en France, de passer d'une logique de programmes
à une logique de curricula, impliquera forcément un changement dans la culture française de l'évaluation, puisqu'il s'agira plus d'accompagner constamment chacun des élèves dans son processus
d'apprentissage, que de le situer périodiquement par rapport aux contenus enseignés et aux objectifs terminaux. Ce nouveau dossier de l'IFE étant une revue de la littérature sur la question (avec
une ouverture précieuse sur les comparaisons internationales), il ne compense bien sûr pas cette absence regrettable d'études de terrain sur "l'évaluation au quotidien dans la classe". Il en
était de même de l'étude que j'avais consacrée à "La problématique de l’évaluation en didactique scolaire des langues", publiée dans Les Langues modernes n° 2/2001 ( pp. 12-29), republiée sur le site de l’APLV et disponible aussi sur mon site.
Les auteurs se proposent de "clarifier les termes du débat en revenant sur les définitions, les fonctions et les formes existantes de l’évaluation" (p. 2): ils n'y parviennent pas réellement, tout simplement parce que toute tentative de clarification ne peut se faire qu'en prenant parti entre les innombrables interprétations et positionnements existants sur la question, ou en en rajoutant de nouveaux : elle alimente le débat plus qu'elle ne le clarifie vraiment. Sans assigner bien sûr quelque vertu que ce soit à la confusion conceptuelle, je rappellerai que l'évaluation est une "problématique", une "question complexe", et que par conséquent toute clarification génère de la simplification. Je trouve très juste cette phrase de Jean-Louis Lemoigne (qui a beaucoup travaillé avec Edgar Morin) dans son article intitulé "Qu'est-ce qu'un modèle ?" : "Il en va des définitions comme des brouets : plus ils sont clairs, moins ils sont nutritifs". Du fait que toute clarification implique des prises de position, qu'on le veuille ou pas, qu'on le dise ou pas, les dossiers de veille de l'IFE sont donc amenés à gérer au mieux la contradiction structurelle entre leur souci de rendre compte objectivement des débats en cours, et leurs légitimes convictions personnelles. La meilleure manière de le faire, à mon avis, est d'expliciter clairement celles-ci pour le lecteur, en particulier en signalant systématiquement si les citations d'auteurs sont faites uniquement pour indiquer la position prise par les auteurs cités, ou si les idées qu'elles expriment sont partagées par les auteurs du dossier. Si j'insiste ainsi sur ce point, c'est parce qu'il me paraît particulièrement important pour mes lecteurs apprentis chercheurs dans la rédaction de leur mémoire de Master ou de leur thèse.
Parmi les nombreuses idées intéressantes dans ce dossier sur l'évaluation, exprimées soit directement par les auteurs, soit par l'intermédiaire de citations, j'ai noté pour ma part les suivantes, qui m'ont paru très justes :
- "Évaluer est toujours un jugement en fonction d’une valeur, et l’enjeu n’est donc pas tant de rendre l’évaluation plus exacte et plus juste, mais plutôt de communiquer à l’évalué ce qu’on attend de lui et de l’inciter ainsi à partager les finalités de la formation. Si cette mesure « objective » est pourtant bien ce qui est souvent encore cherché au travers des pratiques de notation qui constituent la caractéristique majeure des dispositifs d’évaluation existants, la plupart des experts défendent l’idée que l’évaluation est un « message » plus qu’une « mesure »". (...) (p. 3)
- "Les technocrates ont « donné de la valeur à ce qu’ils mesuraient au lieu de mesurer ce à quoi ils donnaient de la valeur » (Hargreaves & Shirley, 2009, cités par Mulle & Normand, 2013)." (p. 4)
- "Il est en général assez difficile, en effet, d’isoler dans les processus éducatifs des pratiques d’enseignement de nature à en déduire en toute rigueur une causalité entre telle façon de faire et tel progrès de l’apprentissage chez les élèves. La complexité de ce qui passe dans les interactions humaines au sein d’une classe est très difficile à ramener à quelques variables qu’on peut tester à souhait." (Rey, 2014). (p. 24)
Plusieurs passages de ce dossier de l'IFE, par contre, me semble poser problème, la plupart étant, comme on le verra, des citations d'autres auteurs faites par les deux auteurs de ce dossier. Ci-dessous, les passages du dossier sont numérotés entre guillemets et mis en italique. (Ce ne sont bien entendu que des remarques personnelles destinées à alimenter le débat, auquel je rappelle d'ailleurs à mes lecteurs qu'ils sont constamment conviés, pour le présent billet comme pour tous les "billets" de ce "Blog-Notes", en utilisant à cet effet la fonction "commentaire".) :
(1) S’interroger sur l’évaluation pour les apprentissages, c’est se situer à rebours d’une tradition où l’évaluation est conçue dans un modèle cybernétique comme un contrôle à posteriori, quasiment technique, d’un apprentissage qui serait indépendant des modalités d’évaluation. Un grand nombre de modèles d’évaluation se situent dans cette perspective cybernétique de façon explicite ou implicite (Vial, 2012). (p. 19)
Je suis très surpris de cette référence à la cybernétique faite dans ce contexte par Vial. Même dans la "première cybernétique"ou "cybernétique de premier ordre", qui est la plus mécanique et la plus éloignée de la future systémique, l'un des principes de base est la rétroaction, qui permet l'autorégulation du système. "Contrôle" a dans la cybernétique le sens de régulation permanente du sytème par feedback : on est donc à l'opposé de l'idée d'un "contrôle a posteriori (....) d'un apprentissage qui serait indépendant des modalités d'évaluation". Il y a confusion chez Vial, me semble-t-il, entre le "contrôle" dans le sens qu'il peut avoir dans beaucoup d'expressions utilisées lorsque l'on parle d'évaluation en pédagogie (comme "contrôle sur table", "contrôle-surprise"), et le "contrôle" en cybernétique, qui fait partie d'un mécanisme d'interaction. Un modèle d'évaluation "dans une perspective cybernétique" est donc exactement ce qui est défini comme "évaluation formative" en bas de la p. 19 du dossier: "Elle cherche [ à apporter aux élèves] un retour d'informations constant sur leur apprentissage […]."
(2)
- (a) "Si les représentations des enseignants en activité sur l’évaluation font l’objet d’une littérature importante, peu d’études ont été réalisées auprès des enseignants en
formation. Une enquête a été menée en 2010-2011 auprès de 134 enseignants du primaire et 339 aspirants enseignants du canton de Genève. (pp. 24-25, je souligne)
- (b) "Là où la première recherche vise à établir des différences de conceptions
[…]. (p. 26, je souligne)
Pour cette recherche, les auteurs du dossier utilisent dans la première phrase ci-dessus (a) le concept de "représentations"; dans la seconde (b), alors qu'il s'agit de la même recherche, ils
parlent des "conceptions". Or ces deux concepts ne sont pas équivalents: les représentations sont des images, alors que les conceptions fonctionnement comme des schèmes d'action. Voir sur mon
site le document "Composantes sémantiques du concept de "conception [de l'action]", et, sur la critique de
l'usage trop large de "représentations", mon billet en date du 4 mai 2011 intitulé "Les représentations, un concept de plus en plus fumigène". Plus bas dans ce dossier, on trouve d'ailleurs employé un autre concept lui aussi tout aussi
pertinent, et "incontournable", celui de "croyances" (bas de la page 32). On peut se demander si la modification des idées des enseignants ne vient pas du fait qu'en formation ils ne peuvent
avoir encore que des représentations et des croyances, alors qu'avec l'expérience ils acquièrent forcément des conceptions, qui vont venir
modifier les premières. La différence entre représentations et conceptions est centrale dans les enjeux actuels de la recherche en didactique des
langues-cultures, dans la mesure où les conceptions ont logiquement le statut, dans l'approche "co-culturelle" de la perspective actionnelle, qu'avaient les représentations dans l'approche
interculturelle. Je ne peux que reprendre vigoureusement à mon compte, en l'appliquant à ce débat méthodologique actuel en didactique des langues-cultures, la demande de Jean-Yves ROCHEX
que j'avais mise comme titre d'un de mes billets sur ce Blog-Notes, en date du 6 décembre dernier : « Le débat français sur PISA 2012 exige un "toilettage conceptuel" ».
(3) Pour lui
[Reuter 2013], l’erreur est en effet un dysfonctionnement inhérent à la situation
d’apprentissage (...). "Il ne faudrait pas "donner un caractère naïvement "positif" à l'erreur". (p. 30)
Ces deux affirmations de Reuter sont surprenantes, parce qu'il n'est pas possible de donner une seule et unique description de l'erreur : les erreurs sont de types divers, comme les recherches en didactique des langues-cultures l'ont bien montré : elles peuvent par exemple provenir aussi d'un dysfonctionnement (et non pas, de toutes manières, "être un dysfonctionnement) non pas de la compétence acquise à un moment donné du processus d'apprentissage, mais de la performance (c'est le cas des "lapsus"), ou encore d'un fonctionnement correct de l'apprentissage (c'est le cas des erreurs... positives provenant d'une hypothèse sur le fonctionnement de la langue étrangère apprise qui est certes erronée, mais qui témoigne d'une construction active par l'apprenant de son interlangue). Si les auteurs du dossier sont favorables à la théorie constructiviste, ils ne peuvent, comme cela semble être le cas, partager cette idée de Reuter, du moins telle qu'ils l'expriment.
(4) Une autre réponse consiste à préparer de façon intensive les élèves au transfert impliqué par l’approche en termes de compétences, et à leur faire travailler en particulier de façon explicite l’axe de la complexité tout autant que celui de la difficulté (Roegiers, 2014). L’école met traditionnellement au centre de l’attention la difficulté, c’est-à-dire le passage du connu au pas encore connu, mais rarement la complexité, c’est-à-dire les nouvelles articulations de ressources déjà connues. (p. 31)
L'usage que fait Xavier Roegiers du concept de "complexité" dans toute sa "pédagogie de l'intégration" est très discutable, surtout, si, comme le fait un collaborateur de Roegiers, F.-M. Gérard,
on compare le sens que donnent Roegiers et Morin à ce concept : Gérard se réclame de Morin à propos de ce concept de Roegiers dans un article disponible en ligne sur son site
personnel, "La complexité d'une évaluation des compétences à travers des situations complexes : nécessités théoriques et exigences du terrain". Or pour
Morin, la complexité relève toujours de l'imprévisible, de la contradiction interne, de l'incertitude, ou encore de l'impossibilité de parvenir à une maîtrise parfaite et définitive, ce qui est
incompatible avec le sens que lui donne Roegiers. C'est plutôt le passage du connu à l'inconnu qui caractériserait précisément l'approche de la complexité telle que la conçoit Morin (ainsi que
tous les épistémologues que j'ai pu lire sur cette question). Suite à mon billet en date du 27 décembre 2013 (ou, d'ailleurs, je n'avais pas encore vu le problème posé par la définition de
la complexité prêtée à Roegiers par Gérard), j'ai eu il y a quelques mois un court échange de courriels avec ce dernier. Nos échanges se sont terminés très vite, dès qu'il m'a écrit qu'en
définitive le sens que donnait Morin à la complexité n'était pas important, mais seulement celui que lui donnait Roegiers. Certes, l'usage particulier d'un concept est légitime dès qu'il est
clairement défini, comme c'est le cas. Mais alors, pourquoi se réclamer de Morin, qui en fait un usage opposé ?...
L'évaluation, comme toute problématique didactique, est par définition "complexe" - je qualifie pour cela depuis des années ma discipline de "didactique complexe des langues-cultures" -: la complexité, ni pour cette discipline ni pour l'évaluation en général, ne peut assurément avoir le sens que lui donne Roegiers.
Christian Puren
Multiculturalisme, pluriculturalisme et perspective actionnelle
On trouvera sur son site personnel, à l'adresse http://koubi.fr/spip.php?article836 (mise en ligne 8 février 2014, dernière consultation 22 août 2014), un très intéressant article d'une professeure de Droit, Geneviève KOUBI, publié à l'origine dans la Revue hellénique des droits de l'homme (n° 28, 2005, pp. 1177-1279), et intitulé "Brèves remarques à propos d'une distinction entre multiculturalisme et pluriculturalisme". Extraits :
- […] le multiculturalisme préconise la constitution de “groupes culturels” spécifiques dont les traits distinctifs sont déterminés à l’aide de références externes (issues de pensées majoritaires qui déterminent “l’altérité”) et selon des thèses internes (repliées sur des “appartenances” dites communautaires ou identitaires. […] Cette prédétermination institutionnalise le groupe “homogène” - ce qui restreint les espaces d’action de l’individu qui répond aux qualifications et aux attributs retenus et qui est désigné de facto comme appartenant à ce groupe sans avoir nécessairement exprimé un tel choix. […] Les divisions sociales et culturelles suscitées par cette approche font que chaque groupe compris comme une “communauté” ou évoqué comme une “catégorie de population”, devient un des éléments d’une autre forme de multitude renvoyant à une totalité factice ou artificielle qui ne peut être ni le peuple, ni la nation, ni le corps social mais un agglomérat de groupes réunissant chacun des individus “identiques” sous une même bannière. Le groupe devient un des éléments de la multitude. (je souligne)
- […] le préfixe pluri- désigne un facteur unificateur. Il signale l’existence d’une entité globalisante qui comporte plusieurs éléments certes distincts et pourtant liés ou rassemblés dans un ensemble général unique et unitaire. Par la pluralité dans laquelle il opère, il retrace la diversité des éléments constitutifs d’une entité organisée dans l’interdépendance et la solidarité sans avoir recours à des modalités de classement arbitraire (i.e. négateur du libre arbitre ou libre choix de l’individu), ni à des formes de classification différencialiste. […] [Le pluriculturalisme] répond à une compréhension des relations interculturelles et intra-culturelles, c’est-à-dire dans la corrélation permanente des groupes de populations - sans appuyer la démesure de la tolérance qui renouvelle les formes d’ostracisme sous les couleurs didactiques du respect des différences. Composante dynamique des modes relationnels politiques et collectifs, le pluriculturalisme ne préconise pas de formes de juxtaposition de ces groupes ; il contribue ainsi, pour une part non négligeable, à un décloisonnement des référents culturels trop souvent dits identitaires. (je souligne)
On trouve dans ce texte cette belle formule synthétique: "En quelque sorte, alors que le multi- prône la "réunion", le pluri- préconise l'"assemblée".
Ces définitions de "multiculturel" et de "pluriculturel" sont compatibles avec celles qui me semblent s'être imposées en didactique des langues-cultures, où le qualificatif de "multiculturel" correspond au simple constat de l'existence de plusieurs cultures différentes parmi les individus d'une même société, alors que celui de "pluriculturel" postule l'existence de relations dynamiques entre ces cultures au niveau des individus, des groupes et de la société toute entière.
Les passages en gras dans les deux extraits ci-dessus, ainsi que la distinction faite par Geneviève KOUBI entre la "réunion" (où les personnes peuvent se contenter de passer un moment ensemble) et l'"assemblée" (qui a forcément des visées décisionnelles et actionnelles, comme par exemple l'assemblée générale d'une association), permettent de comprendre le lien structurel existant entre la notion de pluriculturalisme et la perspective actionnelle : dans une société multiculturelle, l'action sociale collective implique la mise en oeuvre de la dynamique pluriculturelle : lorsque l'on agit (ou "co-agit") avec des personnes d'autres cultures, les cultures d'action (c'est-à-dire les ensembles cohérents de conceptions de l'action) des uns et des autres vont forcément se confronter, et demander, pour que cette action collective se poursuive et réussisse, des opérations de médiation. Et lorsque les co-actions sont répétées parce que l'on doit agir avec les autres dans la durée, comme c'est le cas dans les sociétés qui ne se contentent pas d'être "multiculturelles", mais se veulent "pluriculturelles" (qui se veulent "une entité organisée dans l'interdépendance et la solidarité", pour reprendre les mots de Geneviève KOUBI), il se crée forcément une culture commune d'action, une "co-culture".
Cette relation structurelle entre le pluriculturel et la médiation, d'une part, le co-culturel et la co-action, d'autre part, permet peut-être d'expliquer a posteriori l'émergence simultanée, dans le CECRL, à la fois de la compétence pluriculturelle et de la perspective actionnelle ; en tout cas de la légitimer et de s'en réjouir. Et on ne peut du coup que déplorer à nouveau (voire se scandaliser...) de l'abandon par les "experts" de la Division des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe, quelques années après la publication de ce document, simultanément de l'idée de "perspective actionnelle", et de la notion de "pluriculturel" pour un retour aussi inexpliqué qu'inexpliquable à la seule notion ancienne d'"interculturel" : on pourra (re)lire à ce propos sur mon Blog-Notes mon billet d'humeur en date du 21 juin 2012 intitulé "Enfin un vrai débat sur les orientations de la Division des Politiques Linguistiques du Conseil de l'Europe ?"...
Publication d'un cours en ligne sur la méthodologie de la recherche documentaire en didactique des langues-cultures
Je vous signale la parution, sur le site personnel de Marie BERCHOUD, à l'adresse
http://www.marieberchoud.com/apprendre-les-langues-fle-s-fos/, d'un cours-TD complet en trois fascicules sur la méthodologie de la recherche documentaire intitulé "Méthodologie de la recherche en Lettres et sciences humaines (processus, démarches et recherche documentaire), avec un focus sur la didactique des langues vivantes, incluant le contact des cultures".
Il s'agit d'une dernière version actualisée d'un cours donné à l’université de Bourgogne, aux niveaux Master FLE-DDL-SDL, en cours à distance du CFOAD, de 2005 à 2012.
On trouvera le sommaire de chacun de ces fascicules dans la présentation de ce site à la rubrique "Mes sites préférés" (à propos du site de cette collègue, tout en bas de la page).
Perspective actionnelle et pédagogie Freinet : à propos d'une expérience Freinet dans un établissement secondaire "ordinaire"
Dans l'Expresso d'aujourd'hui 12 mai 2014, sur le site du Café pédagogique , est publié un intéressant article intitulé "Une expérience Freinet dans le secondaire : Le CLEF (Collège– Lycée Expérimental Freinet) de La Ciotat".
Tout article sur la pédagogie Freinet est a priori intéressant pour les enseignants et didacticiens de langues étrangères en raison des affinités - que les lecteurs de mon site connaissent bien - entre la perspective actionnelle et la pédagogie Freinet (voir en particulier mon article 2013f) :
http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2013f/
L'auteure de cet article rappelle justement que cette pédagogie est "une pédagogie par l'agir. Les élèves font œuvre : leurs projets (d'écriture, de recherche, mais aussi de fabrication) doivent aboutir à une réalisation. (...) Plusieurs fois dans l'année sont organisées des présentations de travaux d'élèves, soit pour leurs pairs, soit pour le public extérieur et leurs parents." Et qu'elle travaille en parallèle les deux dimensions antagonistes et complémentaires à la fois de toute éducation: "individualité et citoyenneté".
Cet article est particulièrement intéressant parce qu'il porte sur "la seule filière de pédagogie Freinet implantée dans un établissement secondaire public en France", avec une seule classe concernée par niveau, les autres classes étant traditionnelles ; et que du coup le bilan porte naturellement en partie sur la question de savoir s'il est possible d'introduire cette pédagogie dans un établissement ordinaire "même sans adopter l'ensemble de la démarche". La réponse semble positive, même si dans ce cas, pour adopter, il faut adapter.
Outre la réalisation par les élèves de projets, débouchant forcément sur ces réalisations concrètes projetées en dehors de la classe (cf. plus haut), on retrouve sans surprise dans ce compte rendu les autres caractéristiques de la démarche de projet, comme celles qui apparaissent dans le paragraphe consacré à l'anglais langue étrangère, que je copie intégralement ci-dessous : importance du travail collectif, recherche par les élèves eux-mêmes d'une documentation que l'enseignant va utiliser pour le travail sur la langue. L'article est d'ailleurs écrit par une documentaliste de l'établissement, qui note que dans cette expérience "la professeure-documentaliste est d'emblée reconnue comme une enseignante à part entière, elle donne des cours de sciences de l'information."
En anglais ((aussi)) on part de l'envie de l'élève de s'exprimer (ce qui n'est pas exclusivement Freinet). Au départ on mise sur le mimétisme à l'oral, mais aussi d'emblée sur l'entraide entre les élèves, qui se proposent mutuellement des expressions et des correctifs. Et on fait écrire aux élèves les mots dont ils ont besoin pour s'exprimer. Les besoins qui apparaissent pour l'expression déterminent l'ordre des acquisitions. Par exemple dès que les élèves entreprennent de raconter quelque chose, on les initie d'emblée aux temps du passé. Comme en français ((langue maternelle)) on part des productions écrites de l'élève et on l'amène à les améliorer avec l'aide de ses camarades, à faire des fiches, etc. L'interdisciplinarité s'introduit selon les projets, par exemple s'il faut utiliser en technologie des documents rédigés en anglais, ou si on veut réaliser en arts plastiques des œuvres illustrant des textes anglais. Enfin grâce à l'individualisation on peut plus facilement s'appuyer sur les pratiques culturelles des élèves : BD, chansons puis séries télé, conversations avec des étrangers.
Joël Martine, "Une expérience Freinet dans le secondaire : Le CLEF de La Ciotat, http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/05/12052014Article635354691651630131.aspx consulté 12 mai 2014.
Correction d'un bug conceptuel dans la terminologie de la perspective actionnelle
Je viens de mettre à jour le document suivant en Bibliothèque de travail :
- 052, Les enjeux actuels d’une éducation langagière et culturelle à une société multilingue et multiculturelle, www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/052/.
de manière à y corriger un "bug conceptuel".
La seule - mais importante - modification correspondante est la suivante : pour la perspective actionnelle, l'expression "compétences co-langagière et co-culturelle" y remplace l'expression "compétences co-actionnelle et co-culturelle", de manière à respecter la cohérence d'ensemble du champ sémantique : la "compétence co-langagière" (capacité à adopter et/ou se créer un langage commun pour l'action commune) correspond en effet, dans la perspective actionnelle, à la "compétence plurilingue" des didactiques du plurilinguisme et à la "compétence communicative" de l'approche communicative.
La "compétence co-actionnelle" ou "de co-action", pour sa part, se situe en effet naturellement au niveau des compétences d'"explication", d'"interaction" et de "médiation" visées dans le cadre des autres configurations didactiques.
La version espagnole de ce document (052-es) a été corrigée de manière identique.
A lire en ligne : un article de Jean-Jacques RICHER sur la perspective actionnelle
Je signale la publication, dans la revue en ligne Cahiers de l'APLIUT- Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité, d'un excellent article en accès libre de Jean-Jacques RICHER, "Conditions d’une mise en œuvre de la perspective actionnelle en didactique des langues".
S'appuyant sur les origines et le développement de cette notion dans le monde du travail, Jean-Jacques RICHER définit la "compétence" de la seule manière qui soit vraiment cohérente avec le nouveau paradigme actionnel émergeant dans le CECRL, qui implique que l'enseignement scolaire se donne comme finalité la formation des élèves en tant qu'acteurs sociaux, et que l'enseignement aux adultes prenne en compte leur expérience et leur statut d'acteurs sociaux. Cette conception de la compétence est celle d'un savoir, d'un vouloir et d'un pouvoir réaliser des actions complexes, c'est-à-dire exigeant en particulier un certain niveau d'autonomie et de responsabilité, une gestion de l'information au-delà de la seule communication, une dimension réflexive et une dimension collective.
Ce nouveau paradigme actionnel appelle, selon Jean-Jacques RICHER, un nouveau paradigme méthodologique, que les auteurs du CECRL ont désigné sous le nom d'"approche actionnelle", mais sans vouloir - et sans doute pouvoir - le construire. Pour cela, il estime qu'un certain nombre de chantiers doivent être ouverts ou réouverts, concernant la "linguistique actionnelle", les "stratégies", la "motivation" et le "projet".
Je partage entièrement les analyses de Jean-Jacques RICHER, et j'encourage d'autant plus vivement à lire cet article que peu nombreux sont les didacticiens, du moins en France, qui ont pris la mesure de ces chantiers, et s'y sont lancés.
Tout au plus ajouterais-je que la compétence visée par la perspective actionnelle est celle que l'on doit mettre en oeuvre dans des environnements plurilingues et pluriculturels, comme le sont aussi bien la salle de classe (domaine éducationnel) que les sociétés européennes où les citoyens doivent vivre ensemble (domaine public), et que les milieux de travail où ils doivent travailler ensemble (domaine professionnel). Par rapport à l'approche communicative antérieure, cette homologie entre les trois domaines et leurs enjeux fondamentaux amène à reconsidérer - pour reprendre les trois perspectives à mes yeux constitutives de la didactique des langues-cultures - non seulement le paradigme méthodologique, mais aussi les paradigmes didactique et didactologique.
Christian PUREN
Quel(s) type(s) de recherche pour améliorer l'enseignement-apprentissage ?
La récente publication des résultats de l'enquête PISA a relancé en France le débat sur la manière la plus sûre d'améliorer l'efficacité du système scolaire, et par conséquent sur la conception de la recherche en éducation, d'une part, et sur la manière de la rendre la plus utile possible sur le terrain, d'autre part. Cette problématique ne peut que nous intéresser en didactique des langues-cultures, discipline dont l'objectif fondamental est précisément l'amélioration de l'enseignement-apprentissage des langues-cultures.
Olivier REY, Chargé d’étude et de recherche au service "Veille et Analyses" de l’Institut Français de l’Éducation (IFÉ), a remis à jour et publié ce mois (janvier 2014) un très intéressant dossier de 2006 intitulé "Entre laboratoire et terrain : comment la recherche fait ses preuves en éducation ?" (voir références complètes en bas de ce billet). Mon présent billet n'a pas la prétention d'en faire le résumé (ce serait bien difficile : les 26 pages de ce dossier sont déjà très denses, et incitent fortement à rechercher les développements des idées présentées dans la bibliographie proposée), mais de faire état des quelques réflexions que sa lecture m'a suscitées.
1) L'un des intérêts de ce dossier est de présenter en détail une conception de la recherche en éducation appellée l'evidence-based education. C'est la conception dominante depuis quelque temps dans les pays anglo-saxons, et elle s'est imposée dans les organisations internationales. L'"évidence", en l'occurrence, serait celle que procurent des recherches menées de manière scientifique, le modèle en étant la recherche médicale avec ses protocoles, méthodes et dispositifs expérimentaux.
2) C'est sur cette evidence-based education que s'appuie le modèle international de réforme de l'éducation par la diffusion des "bonnes pratiques" : ce sont celles qui ont été dégagées par la recherche scientifique et qui peuvent par conséquent être imposées comme telles. Ces "bonnes pratiques" dont on parle dans les réunions internationales ne sont donc pas, comme certains le pensent en France, celles qui auraient été dégagées par des innovations imaginées et réalisées par des enseignants sur le terrain, qui y auraient montré leur efficacité, et qui pourraient se diffuser par un effet "tache d'huile" et/ou par leur reprise dans les contenus de formations initiale et continue. Il y a là, souvent me semble-t-il, une confusion à lever dans les discours que l'on tient en France sur les "expérimentations" et les "bonnes pratiques" dans l'enseignement scolaire.
J'ai déjà eu l'occasion il y a quelques années de critiquer ce concept anglo-saxon de "bonnes pratiques" - qui relève en fait d'une idéologie scientiste - dans un article intitulé "Quelques conclusions personnelles sur les Conclusions du Conseil sur l'indicateur européen des compétences linguistiques de 2006" (2007a/, voir point n° 4, p. 3). Aux yeux des partisans de la recherche "scientifique" en éducation, ce que l'on appelle les "expérimentations" des enseignants sur le terrain ne correspond pas du tout à de l'"expérimental" telle qu'ils le conçoivent, mais à de l'"expérienciel".
3) En France, tout particulièrement, s'est développé un type de recherche appelé "recherche-action", dont Olivier REY aurait peut-être dû parler dans son dossier parce qu'il est intermédiaire entre la recherche expérimentale et la recherche expériencielle : les recherches-actions sont en effet conçues et réalisées par les enseignants sur le terrain, mais en collaboration étroite et constante avec des chercheurs universitaires. Ce type de recherche entre de plein droit avec les deux autres dans un éventail de types de recherche aussi légitime que nécessaire pour diversifier les approches de problématiques aussi complexes que les problématiques éducatives. Je suis donc en total accord avec Olivier REY lorsqu'il écrit, critiquant les prétentions de l'evidence-based education:
Éviter les effets hiérarchiques d’une vision applicationniste pourrait consister à ne plus considérer qu’il y a une seule façon de faire de la recherche, avec une version noble et une version dégradée, mais plutôt différents types d’enquêtes légitimes. Les recherches en éducation pourraient ainsi être définies comme un ensemble d’activités scientifiques qui se distribuent sur un continuum allant de l’investigation guidée par la théorie universitaire jusqu’à l’investigation induite par les pratiques éducatives, ceci incluant une multitude de modèles de recherche explicitement conduits dans, avec et/ou pour la pratique. (p. 21)
4) Cette même diversité des types de recherche se retrouve légitimement dans les recherches initiales des étudiants-chercheurs, celles qu'ils mettent en œuvre dans leur mémoire ou leur thèse. Dans l'un des chapitres de mon cours "La didactique des langues-cultures comme domaine de recherche"(p. 3), j'en ai proposé la modélisation suivante, où l'on retrouvera mise en œuvre le mode du continuum :

Je renvoie à ce chapitre 5, intitulé "Mettre en œuvre ses méthodes de recherche", qui est consacré entièrement à la présentation de ce modèle.
La démarche d'amélioration de l'enseignement-apprentissage de l'evidence based education consiste à passer directement des résultats de l'expérimentation à l'application, les enseignants n'étant que des exécutants qui n'ont pas accès en tant que tels à la recherche et au processus de modélisation qu'elle implique, ni en ce qui concerne la recherche-expérimentation - on leur communique uniquement les résultats de cette recherche -, ni en ce qui concerne la recherche-application - on n'attend pas d'eux qu'ils modifient les méthodes qu'on leur demande d'appliquer. C'est ce que l'on appelle la démarche "applicationniste", heureusement dépassée en didactique des langues-cultures depuis le début des années 1970 (du moins faut-il l'espérer...).
Après la question des types de recherche, reste celle, au moins tout aussi difficile, et en tout cas tout aussi importante, des modes de diffusion des améliorations que ces recherches proposent, l'objectif ultime, celui que vise le didacticien, étant en effet leur généralisation et leur pérennisation. L'expérience historique semble bien montrer que si la logique top down, celle de l'imposition autoritaire par l'institution d'innovations décrétées "scientifiques" par les experts, ne fonctionne pas, la logique bottom up, celle des innovations de terrain qui se généraliseraient par simple effet de contagion (de "tache d'huile") et/ou par reprise dans les contenus des formations initiale et continue, n'est pas plus efficace... Or, contrairement aux différents types de recherche, on ne voit pas très bien comment on pourrait concrètement combiner ces deux logiques sur le terrain, trop incompatibles sans doute pour y être complémentaires.
Christian Puren
______________________________________
REY Olivier (2014). "Entre laboratoire et terrain : comment la recherche fait ses preuves en éducation". Dossier de veille de l’IFÉ, n°89, janvier. Lyon : ENS de Lyon. En ligne :
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=89&lang=fr.
À propos de la sempiternelle polémique entre "méthode syllabique" et "méthode globale" dans l'enseignement-apprentissage de la lecture à l'école primaire
Dans une note de son "Expresso" du 18 novembre dernier, le Café Pédagogique signalait la publication d'un "Rapport de recherche" sur la lecture au cours préparatoire (élèves de 6-8 ans) publié par un laboratoire de Université de Versailles (St-Quentin-en-Yvelines), qui concluait:
Ce sont les classes dans lesquelles l’apprentissage est résolument centré sur le déchiffrage, considéré comme la clé de l’accès au sens, et organise son étude de façon progressive et systématique, l’élève pouvant déchiffrer de façon autonome tout ce qu’on lui propose à lire, sans recours à la lecture devinette, qui obtiennent des résultats dont la supériorité est statistiquement bien établie. (p. 30)
Ce rapport réactivait ainsi une de ces polémiques interminables dont nous avons le secret, en France, entre la méthode syllabique et la méthode globale pour l'enseignement-apprentissage de la lecture en langue maternelle dans l'enseignement primaire.
Dans l'Expresso du 3 janvier 2014, le Café pédagogique donne à nouveau suite à cette polémique en signalant la réaction de Roland Goigoux, professeur à l'université de Clermont-Ferrand, au Rapport de recherche cité ci-dessus, réaction publiée dans une tribune du journal Le Monde en date du 31 décembre 2013.
Roland Goigoux signale que l'une des enquêtes sur lesquelles s'appuie cette recherche
(1) révèle tout d’abord que, malgré les injonctions passées, seuls 4% des enseignants de cours préparatoire travaillant en zone d’Éducation prioritaire utilisent une méthode syllabique pure. Tous les autres utilisent des approches que les sociologues réunissent sans distinction sous le vocable de « mixtes » alors qu’elles combinent de manière très variable les apprentissages du déchiffrage, de l’écriture, du vocabulaire, de la compréhension de textes écrits lus par l’enseignant... Bref une vaste palette de dégradés de gris, là où on voudrait faire croire à une opposition binaire entre noir et blanc.
Et il écrit, se référant à ses propres recherches en cours :
(2) Nous ne proposons pas d’innovation dont nous chercherions à montrer la supériorité, nous nous efforçons seulement d’identifier les pratiques qui s’avèrent les plus efficaces et les plus équitables. Nous faisons l’hypothèse que celles-ci présentent des caractéristiques communes qui ne coïncident pas avec les typologies archaïques (« mixte » versus « syllabique ») et que plusieurs configurations de variables didactiques peuvent aboutir à des apprentissages similaires. En effet, si aucune étude comparative des « méthodes » de lecture n’a permis d’établir la supériorité de tel dispositif sur tel autre, ce n’est pas parce que toutes les pratiques se valent mais parce que la variable "méthode", trop grossière et mal définie, n’est pas une variable pertinente pour une telle recherche.
Il se trouve que la "méthode syllabique" et la "méthode globale" correspondent à l'application, à l'enseignement initial de la lecture aux enfants, respectivement de ce que j'appelle la "méthode analytique" et la "méthode synthétique" dans mon "Tableau des oppositions méthodologiques fondamentales", élaboré à partir d'une analyse comparée des méthodologies constituées en didactique des langues.
Dans le premier passage (1) cité ci-dessus, je ne peux qu'être d'accord avec Roland Goigoux et les sociologues auxquels il fait appel : les méthodes analytique et synthétique fonctionnent en effet de manière à la fois opposée et complémentaire. La question n'est pas de savoir quelle est la meilleure, mais comment les articuler l'une à l'autre (i.e. les faire se succéder chronologiquement en fonction des élèves, des objectifs, des tâches et autres paramètres du dispositif d'enseignement). C'est aussi le cas de toutes les autres couples de méthodes : transmissive et active, déductive et inductive, onomasiologique et sémasiologique, conceptualisatrice et répétitive, applicatrice et imitative, compréhensive et expressive, écrite et orale, pour me limiter aux couples de mon tableau qui me semblent intuitivement pertinents pour cet enseignement-apprentissage de la lecture.
- Lorsqu'il dit, dans le second passage (2) cité, que la "variable méthode" n'est pas pertinente, je peux encore le suivre à la limite, du moins s'il se réfère au seul couple méthode syllabique versus méthode globale. Même si, comme il serait logique, il devrait prendre en compte le fait que si l'on considère ces deux méthodes opposées comme étant aussi complémentaires, elles permettent déjà des séquences de classe très variées, si on les articule de manière différente dans des micro-séquences successives:
1. synthétique -> 2. analytique -> 3. analytique -> synthétique -> etc.
2. analytique -> synthétique -> analytique -> analytique -> etc.
Etc., etc.
La variation peut en effet porter non seulement sur l'ordre de ces micro-séquences, mais sur l'importance (en termes de temps passé et/ou de contenus abordés) qu'on accorde à chacune de ces micro-séquences.
Ce n'est pas là une simple spéculation de ma part: dans mon Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues, chapitre 1.4, pp. 42 sqq., j'ai montré comment la méthodologie "traditionnelle" avait ainsi pu donner lieu au cours du XIXe siècle à quatre formes différentes de mise en oeuvre simplement à partir des deux éléments de son noyau dur méthodologique, "grammaire" (méthode conceptualisatrice) et "traduction" (méthode indirecte), en jouant sur leur importance plus ou moins grande (représentée ci-dessous par l'écriture de l'élément en minuscules ou en majuscules) et sur leurs places respectives dans la séquence d'enseignement :
1) GRAMMAIRE -> traduction
2) traduction -> GRAMMAIRE,
3) grammaire -> TRADUCTION
4) TRADUCTION -> grammaire
Si les méthodologues de l'époque avaient fait intervenir l'opposition méthode transmissive / méthode active pour les combiner avec ces éléments (mais ils ne pouvaient pas y penser, la pédagogie de l'époque privilégiant massivement la transmission), le nombre de séquences différentes envisageables se serait accru considérablement : 16 articulations-combinaisons différentes sont en effet mathématiquement possibles alors sans remettre en cause le noyau dur méthodologique grammaire-traduction. Dans le cas de l'enseignement de la lecture, le simple jeu sur cette seconde variable méthodologique fait exploser le nombre possible de séquences différentes :
1) 1. synthétique + active -> 2. analytique + transmissive -> 3. analytique + active -> etc.
2) 1. analytique + active -> 2. synthétique + active -> 3. analytique + transmissive -> 4. synthétique + active -> etc.
Etc. etc.
Ce type de combinaisons-articulations appliquées à l'ensemble des oppositions méthodologiques (celui de mon tableau des oppositions méthodologiques fondamentales cité plus haut) fournit un macro-modèle théorique capable a priori de décrire, à ce niveau méthodologique bien entendu, toutes les pratiques concrètes d'enseignement-apprentissage imaginables. Je renvoie au Dossier n° 2, "La perspective méthodologique", de mon cours en ligne "La DLC comme domaine de recherche", plus précisément aux exemples d'"analyses micro-méthodologiques" qui l'on trouvera au chapitre 4, pp. 14 sqq., ainsi qu'au corrigé des tâches qui y sont proposées.
Si l'on entend l'expression "variable méthode" dans le sens de "variable méthodologique" (i.e. concernant toutes les méthodes), je ne suis donc plus du tout d'accord avec Roland Goigoux: c'est certainement, contrairement à ce qu'il dit , une variable pertinente, parce qu'elle n'est pas "grossière" mais très complexe, et qu'elle permet de décrire très précisément les pratiques effectives non seulement telles qu'elles peuvent être programmées par les enseignants, mais telles qu'ils les adaptent ensuite en temps réel en classe.
Mon accord le plus résolu va finalement à un lecteur du Café Pédagogique, "Ricky", qui réagissait déjà à l'information du 18 novembre 2013 en trouvant "incroyable" qu'un site spécialisé comme le Café pédagogique se fasse à nouveau l'écho de cette polémique aussi récurrente qu'inutile :
Pourquoi ne pas préciser qu'aucun enseignant n'enseigne la lecture de manière uniquement globale ou syllabique, et que c'est un faux débat puisque tout bon lecteur a forcément besoin de lecture globale ET de lecture syllabique ?
Les seules questions valables, effectivement, lorsque l'on parle de méthodologie, sont de savoir quand, comment et pourquoi articuler telle méthode et la méthode opposée... en combinant l'une et l'autre à quelles autres parmi toutes celles disponibles.
Christian Puren
Évaluation des compétences et complexité : à propos du site d'un pédagogue belge, F.-M. GÉRARD
J'ai découvert aujourd'hui, un peu par hasard - en préparant une conférence sur l'évaluation -, le site (http://www.fmgerard.be/) d'un pédagogue belge, François-Marie GÉRARD. Ce site est principalement consacré aux chanteurs (il n'y a pas que la pédagogie dans la vie...), et il n'est pratiquement plus alimenté depuis fin 2008 : la dernière mise à jour date d'un an exactement, du 24 décembre 2012.
Mais ce site propose sur une même page (http://www.fmgerard.be/textes/) en téléchargement libre plusieurs articles de l'auteur concernant la pédagogie en général, particulièrement l'évaluation, et, plus spécifiquement encore, l'évaluation des compétences : sur ce dernier thème, lui aussi d'actualité en didactique des langues-cultures, il ne peut qu'être profitable de confronter les approches des deux disciplines. Il se trouve en outre que François-Marie GERARD fait constamment référence à la notion de complexité, dont on sait l'importance que je lui accorde, moi aussi, en didactique des langues-cultures : la "compétence" n'existe en effet pour lui que par rapport à des situations complexes, et elle ne peut par conséquent être évaluée que dans des situations complexes. Il partage en cela la conception de la plupart des pédagogues, comme Jean-Marie DE KETELE, Philippe PERRENOUD, ou encore Jacques TARDIF, dont j'ai reproduit le schéma du modèle de compétence dans mon article 2011j (p. 10).
Les deux articles suivants m'ont plus particulièrement intéressé pour cette raison :
- GÉRARD, F.-M. (2008), "La complexité d'une évaluation des compétences à travers des situations complexes : nécessités théoriques et exigences du terrain", in : ETTAYEBI, M., OPERTTI, R. & JONNAERT, P. (Éd.), Logique de compétences et développement curriculaire : débats, perspectives et alternative pour les systèmes éducatifs, Paris : L'Harmattan, pp. 167-183.
http://www.fmgerard.be/textes/ComplexEval.pdf.
- GÉRARD, F.-M. (2005), "L'évaluation des compétences à travers des situations complexes", Actes du Colloque de l’Admee-Europe, IUFM Champagne-Ardenne, Reims, 24-26 octobre 2005. http://www.fmgerard.be/textes/SitComp.pdf.
Dans ces deux articles, l'auteur a recours à l'épistémologie de la complexité et à l'opposition compliqué/complexe (que F.-M. GÉRARD emprunte à X. ROEGIERS, lequel l'a emprunté à Edgard MORIN) pour différencier des types de compétences et les dispositifs d'évaluation correspondants.
L'auteur ne se contente pas de considérations théoriques, mais propose des exemples concrets de dispositifs et de tâches d'évaluation. L'article le plus récent (2012) s'intitule d'ailleurs "Un dispositif intégré pour l’évaluation des acquis des élèves de 7e année à Madagascar", Communication au Colloque de l’Admee-Europe, Université de Luxembourg, Luxembourg, 11 au 13 janvier 2012, http://www.fmgerard.be/textes/dispositif.html (téléchargeable seulement en version html). J'y ai noté un intéressant "tableau récapitulatif des modalités d'évaluation" parmi lesquels on trouve l'"évaluation par situation complexe" et les... "mini-projets". Je le reproduis ci-après :
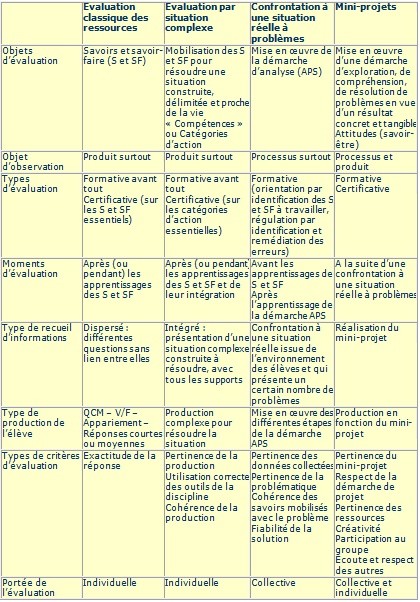
L'auteur - et on ne peut que lui en savoir gré - ne cache pas les multiples et lourdes difficultés de mise en oeuvre d'une telle évaluation des compétences en milieu scolaire. Comme dans le passage ci-dessous :
(...) si l’évaluation par situations complexes est la seule pertinente dans le cadre d’un système éducatif s’étant inscrit dans la perspective de l’approche par les compétences de base (ROEGIERS, Une pédagogie de l’intégration, Bruxelles : De Boeck, 2000), elle présente certaines difficultés en termes d’acceptabilité sociale, tant pour les élèves et les enseignants que pour les parents. Il n’est pas facile de passer d’une culture du par coeur ou de l’application mécanique à celle de la résolution de problèmes, d’autant plus que celle-ci entraîne d’autres manières de corriger et d’autres manières de communiquer l’information, et qu’elle n’offre pas le même caractère de légitimité que les épreuves classiques où la réponse pseudo-objective conduit trop souvent à la seule sélection.
http://www.fmgerard.be/textes/SitComp.pdf, p. 2)
On lira aussi avec plaisir un article humoristique sur le jargon pédagogique (ce qui montre chez F.-M. GÉRARD un sens certain de l'auto-dérision...) : "Fruit ou compétence ? Capacité ou légume ? Billet d'hume/our face au jargon pédagogique", où l'on trouvera malgré les apparences une réflexion aussi sérieuse qu'intelligente sur la distinction entre compétence et capacité
(Français 2000, 154-155, 2-6, http://www.fmgerard.be/textes/CompLeg.pdf).
Christian Puren
Le débat français sur PISA 2012 exige un "toilettage conceptuel" (J.-Y. Rochex)
La publication il y a quelques jours du rapport PISA, qui montre que l'Ecole française est première... en ce qui concerne la transformation des inégalités sociales en inégalités scolaires, donne actuellement lieu à une avalanche de commentaires dans tous les médias.
Si vous ne deviez lire que deux textes à cette occasion, je vous conseillerais personnellement les comptes rendus de deux entrevues données au Café pédagogique par Jean-Yves Rochex, Professeur en Sciences de l'éducation à l'Université de Paris 8 et co-auteur avec Jacques Crinon, de l'ouvrage La construction des inégalités scolaires (Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011). Le premier date de plus d'un an, à l'occasion sans doute de la sortie de son livre, le second d'aujourd'hui, à l'occasion de la publication des résultats de l'enquête PISA 2012 :
- « "Jean-Yves Rochex : Réouvrir le chantier de la culture scolaire" » (Expresso du 5 octobre 2012).
- « Pisa 2012 : "Jean-Yves Rochex : Viser le noyau dur de la construction des inégalités scolaires" » (Expresso du 6 décembre 2013).
Outre l'analyse sociologique des causes de ce fonctionnement inégalitaire de l'école française, qui me paraît pertinente - mais je ne suis pas un spécialiste -, j'ai particulièrement noté dans ces deux textes, parce qu'ils éveillent des échos par rapport à mes propres problématiques en didactique des langues-cultures, les quelques points suivants:
1) La nécessité de ce qu'il appelle un "toilettage conceptuel" dans les discours, de manière à éviter
les multiples ambiguïtés qui fondent, à gauche comme à droite, nombre de discours et de projets sur les rythmes scolaires, l’individualisation des parcours, la différenciation de la pédagogie ou encore sur l’autonomie des établissements.
Tous les points suivants, que j'ai aussi notés, me paraissent être de bons exemples de cette nécessaire réflexion sur nos outils de réflexion.
2) La nécessité, pour échapper à la pensée unique et penser de manière complexe, de concevoir que les contraires peuvent être complémentaires (cf. une pensée du peintre et sculpteur français Georges Braque : "Il faut toujours deux idées: l'une pour tuer l'autre"):
(...) à l’encontre des débats caricaturaux, des postures dogmatiques et des oppositions simplistes entre « pédagogues » et « républicains », entre « centration sur les enfants » et « centration sur les savoirs » (...) il faut oeuvrer à concilier les acquis des pédagogies visant à ce que les élèves soient en activité intellectuelle et les exigences des pédagogies explicites et structurées, pour ne pas laisser à la charge des familles ou du hors l’école la construction de ce qui est nécessaire pour apprendre et réussir à l’école.
3) L'affirmation du fait que la "pédagogie différenciée" (le thème principal de son ouvrage de 2012 en collaboration avec J. Crinon) n'est pas, contrairement à ce que laisse entendre l'expression, la seule affaire de l'enseignant :
L’un des premiers actes d’une telle rupture (avec le déterminisme social actuel) devrait à mon sens être de généraliser et de mettre en oeuvre le principe « donner plus à ceux qui ont le moins » bien au-delà des écoles et établissements concernés par la politique ZEP (dans lesquels il est d’ailleurs loin d’être effectif comme l’a montré le récent rapport de la Cour des comptes). La dotation en moyens budgétaires et humains de toutes les écoles et établissements devrait, selon ce principe, être différenciée et varier de manière progressive en fonction des caractéristiques sociales et culturelles des populations qui y sont accueillies, selon des critères élaborés et mis en oeuvre de manière transparente et démocratique.
C'était le sens de la critique que j'avais faite de l'expression "pédagogie différenciée" dans un article de 2003(a) intitulé, de manière provocatrice, "Contre la 'pédagogie différenciée' !" (les guillemets avant et après "pédagogie différenciée" dans ce titre étant bien sûr à noter pour sa bonne compréhension...).
4) L'attention, dans la ligne de ce qu'Edgard Morin appelle "l'écologie de l'action", au fait que l'action peut produire des résultats à l'exact opposé des intentions de l'agent. Un concept tel que celui d'"innovation", systématiquement valorisé, ne tient pas compte de ce risque inhérent à toute action sociale. Or :
On sait aujourd’hui que (...) des modes de faire qui se veulent innovants et favorables aux enfants de milieux populaires peuvent aller à l’encontre des objectifs poursuivis et s’avérer aussi inégalitaires que les modes de faire dont ils visaient à se démarquer.
J'a repensé, en lisant ces lignes, à ce que j'écrivais il y a 15 ans dans un article intitulé significativement "Que reste-t-il de l'idée de progrès en didactique des langues" (voir l'article sur le site de l'APLV, ou sur mon site personnel (1997d).
5) Jean-Yves Rochex, enfin, cite Henri Wallon critiquant la culture scolaire française, qui, comme on le sait, réserve les filières les plus "pratiques" (i.e. "techniques", ou "professionnelles") aux élèves les plus faibles, les meilleurs étant systématiquement orientés vers les filières les plus "théoriques", ou "abstraites", en particulier "scientifiques", en rappelant qu'il affirmait la nécessité de prendre en considération l'ensemble des éléments de "la triade théorie-technique-pratique".
Je vais assurément rechercher et lire le texte en question d'Henri Wallon (« Éducation et psychologie », 1961, repris in H. Wallon, Psychologie et dialectique, Paris, Messidor, 1990, parce que j'ai l'impression que ce concept de "triade" correspond, dans son domaine, à la trilogie "théorie-modèle-pratique" que j'ai développée de mon côté comme l'un des concepts épistémologique de base en didactique des langues-cultures : il y a dans les deux cas une interface indispensable entre la théorie et la pratique, et les "techniques" d'enseignement peuvent sans doute être considérées comme des formes de mise en oeuvre directe, en classe, des "modèles" didactiques. Il faudra que j'introduise cette idée dans le document "Le champ sémantique de "méthode" (Document 004).
Christian Puren
La "simplexité", et autres hypothèses de recherche sur les modes de gestion de la complexité en didactique des langues-cultures
Une journée d'étude sur "Simplexité et langage. Rencontre avec le Professeur Alain Berthoz" va se tenir à l'Université Paris Ouest Nanterre le 27 novembre 2013.
Alain Berthoz est connu pour son concept de "simplexité", qu'il a introduit et développé dans un ouvrage publié chez Odile Jacob en 2009, intitulé précisément La simplexité. Il le présente de cette manière dans l'introduction :
(Ce concept désigne) l'une des plus remarquables inventions du vivant, qui s'appplique à de nombreux niveaux d'activité humaine, de la molécule à la pensée, de l'individu à l'intersubjectivité, et ce jusqu'à la conscience et l'amour." (p. 7) (...)
"La vie a trouvé des solutions pour simplifier la complexité. (...) Ces solutions sont des principes simplificateurs qui réduisent le nombre ou la complexité des processus et permettent de traiter très rapidement des informations ou des situations, en tenant compte de l'expérience passée et en anticipant l'avenir, qui facilitent la compréhension des intentions, sans dénaturer la complexité du réel. De mon point de vue, la simplexité est cet ensemble de solutions trouvées par les organismes vivants pour que, malgré la complexité des processus naturels, le cerveau puisse préparer l'acte et en anticiper les conséquences. Ces solutions ne sont ni des caricatures, ni des raccourcis, ni des résumés. Posant le problème autrement, elles permettent d'arriver à des actions plus élégantes, plus rapides, plus efficaces. Elles permettent aussi de maintenir ou de privilégier le sens, même au prix d'un détour.
La simplexité est cette complexité indéchiffrable, car fondée sur une riche combinaison de règles simples" (pp. 11-12).
Cette problématique intéresse directement les didacticiens et formateurs de langue-culture étrangère. Comment les enseignants gèrent-ils en temps réel dans leurs classes une complexité qu'ils ne peuvent pas connaître parfaitement, et qu'ils ne pourraient maîtriser entièrement même s'ils en avaient la connaissance pleine et entière ? Comment peut-on les former - ou du moins les aider à se former - à cette gestion de la complexité ? Comment les étudiants peuvent-ils se former à la complexité de la recherche dans leur discipline tout en effectuant leur recherche personnelle (pour le mémoire de master ou la thèse) sur une thématique restreinte travaillée sur un terrain limité ?
La dernière phrase de la citation ci-dessus d'Alain Berthoz énonce une idée classique chez les "épistémologues de la complexité", et que j'ai reprise pour ma part avec la métaphore du jeu de Lego appliquée à la méthodologie : les "méthodes", dans le sens d'unités minimales de cohérence méthodologique (cf. sur mon site le Document 005 en Bibliothèque de travail), constitueraient les "pièces" que les différentes méthodologies, mais aussi les enseignants en temps réel dans les classes, sélectionneraient pour les combiner (entre elles) et les articuler (l'une après l'autre) en temps réel : voir PUREN 1994d, chap. 3.2.2. "La programmation par objets méthodologiques", pp. 8-10). C'est une hypothèse semblable à celle que proposait René Richterich en 1992 avec sa "didactique du couteau suisse" basée sur "quelques principes simples", et auquel j'ai rendu hommage en choisissant l'image d'un couteau suisse pour le favicon de mon site.
Une autre hypothèse clairement digne d'examen est portée par ce concept de "simplexité" d'Alain Berthoz. Il faudrait certainement approfondir la manière dont elle pourrait être interprétée et mise en oeuvre en didactique des langues en la distinguant des concepts de "modèles" (pour l'appréhension intellectuelle) et de "schèmes" (pour l'action concrète en situation). Ces deux derniers concepts correspondent à la seconde hypothèse que j'ai développée pour ma part (après le "Lego" méthodologique) pour comprendre ce paradoxe de la gestion efficace, par l'enseignant, d'une complexité qu'il ne peut pourtant ni appréhender parfaitement ni maîtriser entièrement.
Une quatrième hypothèse, qu'il ne me semble pas possible non plus d'écarter a priori parce qu'elle correspond aussi, à mon avis, à la réalité de la gestion de leur pratique par les enseignants, est celle de la "rationalité limitée", introduite par Herbert Simon (l'une de mes grandes références épistémologiques personnelles: cf. sur mon site le Document 048) et reprise par certains sociologues en entreprise et théoriciens du management : nos capacités cognitives sont de toutes évidence limitées, et certaines de nos décisions sont même prises parfois "en toute méconnaissance de cause"...
On ne peut qu'être d'accord avec J.-P. Astolfi et M. Develay lorsqu'ils écrivent (dans La didactique des sciences, Paris : PUF, coll. Que sais-je ?, n° 2 448, 127 p.) :
Le métier d’enseignant est d’abord un métier de prise de décision dans des systèmes complexes où interagissent de nombreuses variables dont l’enseignant fait partie. Ainsi l’enseignant doit-il disposer d’outils lui permettant cette gestion du complexe et la prise de décision rapide. (p. 113, cité dans mon Essai sur l'éclectisme, 3e édition en ligne de 2013, p. 119).
Par contre, je pense qu'il leur manque forcément des hypothèses complémentaires moins "rationalisatrices" lorsqu'ils poursuivent ainsi :
"Ces outils sont à chercher du côté de l’observation, de l’analyse, de la gestion, de la régulation et de l’évaluation des situations éducatives."
Cette cinquième hypothèse n'est peut-être pas fausse, mais elle est sûrement insuffisante (ne serait-ce que parce que l'enseignant ne peut pas et ne pourra jamais tout observer et tout analyser...), et elle doit être combinée, au moins dans un programme de recherche sur cette problématique de la gestion de la complexité par l'enseignant, avec les quatre autres.
Les hypothèses sur les modes de gestion de la complexité par les enseignants sont d'une importance capitale étant donné les implications qu'elles ont forcément dans la conception :
a) de la formation initiale des enseignants;
b) de l'observation formative et sommative de leurs pratiques;
c) enfin de la recherche en didactique des langues-cultures.
Exemples de questionnements correspondants :
a') Comment donner aux enseignants débutants des moyens simples et efficaces pour qu'ils puissent assurer un minimum leur travail de la manière la plus sereine possible tout en ne les enfermant pas dans des routines simplificatrices qu'ils risqueront très vite de fossiliser ?
b') Quel paramètre de son environnement d'enseignement peut-on légitimement reprocher à un enseignant de n'avoir pas pris en compte, puisqu'il ne peut jamais appréhender la totalité des paramètres, et que la hiérarchisation de ces paramètres est toujours, plus ou moins, une affaire d'appréciation subjective en contexte ?
c') Comment mener une recherche - ce qui suppose d'en délimiter le domaine et le terrain, d'en choisir l'objet et les objectifs, d'en définir une problématique et d'en fixer les méthodes - sans perdre de vue la complexité de l'ensemble ? Ou, pour utiliser une métaphore concrète, comment creuser profondément son trou sans finir, au fond, par s'y retrouver tout seul et en ayant perdu de vue tout le paysage alentour... ?
Voilà assurément des questions... complexes, pour lesquelles je ne vois pas comment didacticiens et formateurs pourraient faire l'impasse sur des réflexions épistémologiques (comme celles que j'ai abordées dans le chapitre 7 de mon cours traitant de "La didactique des langues-cultures comme domaine de recherche", et sur des hypothèses plurielles qui pourraient bien se révéler, comme le prévoit d'ailleurs l'épistémologie de la complexité, à la fois opposées... et complémentaires.
Cette journée d'étude du 27 novembre 2013 me paraît d'autant plus intéressante que la réflexion ne va pas porter uniquement sur le thème "Simplexité et langage", mais aussi sur la pertinence de ce concept en linguistique et en didactique des langues. Il faut espérer que des Actes en soient publiés assez rapidement.
Christian Puren
Un module d'autoformation gratuit sur le plagiat et le droit de citation
L'UQAM - Université du Québec à Montréal propose un "Module d'autoformation gratuit sur le plagiat et le droit de citation", sous forme de diaporama, que je conseille vivement à tous les étudiants en master et en thèse. Je suggère même aux directeurs de recherche en didactique des langues-cultures d'en imposer la lecture à leurs "dirigés"... et la contrôler.
Ci-dessous, la présentation qu'en fait Thot Cursus dans sa Lettre d'information en date du 13 septembre 2013 (lien brisé) :
Ce module comporte cinq parties. Une première définit la notion de plagiat et livre quelques exemples, c'est-à-dire sept pratiques qui peuvent être qualifiées de plagiaires :
- "Copier textuellement un passage d’un livre, d’une revue ou d’une page Web sans le mettre entre guillemets et/ou sans en mentionner la source ;
- Insérer dans un travail des images, des graphiques, des données, etc. provenant de sources externes sans indiquer la provenance ;
- Résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots, mais en omettant d’en indiquer la source ;
- Traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; - Réutiliser un travail produit dans un autre cours sans avoir obtenu au préalable l’accord du professeur ;
- Utiliser le travail d’une autre personne et le présenter comme le sien (et ce, même si cette personne a donné son accord) ;
- Acheter un travail sur le Web."
Cette première partie livre aussi des chiffres sur le plagiat et propose les moyens de l'éviter. La deuxième partie titrée "Citer correctement ses sources" n'est qu'une suite logique de la première. Y sont présentées les règles de la citation et de la paraphrase. Les trois dernières parties proposent des conseils, un quiz et un résumé à l'utilisateur.
Ce module est offert sous une licence Creative Commons. Il sera utile aussi bien aux étudiants qu'aux formateurs qui pourront s'en servir dans le cadre de l'apprentissage de la culture informationnelle.
Pédagogie différenciée: un utile "pense-bête" sur le site du Café pédagogique
Le site du Café Pédagogique publie ce jour "Pédagogie différenciée : 10
conseils + 1 !", présenté comme "un petit pense-bête, à la fois théorique et pratique, permettant de favoriser la mise en place de pratiques différenciées dans sa classe". Il a été rédigé par
un professeur des écoles, Sylvain GRANDSERRE.
Le document est très court (comme l'est tout "pense-bête" qui se respecte...), mais il regroupe les idées essentielles qui sont à la base de la différenciation pédagogique et de sa mise en
oeuvre. Ces idées sont bien connues - je retrouve en particulier dans le point 8 de ce texte les différents "leviers" de différenciation appelés "domaines de différenciation" dans les documents
produits dans le cadre du Programme de Coopération Européenne que j'avais dirigé sur la pédagogie différenciée, à la fin des années 90, pour l'APLV et 10 autres associations européennes de
professeurs de langues -, mais ce genre de rappel est toujours utile. Voir les Livrets de formation et autoformation à l'intervention en pédagogie différenciée en classe de langue,
sur le site de l'APLV ou sur mon
site.
Dans ce "pense-bête", la question de la gestion des différences en classe est traitée "à la française", c'est-à-dire en mettant plus l'accent sur la différenciation de l'enseignement (la "pédagogie différenciée") que sur la différenciation des apprentissages, à l'inverse de la tradition nordique de l'open learning ou offenes learnen. On le voit bien dans ce document à la place qui y est accordée aux activités d'apprentissage autonome, qui viennent seulement en complément des activités programmées par l'enseignant lui-même. J'avais signalé cette opposition entre deux conceptions de la différenciati n dans un article de 2003 intitulé de manière provocatrice : "Contre la ‘pédagogie différenciée’".
Mais pour l'enseignant il s'agit malgré tout d'un "pense-bête" très bien... pensé, et j'en conseille vivement la lecture, particulièrement aux collègues enseignant les langues étrangères en
milieu scolaire.
Christian Puren
Un nouveau dossier d'Olivier REY (IFE) sur les compétences
Olivier REY vient de publier sur le site de l'IFE (Institut Français d'Education) un excellent nouveau dossier sur les compétences : http://perso.ens-lyon.fr/olivi
Il y fait une synthèse intéressante, au niveau européen, sur les manières différentes voire opposées dont les systèmes éducatifs ont interprété et mis concrètement en oeuvre "l'approche par compétences". Ce dossier est un complément indispensable aux nombreux textes disponibles par ailleurs présentant les bases théoriques et les principes pédagogiques de cette approche.
Pour les étudants-chercheurs en didactique des langues-cultures travaillant sur cette question dans des pays qui ont officiellement mis en oeuvre cette approche, lesdifférentes formes de mises en oeuvre repérées constituent une grille d'analyse immédiatement opérationnelle, qu'ils pourront ensuite affiner en fonction des résultats de leurs recherches.
Ils trouveront aussi dans ce dossier les liens vers les autres dossiers en ligne déjà réalisés par le même auteur sur la même thématique.
Christian Puren
Annonce d'une journée d'étude sur les manuels scolaires et le numérique
Une journée d'étude sur "Les manuels scolaires et le numérique" est annoncée pour le mercredi 5 février 2014 de 9h à 17h à l'IUFM de Montpellier. Il s'agit d'une problématique importante, en raison tant du poids actuel du manuel en didactique scolaire, de ses évolutions en cours dues à l'intégration en cours de la perspective actionnelle, que des effets présents et prévisibles du numérique sur les matériels didactiques : comment ces trois éléments vont-ils évoluer dans les années à venir, forcément en interférence les uns avec les autres ?
Les relations entre le manuel et le numérique sont à la fois prometteuses en principe, et actuellement décevantes dans la réalité : on pourra lire sur ces deux points, dans le dernier numéro de Recherche et applications (OLLIVIER Christian & PUREN Laurent dir., "Mutations technologiques, nouvelles pratiques sociales et didactique des langues", n° 54, juillet 2013, 179 p. Paris : FIPF-CLE international), respectivement l'article que j'y ai moi-même publié ("Technologies éducatives et perspective actionnelle : quel avenir pour les manuels de langue"), et celui de Nicolas GUICHONET et Thierry SOUBRIÉ ("Manuels de FLE et numérique").
Je ne peux donc qu'inciter vivement à participer à cette journée en tant qu'intervenant, ou simple participant. Voir l'appel à communication.
Christian Puren
Carnet rose : naissance d'un nouveau site personnel sur la didactique des langues-cultures

J'ai le plaisir d'annoncer la naissance du site www.marieberchoud.com. C'est le site personnel d'une collègue et amie, Marie Berchoud, mais surtout d'une didacticienne qui partage avec moi la même conception de la discipline "didactique des langues-cultures", et plus encore les mêmes valeurs, tout en travaillant et publiant - de par ses intérêts, sa formation et sa carrière - sur des thématiques en partie différentes des miennes, mais complémentaires.
J'incite donc vivement les lecteurs de mon site à mettre aussi le sien dans leurs "favoris", et dès à présent à en suivre régulièrement l'évolution et diffuser la nouvelle de sa naissance. J'espère qu'à la suite de nos deux exemples, d'autres collègues didacticiens de langues-cultures mettront aussi à la disposition des étudiants dans cette discipline, qui ont dans beaucoup de pays de grandes difficultés d'accès à la documentation - et à une documentation fiable immédiatement exploitable pour leur formation et leurs recherches -, le maximum de leurs travaux.
Franc succès et longue vie au site www.marieberchoud.com !
Christian Puren
Faire ou ne pas faire une thèse en didactique des langues-cultures ?
J'ai lu avec intéret le billet d'Isabelle BARTH sur son blog, intitulé "Ne dites pas à mes parents que je suis doctorant en management, ils croient que je cherche un emploi", daté du 10 juin 2013.
Elle y présente "les raisons de faire / de ne pas faire une thèse de doctorat" en "sciences de gestion" (management) qui me paraissent pour la plupart transférables telles quelles pour la
didactique des langues-cultures. Je reprends ici les titres correspondants, qu'elle développe bien entendu dans son billet:
|
Arguments contre |
Arguments pour |
| 1. La longueur du projet | 1. Les enjeux pour la société |
| 2. La précarité | 2. Les enjeux pour une discipline |
| 3. L'implication H24 (24h sur 24) | 3. La formidable stimulation intellectuelle |
| 4. Le stress et le doute |
4. Un portefeuille de compétences inédites et rares |
|
5. Le manque de valorisation des métiers d'enseignant-chercheur |
5. Le bac + 8 : la nouvelle frontière des cadres à haut potentiel |
|
6. Le moyen le plus sûr de perdre tout contact avec la réalité |
6. Un projet excitant et distinctif |
L'auteure donne finalement un net avantage aux raisons "d'y aller", comme elle l'écrit dans sa conclusion, qui me semble elle aussi valable pour la didactique des langues-cultures (la toute dernière phrase, en particulier, me semble particulièrement pertinente):
Finalement, y aller ou pas ?
Oui, trois fois oui ! Commencer une thèse de doctorat c’est identifier avec passion une énigme à résoudre. C’est vouloir mieux comprendre et interpréter le monde qui nous entoure. C’est le «
pourquoi » de l’enfant que nous avons été et qui cherchait des réponses à tout ce qui l’étonnait, mais avec des outils et des méthodes que l’on maîtrise. Faire une recherche doctorale, c’est
aussi sortir des croyances et des idées toutes faites, conquérir l’objectivité qui permet de sortir des conflits construits sur les « on dit ».
Soyons clair, une recherche doctorale en sciences de gestion a peu de probabilité de modifier le cours de l’histoire du management et des organisations, mais elle peut y contribuer,
modestement, et c’est déjà très bien, comme elle contribue à la connaissance sur les pratiques managériales.
Si une recherche doctorale ne change pas le monde, elle change, à coup sûr le doctorant qui la conduit. Et ce processus est sans prix.
Christian Puren
La sociologie de Michel Crozier et la didactique des langues-cultures (hommage)
Olivier BORRAZ, Erhard FRIEDBERG et Christine MUSSELIN, chercheurs au Centre de sociologie des organisations (Sciences-Po-CNRS) ont publié dans le jounal Libération du 3 juin 2013 un long article nécrologique en hommage au sociologue français Michel CROZIER, fondateur de ce Centre de recherche.
J'en reproduis ci-dessous quelques passages.
[…] L'apport de Michel Crozier est singulier. Car c'est la manière même de faire de la sociologie qu'il a contribué à transformer. Il a défendu une posture intellectuelle que l'on peut
résumer par la curiosité. […] Elle donne toute sa place à l'enquête, ce patient travail de terrain fait d'entretiens avec les acteurs qui participent au fonctionnement des organisations, à
la conception des politiques, à la régulation des marchés.
Cette immersion dans le terrain suppose de la part du sociologue une grande modestie, une capacité d'écoute et un respect pour les acteurs avec lesquels il s'entretient. Elle est
indispensable pour comprendre ce qui les motive et ce qui les fait tenir ensemble - ou les oppose.
Cette démarche d'enquête se prolonge dans une posture d'analyse qui repose sur un parti pris philosophique: celui de la liberté et de la rationalité des acteurs. Il s'agit certes d'une
liberté contrainte et d'une rationalité limitée, mais elles sont néanmoins réelles: les acteurs ont toujours le choix et ils ont de bonnes raisons d'agir comme ils le font. Le rôle du sociologue
consiste à restituer les contraintes qui pèsent sur les acteurs et les raisons qui leur font prendre une décision ou adopter un comportement.
Mais, à la différence d'autres approches en sociologie, cette analyse ne découle pas d'un cadre théorique préexistant; elle s'appuie sur le croisement des données elles-mêmes. Bref, il s'agit
de comprendre les processus qui conduisent la réalité à être bien plus complexe que les représentations qui en sont données - mais dont on peut rendre compte de manière claire. La démarche de
Michel Crozier a souvent été associée à une démarche d'intervention - généralement pour la critiquer.
[…] Mais cette volonté constante d'améliorer la régulation de nos sociétés, le souci de faire prendre conscience aux dirigeants que les comportements de leurs subordonnés sont plus
riches d'enseignements qu'ils ne l'imaginent, cette obsession de rendre compte de l'épaisseur des organisations face aux représentations plates de leurs dirigeants, et surtout le projet de
reconnaître aux acteurs une plus grande autonomie sans déresponsabiliser le sommet, tout cela constitue des objectifs toujours d'actualité.
La démarche croziérienne se caractérise, enfin, par une très grande ouverture intellectuelle. Loin d'être un cadre d'analyse total, elle permet d'engager le dialogue avec d'autres approches
méthodologiques, conceptuelles ou théoriques en sociologie, en science politique, en gestion voire en histoire.
(Les principes de Michel Crozier :) la primauté à l'enquête de terrain; la formation à la recherche par la recherche, qui se traduit par la place centrale des doctorants dans le laboratoire
et des méthodes pédagogiques qui refusent le dogmatisme; la force du groupe, qui conçoit la recherche non comme un acte solitaire mais comme une démarche collective.
Mais tout cela ne serait rien sans cette grande curiosité qu'il nous a apprise et sans cette conviction que nous partageons avec lui, à savoir que nos travaux peuvent faire avancer la
compréhension de nos sociétés, mais aussi contribuer à les rendre plus justes.
Je retrouve dans ce texte, pour ma part :
- La même conception de l'objet d'analyse, que je définis en didactique des langues-culture comme le processus complexe d'enseignement-apprentissage.
Cf., ici, le projet qui est de "comprendre les processus qui conduisent la réalité à être bien plus complexe que les représentations qui en sont données".
- Le même objectif interventionniste d'amélioration de la situation.
Cf., ici, la volonté de "contribuer à rendre (nos sociétés) plus justes".
- Ainsi que toute une série de correspondances avec ma propre conception de la recherche dans ma discipline, dont j'ai présenté les principes dans mon manifeste de 2003(b) intitulé "Pour une didactique comparée des langues-cultures".
Dans ce texte, je présentais ma conception de la recherche au moyen d'un certain nombre d'approches, en particulier:
- "L'approche compréhensive (la centration sur les acteurs)"
Cf., ici, "un parti pris philosophique: celui de la liberté et de la rationalité des acteurs", "le projet de reconnaître aux acteurs une plus grande autonomie".
- "L'approche environnementaliste (la contextualisation)"
Cf., ici, la place accordée à l'enquête, qui ne s'explique pas seulement par la curiosité du chercheur, mais aussi et surtout par l'idée que la centration sur les acteurs amènent forcément, pour saisir leur intentionnalité, à les comprendre en action dans leur propre environnement.
- "L'approche qualitative (la conceptualisation interne)" : je m'appuyais implicitement, pour cette approche, sur les propositions des sociologues A.M. Huberman et M.B. Miles
telles que je les ai présentées dans le chapitre 4 d'un article de 1997(b), « Concepts et conceptualisation en didactique des langues : pour une épistémologie
disciplinaire ».
Il s'agit par cette approche (je cite ces auteurs) d'atteindre progressivement "une cohérence conceptuelle/théorique" en reliant chaque donnée recueillie sur le terrain à d'autres données, puis
en les regroupant sous des "éléments conceptuels" (constructs) de plus en plus larges" ; ces éléments conceptuels vont enfin être reliés eux-mêmes dans une "théorie", celle-ci étant définie comme
un "cadre conceptuel" consistant en une description des concepts-clés (dimensions, facteurs, variables) ainsi que de leurs relations et interactions.
Cf., ici : "à la différence d'autres approches en sociologie, cette analyse ne découle pas d'un cadre théorique préexistant ; elle s'appuie sur le croisement des données elles-mêmes."
- "L'approche pragmatiste (la confrontation avec la réalité)", que j'ai empruntée au philosophe américain Richard RORTY: voir sur mon site le document 015 en Bibliothèque de
travail, "Théories externes versus modélisations internes (Morin-Rorty)".
Cf., ici, "Cette immersion dans le terrain suppose de la part du sociologue une grande modestie, une capacité d'écoute et un respect pour les acteurs avec lesquels il s'entretient. Elle est
indispensable pour comprendre ce qui les motive et ce qui les fait tenir ensemble - ou les oppose."
- "L'approche complexe (la variation des perspectives)", qui demande de diversifier les méthodes de recherche, y compris celles empruntées à d'autres disciplines : l'enquête et
l'entretien à la sociologie, l'analyse de contenu et l'analyse du discours de classe à la linguistique, l'analyse de l'interlangue et des stratégies d'enseignement et d'apprentissage aux sciences
cognitives, etc.
Cf., ici : "La démarche croziérienne se caractérise, enfin, par une très grande ouverture intellectuelle. Loin d'être un cadre d'analyse total, elle permet d'engager le dialogue avec d'autres
approches méthodologiques, conceptuelles ou théoriques en sociologie, en science politique, en gestion voire en histoire."
Je me joins à l'hommage rendu à Michel CROZIER.
Christian Puren
Parution d'un numéro de revue sur l'éthique en didactique des langues-cultures
La revue Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité – Cahiers de l’APLIUT, vient de publier son Volume XXXII n° 2, juin 2013, intitulé "Quelle place pour l’éthique dans l’enseignement des langues de spécialité ?". L'ensemble des articles de ce numéro est disponible gratuitement en ligne.
Les numéros de revue sur ce thème de l'éthique ou de la déontologie en didactique des langues sont assez rares pour que je signale celui-ci. L'éthique est en effet pour moi l'un des
positionnements privilégiés de la perspective "didactologique" avec l'épistémologie et l'idéologie. Le Dossier n° 8 de mon cours en ligne "La DLC comme domaine de recherche", intitulé "La perspective didactologique (2/2) : l'idéologie et la
déontologie", lui est d'ailleurs partiellement consacré. On y trouvera (pp. 7-8) les références d'autres numéros de revues pédagogiques consacrés à ce thème, dont deux concernant la
didactique des langues (Les Langues modernes n° 3, 1994, et Études de linguistique appliquée n° 109, janv.-mars 1998.
Je recommande particulièrement la lecture de deux articles dont les auteurs partagent avec moi la même conception globale de la discipline :
- Emmanuel ANTIER, "Pour une réflexion disciplinaire sur l’éthique professionnelle des enseignants de langue-culture", pp. 12-26.
- Yannick IGLESIAS, "L’éthique dans l’enseignement-apprentissage des langues de spécialité : le cas de l’espagnol en Économie",
Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité – Cahiers de l’APLIUT, Volume XXXII n° 2, juin 2013, pp. 82-103.
Christian Puren
La formation des enseignants à/dans une perspective actionnelle
La perspective actionnelle a été élaborée ces dix dernières années pour l'enseignement-apprentissage des langues-cultures. Il est devenu nécessaire d'en définir les implications dans la formation des enseignants.
Il me semble que l'on doit distinguer la formation des enseignants
- à la perspective actionnelle : on leur en présente ou fait rechercher les origines, les principes, les formes de mise en oeuvre dans les manuels de langue et les séquences de classe; on leur fait créer des outils et des séquences correspondants, etc.);
- et dans une perspective actionnelle : dans ce dernier cas, les principes de la perspective actionnelle sont appliqués à la conception de la formation elle-même des enseignants.
Concevoir la formation des enseignants dans une perspective actionnelle doit se faire au moins à deux niveaux:
1) Le niveau des modes de formation des enseignants
Le moyen le plus efficace de former les enseignants est sûrement qu'ils se mettent eux-mêmes "dans une perspective actionnelle" vis-à-vis de leur formation, c'est-à-dire qu'ils la conçoivent avec
les formateurs comme un projet global à la fois personnel et collectif et qu'ils la réalisent en partie - sinon pour l'essentiel - sous forme de projets concrets négociés avec les formateurs.
2) Le niveau des contenus de formation des enseignants
Je viens de relire, à l'occasion de la préparation d'une prochaine conférence, le Dossier d’actualité Veille et Analyses, n°79, novembre de l'IFE intitulé "Pédagogie + Numérique = Apprentissages
2.0", réalisé par Rémi THIBERT et publié en ligne en 2012. Il y rendait compte en ces termes de l'initiative de l'European Schoolnet
avec "la classe du futur".
Le Future Classroom Lab, mis au point dans le cadre du projet iTEC (Designing the future classroom), part du postulat que ce n’est pas tant le numérique qui
conditionne l’espace que l’utilisation pédagogique qui en est fait. La classe telle qu’ils l’imaginent (au jour d’aujourd’hui, avec les outils d’aujourd’hui) comporte six zones d’apprentissage,
correspondant à six situations d’apprentissage :
- Une zone de recherche et d’accès aux ressources (textes, images, vidéos, son, etc.) ;
- Une zone de création pour la réalisation de projets ;
- Une zone de présentation avec interactivité, audience, etc. ;
- Une zone d’échange et de collaboration ;
- Une zone d’interactions entre l’enseignant et les élèves ;
- Une zone de développement plus personnel (apprentissage informel, recherches individuelles, etc.). (p. 11/22)
Il se trouve que ces situations d'apprentissage sont définies "dans une perspective actionnelle" (i.e. en fonction de ce qu'y font les apprenants), et elles correspondent aussi
par conséquent à une typologie très concrète des activités fondamentales d'apprentissage... et de formation (on peut proposer les mêmes types de "zones" différentes aux étudiants en formation ).
Il faudrait sans doute compléter les contenus, comme nous y invitent d'ailleurs les différents "etc." à la fin de plusieurs items. Je ne vois pas, par exemple, pourquoi le "développement plus personnel" ne se ferait pas aussi en partie pour l'apprentissage de la langue dans des apprentissages formels, par exemple au moyen d'exercices portant sur la grammaire et le lexique, ou encore par un entraînement individuel à des stratégies de compréhension. Mais ces différents types d'activités me semblent a priori permettre d'imaginer autant de "modules actionnels" de formation d'enseignants, qui auraient l'avantage décisif de jouer pleinement l'homologie entre les modes de formation et les modes d'enseignement auxquels on se propose de former.
Christian Puren
Des méthodes d'apprentissage basées sur les neurosciences ?
Le dernier dossier de Thot Cursus porte le thème "Neurosciences et apprentissages". L'un des articles s'intitule "Comment le cerveau assimile une nouvelle langue", et, dans un chapitre intitulé "Des méthodes d'apprentissage basées sur les neurosciences", on peut y lire ceci :
Le Middlebury College, connu pour la qualité de ses programmes linguistiques, a vite compris qu'il fallait se servir de ce que les neurosciences nous apprennent sur l'apprentissage d'une
langue et donc, immerger les élèves dans la langue cible. Les jeunes qui prennent des cours de langues l'été dans cet établissement doivent donc obligatoirement parler la langue d'apprentissage
lors de leurs différentes activités. Pour le vice-président de l'établissement, il y a 4 éléments nécessaires pour bien maîtriser une langue :
- L'utiliser.
- L'utiliser avec un but, ajouter un projet en parallèle qui justifie l'apprentissage (exemples : créer une démonstration de cuisine, monter une pièce de théâtre, etc.).
- Avoir accès à du matériel authentique. Il faut des extraits audio et vidéo provenant de réels échanges et situations qui emploient le langage (verbal et non verbal).
- L'utiliser en interaction avec les autres.
Il me semble que l'on peut, en tant que didacticien (ou enseignant) avoir deux réactions différentes à la lecture de ce passage :
1) se dire que l'on n'a pas attendu les neurosciences pour savoir que ces éléments sont nécessaires à l'apprentissage, et pour les mettre en œuvre ;
2) ou constater que comme par hasard, ce que l'on fait valider ainsi aux neurosciences, ce sont les orientations actuelles de la didactique des langues-cultures, puisqu'on y retrouve les
principes de la perspective actionnelle et de l'approche communicative.
Comme quoi il est faux de penser que l'on fait dire aux neurosciences n'importe quoi : au contraire, on leur fait dire très exactement ce qu'on a envie d'entendre de leur part.
C'est une très vieille stratégie, dans l'histoire de la didactique des langues, que de faire appel ainsi aux sciences, quelles qu'elles soient, pour valider a posteriori des idées qui en réalité proviennent d'une adaptation empirique des enseignants et didacticiens aux besoins, demandes et attentes sociales.
Le jour où les neurosciences prendront les uns et les autres à contre-pied, c'est seulement à ce moment-là qu'il sera intéressant d'écouter ce qu'elles ont à vraiment nous dire.
Le titre que je donnerais personnellement à ce chapitre serait donc : "Les neurosciences au secours des méthodes d'apprentissage"...
Christian Puren
Postscriptum en date du 21 novembre 2018
Depuis la publication du texte ci-dessus, les neurosciences - ou du moins les implications qu'en font certains en France - ont pris à contre-pied les conclusions empiriques très largement partagées par les spécialistes de l'apprentissage de la lecture, en donnant la priorité exclusive au décodage dans les débuts de cet apprentissage, et, pour ce décodage, à une approche strictement analytique. Mais il s'agit là en réalité d'une instrumentalisation des neurosciences au service d'un projet pédagogique "réactionnaire" dans le sens étymologique du terme - c'est une réaction contre les excès et les errements présumés de l'approche globale intégrale - ... mais aussi dans son sens politique. Voir aussi à ce propos mon billet de blog en date du 4 janvier 2014, intitulé "À propos de la sempiternelle polémique entre la "méthode syllabique" et la "méthode globale" en enseignement-apprentissage de la lecture à l'école primaire".
